Hôtel Europe, c’est le nom du vrai hôtel où nous nous sommes vraiment retrouvés, avec Gilles Hertzog, lors de notre tout premier voyage dans Sarajevo assiégée. C’est un jour de juin 1992. Nous sommes arrivés par la route, dans une R16 louée à l’aéroport de Venise et dans laquelle nous avons franchi, sans toujours nous en apercevoir, les lignes entremêlées des armées serbes, croates et bosniaques. Les bombes, quand nous arrivons, pleuvent sur la ville. Les habitants, sans électricité ni eau, vivent dans les caves de leurs immeubles. L’avenue du Maréchal-Tito a été rebaptisée Sniper Alley car c’est le champ de tir préféré des snipers qui, depuis les collines, confortablement installés sous un parasol, le cul sur un pliant, glacière et pique-nique à leurs pieds pour quand ils auront un petit creux, jouent à faire des cartons sur les enfants de Skanderia et Koševo. Nous avons parlé de Sartre et de Camus, dans une chaufferie souterraine, avec des professeurs d’université, des étudiants, des écrivains, devenus des intellectuels des catacombes. Nous avons fait la connaissance d’un personnage hors normes, au nom imprononçable, qui va occuper, dans notre vie, une place la veille encore inimaginable : Alija Izetbegović, président de cette République multiethnique et multiconfessionnelle de Bosnie-Herzégovine – homme de foi et de loi devenu, à son corps défendant, résistant et chef de guerre. Et parce que, le temps que nous fassions connaissance, le temps, aussi, qu’il nous confie le fameux message où il comparait la situation de sa ville à celle du ghetto de Varsovie en flammes et appelait, par voie de conséquence, le président François Mitterrand au secours, la pluie d’obus, dehors, est devenue trop drue pour que nous prenions le risque d’aller jusqu’à l’Holiday Inn qui est le rendez-vous des rares journalistes déjà là, nous nous sommes réfugiés à l’Hôtel Europe – quel symbole.
Hôtel Europe c’est un symbole, aussi, pour Dino Mustafić et Danis Tanović, respectivement metteur en scène de la pièce Hôtel Europe et mémorialiste, caméra au poing, de l’ensemble de cette aventure d’Hôtel Europe. Ils ont alors un peu plus de vingt ans. Ils sont élégants et drôles. Idéalistes et sarcastiques. Ce sont de jeunes intellectuels, imbattables, l’un sur la Nouvelle Vague, les premiers films de Godard, tel plan non monté de Vertigo de Hitchcock, ou le cuirassé d’Eisenstein – l’autre sur Foucault, Althusser, les grandes tendances de la philosophie française et européenne contemporaine, et même un de mes livres qu’il a lu, avant la guerre, dans une traduction de Danilo Kiš. Mais, comme ils sont aussi très courageux, on leur a donné le pire boulot possible dans une armée en guerre, qui est de courir là où ça pète, bombarde ou brûle pour y tourner des images qu’archivera l’état-major. Et c’est l’Hôtel Europe qui, ce jour-là (il me semble qu’on est en juillet de la même année 1992), flambe de tous les feux de l’enfer créé et attisé par les obusiers serbes et leurs stratèges. Ils sont, Dino et Danis, sur le toit de l’hôtel en feu. L’un est à droite de la colonne de flammes. L’autre à gauche. Ils se hèlent, appellent chacun le nom de l’autre, le hurlent, le lancent vers le ciel comme si cela allait aider à franchir le rideau de flammes et de fumée. Mais, alors qu’ils ne sont qu’à quelques mètres l’un de l’autre, le ronflement de l’incendie est si fort que soit leur voix ne porte pas, soit elle porte mais c’est la réponse de l’ami qui ne parvient pas à franchir la colonne de feu. En sorte qu’ils filment et filment encore ; ils font consciencieusement leur travail et, comme les derniers combattants, justement, du ghetto de Varsovie consignant la chronique de leur calvaire sur des manuscrits qu’ils enterreront juste avant de mourir en se disant qu’une main amie, un jour, les retrouvera et les portera à la connaissance du monde, ils continuent de filmer afin que, si le feu va à son terme et que nul n’y survit, il reste au moins ces images, ce témoignage, à destination des survivants et des enfants des survivants. Mais ils filment, ce jour-là, secoués de sanglots ou, peut-être, serrant les dents pour empêcher que les sanglots ne sortent – car convaincus, chacun, que l’ami, qui ne répond plus, a été avalé par le brasier.
Hôtel Europe c’est donc une aventure à trois. Ou à quatre si je compte Gilles qui est, depuis trente ans, de toutes mes aventures. Ou à cinq si je compte Florence – Florence Hartmann, la journaliste courage, la lanceuse d’alerte avant la lettre qui, il y a six ans, lorsqu’elle découvrit que le Tribunal pénal international, pour lequel elle travaillait, avait fait un deal crapuleux avec les Serbes (vous donnez vos archives au Tribunal et le Tribunal, en retour, vous garantira l’impunité pour vos crimes), mit tout en jeu, absolument tout, y compris sa liberté de mouvement et sa liberté tout court, son crédit intellectuel, son ancien métier et son nouveau, pour dénoncer le deal et prendre, jusqu’au bout, le parti des victimes – là, sur Hôtel Europe, Hartmann est, avec Gilles, productrice, ambassadrice de bonne volonté, agent de liaison entre ceux de mes amis bosniaques perdus de vue et moi, force qui va, pourvoyeuse de détermination et de d’énergie. Dieu sait si je n’aime pas, d’habitude, les « collectifs ». Ni, encore moins, les histoires d’anciens combattants liés par on ne sait quelle « fraternité », elle-même trempée dans le métal d’un combat, ou d’une épreuve du feu, partagés. Mais, là, comment y échapper ? Comment nier que quelque chose de cet ordre nous unisse tous les cinq ? Nous avons vu les mêmes choses – qu’un humain ne devrait jamais avoir vues. Nous avons, non seulement vu, mais prévu les charniers d’un Srebrenica dont la communauté internationale n’a fini par envisager l’hypothèse que pour se carapater. Et nous portons ce souvenir comme une blessure, un remords, une honte (eh oui ! les salopards n’ont pas honte ! les généraux de la honte n’ont pas honte ! les Juppé, les Balladur, qui ont courageusement regardé ailleurs quand le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de livrer l’enclave à la soldatesque de Mladić, n’ont pas honte et, à ce que je sais, dorment bien la nuit ! mais nous qui savions, nous qui l’avons crié, nous qui avons tout tenté de ce qui était en notre pouvoir pour conjurer ce qui était en train d’arriver, nous nous reprocherons jusqu’à la fin de nos jours de ne pas avoir crié assez fort !) – et cette honte, oui, ce remords, cet infini regret mêlé à un peu de fierté, tout de même, de nous être mieux tenus que d’autres et de n’avoir pas failli au service minimum de la dignité humaine et de l’honneur, voilà ce qui nous rapproche. Péguy, dans Notre jeunesse, dit quelque chose de ce genre à propos du lien mystique qui avait agrégé les dreyfusards. Et ainsi parlaient aussi les anciens de la guerre d’Espagne, cette autre communauté inavouable qu’une défaite, cette fois, une terrible mais noble défaite, avait indissolublement soudée. La guerre de Bosnie fut notre « Affaire ». Elle fut notre guerre d’Espagne. Et honni soit qui mal en rit.
Une idée hante Hôtel Europe – et me hante, moi, depuis vingt ans. Que la Bosnie c’était l’Europe même ; que la Bosnie, parce que l’on y était serbe, croate ou bosniaque mais que l’on y avait aussi, et toujours, une identité de surcroît qui était l’identité bosnienne, c’était le propre paradigme de la double appartenance dont nous rêvons, depuis soixante ans, pour l’Europe ; que la Bosnie, parce que ces trois identités y cohabitaient en harmonie, parce que l’on entendait, aux mêmes heures ou presque, les cloches de la cathédrale, la prière des imams et une psalmodie juive (sans oublier le joyeux vacarme de ces cafés mi-turcs mi-habsbourgeois qui sont la signature des Lumières de la ville et de son identité mittleuropéenne et profane), était ce miracle de civilisation que nous appelons de nos vœux quand nous nous disons « Européens » ; que la Bosnie, en un mot, c’étaient des hommes, des femmes, des enfants déchiquetés par les obus ou, quand pas déchiquetés, déplacés et déportés – mais que c’était aussi un Principe et que ce Principe est le Principe même qui a présidé à la construction de l’Europe et qui devrait, normalement, présider à son renforcement. Mais l’idée qui me hante aussi c’est que ce miracle de civilisation, nous l’avons sacrifié ; c’est que cette petite Europe, cette Europe en réduction, nous n’avons pas bougé une oreille quand les purificateurs ethniques ont voulu l’arracher, tel un chancre, à la chair vive de l’Europe ; l’idée qui m’obsède et qui, de même qu’Hemingway à qui l’on demandait s’il croyait en Dieu et qui répondait « parfois la nuit », me fait, moi, la nuit, croire parfois au diable, c’est que l’Europe a accepté, quand elle ne l’a pas voulue, la mort de ce pays où était son cœur battant et son âme. Une civilisation se remet-elle d’une pareille forfaiture ?
La Bosnie, oui : les assassins n’ont pas réussi à l’assassiner et son européité est toujours là, intacte, dans la personne, par exemple, de mon ami Bakir Izetbegović, deuxième du nom, président comme son père le fut, et que la trahison des Européens n’a pas pu dégoûter de l’Europe et du désir de la rejoindre. Mais elle, l’Europe ? Comment vit-on quand on a, dans ses placards, les cadavres de deux cent mille Bosniens ? Et si elle était là, l’origine de ce malaise dans la civilisation européenne dont nous payons, aujourd’hui, partout le prix ? Et si l’Europe d’Husserl et de Patočka, de Goethe et d’Havel, et si l’Europe de Cervantès et de Robert Schuman ne s’était jamais remise de cette culpabilité tue dont les symptômes ont le mauvais parfum, du coup, des effroyables régressions qui tiennent, pour l’heure, le haut du pavé européen ? Je ne sais pas. Mais Hôtel Europe pose la question.
Hôtel Europe, c’est une pièce sur l’Europe dont l’action se situe à l’Hôtel Europe, dans une petite chambre que j’ai connue en ce temps-là, et où le personnage retrouve, tel qu’en lui-même le grand incendie ne l’a, bizarrement pas effacé, l’impact de l’obus qui, ce soir-là, entré par la fenêtre, était venu percuter son armoire. Unité de lieu : cette chambre, bruissante de vilaines ombres et de gentils fantômes formant comme une chaîne qui plonge jusqu’aux tréfonds de lui-même. Unité de temps : les deux heures, montre en main, dont il dispose pour composer le grand discours sur l’Europe qui lui a été commandé et qu’il doit prononcer devant les huiles venues, du monde entier, noyer leur culpabilité dans le mauvais alcool de la fièvre commémorative. Unité d’action : si ce discours s’écrira ou ne s’écrira pas ; si ses mots vont prendre forme ou si, pour la première fois de sa vie, ils seront aussitôt consumés à la flamme du Tragique dont Sarajevo fut le théâtre et qui, soudain, fait retour ; si l’Europe, en un mot, est, comme il l’a, à l’époque, souvent écrit, morte à Sarajevo – ou si elle peut renaître de ses cendres mais, alors, à quelles conditions… Il y a une condition qui lui apparaît, alors, dans une extrême clarté. C’est une goutte de Bosnie à injecter, sans délai, dans la vieille chair malade des institutions européennes sans âme ni esprit. C’est la Bosnie considérée comme une sorte de cellule souche de l’identité de l’Europe en perdition. C’est, en un mot, l’entrée dans l’Union de notre cher Sarajevo : avec ses nus et ses morts, ses cimetières inséparables de ses jardins, ses résistants vaincus, ses triomphateurs à qui l’on a volé jusqu’au goût de leur victoire, et ces hommes qui ont fait la guerre sans l’aimer et ne s’en sont jamais remis. L’Europe est déjà trop vaste ? Trop grosse ? Trop nombreuse pour s’élargir encore ? Ce n’est pas d’élargissement que je parle, mais de réunification ! Et de même que le général de Gaulle murmurant, au dire de Romain Gary, lors de l’inspection, à Londres, de l’escadrille de Français libres de l’auteur d’Éducation européenne : « Ce sont les meilleurs qui partent en premier », mon personnage est assez tenté de répondre à ces défaitistes de l’Europe qu’il y a beaucoup de pays, en effet, dans la Maison Commune mais que ce sont les meilleurs, les plus riches en esprit, qui n’y sont pas encore et que nous attendons.
Je suis dans ce personnage d’Hôtel Europe. Mais en même temps je n’y suis pas. Que je n’y sois pas, cela se déduit de la présence d’un acteur, de son corps, de son épaisseur de chair et de voix – et, de fait, quel acteur ! don Juan et Cyrano ! Galilée, le Misanthrope, Monte-Cristo, tant d’autres ! et cette invraisemblable puissance de jeu, et cette panoplie, et cette ampleur, dont Jacques Weber est le nom – sec et tonitruant ; sage et magnifique ; rêveur et, soudain, étrangement violent ; affalé et raide; danseur ou laboureur de mon texte ; air d’enfant coquin, ou de prince devenu ascète, ou, à la fin, au cinquième acte, de bonze franciscain en train de perdre la tête. Le signe que j’y suis, en revanche… Oh, le signe ! Les signes, comme les preuves, fatiguent la vérité. Mais, enfin, ce sont des personnages, des vrais, qui sont des femmes et des hommes de ma vie et qui peuplent ce monologue. Il y a là Samir, compagnon de tournage de Bosna !, qui est l’unique lien, quand mon personnage se cloître, entre lui et le monde. Jovan Divjak, le héros, qui sortait dans les rues de Sarajevo, les jours de grand bombardement, juste pour donner l’exemple et montrer qu’il n’avait pas peur. L’Ami turc avec qui nous avons fait, dans ses avions, ce que peu d’intellectuels ont fait – mais chut ! ne pas en dire plus, ici, que dans la pièce ! Et le combattant de Stup qui lisait Guerre et Paix quand venait l’heure de quitter la tranchée et de rentrer dans sa guérite. Et le colonel sans galons, non moins dédaigneux du danger, retrouvé sur une des photos que Weber convoque sur l’écran de son ordinateur. Et ceux que la mort a effacés. Et ceux que la vie a, elle aussi, mais d’une autre façon, ensevelis. Et Alija que j’étais venu revoir, une dernière fois, juste avant qu’il ne meure. Et le Polonais qu’on appelait l’Iranien. Et Senada qui se maquillait comme on résiste. Et Nermina, la gardienne de musée, qui savait que sauver la beauté du monde, l’arracher à la prise des vandales, est une autre forme de résistance. Et le directeur de la morgue qui écrivait, à mesure qu’on les lui amenait, d’une plume imperturbable et appliquée, les noms des morts de la journée – et ce jour où je l’ai rencontré et où c’est le nom de son propre fils que, sans ciller, sans trembler, il a couché dans le registre. Et Elvir, l’Américain de Sarajevo, qui se voue à faire revenir son pays dans l’Europe. C’est fou le monde qu’il peut y avoir dans une tête ! C’est fou le nombre d’individus, mais aussi de spécimens humains, dont je me suis enrichi pendant ces saisons sarajéviennes. Les personnages les plus rares. Des hommes et femmes d’exception. Je n’ai jamais compris que l’on préfère Racine à Corneille. À Sarajevo, j’ai rencontré Cinna, Horace, Rodrigue, Médée, Polyeucte bien sûr, Andromède, Nicomède, Sertorius, Suréna – j’ai fait mon plein de ces êtres à la grandeur désolée, unis dans le courage, mais têtes solitaires.
Hôtel Europe est un texte sombre. Il est sombre comme ma pauvre petite Bosnie qui survit, vaille que vaille, à l’imbécillité des accords de Dayton que l’Amérique et le monde lui ont perversement imposés. Il est sombre comme l’Europe où triomphent, aujourd’hui, comme jadis dans les Balkans et comme si cela était un effet retard de ceci, les populistes, souverainistes, maniaques de la volonté de pureté, néofascistes divers et variés. Et il est sombre comme ces sombres temps où j’ai écrit, dès les lendemains de la guerre de Bosnie, que nous étions entrés : nous sommes tous des Bosniaques délaissés – tel était, il y a vingt ans, le dernier mot de ma première pièce ; il y a un devenir-Bosnie du monde, mais attention ! la Bosnie dépecée, la Bosnie dépossédée, la Bosnie humiliée, qu’il faut, s’il est encore temps, tenter de conjurer – ce sont les derniers mots de cette pièce-ci, Hôtel Europe. Est-ce, pour autant, un texte désespéré ? Bien entendu non. Car reste Dante et son De Monarchia qui était un projet d’Europe. Et Goethe. Et le fantôme d’Ivo Andrić et celui de Czesław Miłosz. Et celui de Kafka, que je propulse au ministère de l’Absurde. Et Pessoa à celui de l’Intranquillité. Et reste la Bosnie, reste ce reste de la Bosnie, ou ce reste qu’est la Bosnie – reste cette part inentamée de grandeur qui est une poignante leçon de résistance et d’espoir. C’est ainsi que j’ai toujours pensé. Les vivants contre les morts. Mais aussi les morts contre les vivants quand ils sont plus morts encore que les morts. Leurs visages jeunes et sans résignation. Leurs noms qui n’ont plus servi depuis longtemps et qui semblent si frais. Et, là où le désert croît, au plus profond de la détresse, la promesse d’une ressource dont je vais, en Bosnie, chercher le chiffre. J’en suis là.
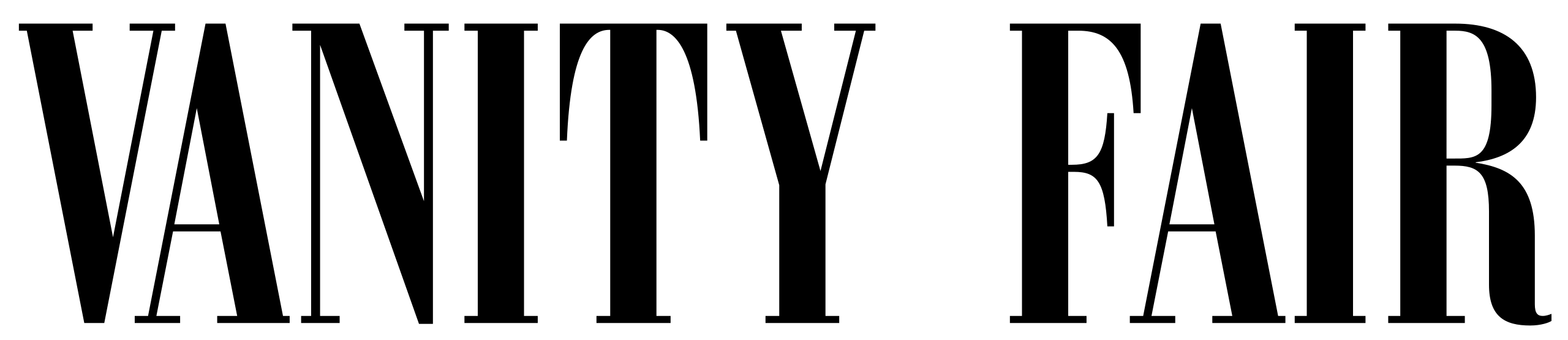
Réseaux sociaux officiels