Voilà. Ça y est. La comédie va recommencer. Et tous ceux qui, comme moi, s’imaginaient que c’était fini, que nous commencions de l’emporter et que la baudruche lepéniste était en train de se dégonfler, sont bien obligés de déchanter. Que la France de 1986 en soit réduite à ça, est bien entendu décourageant. Et j’ai presque honte moi-même, alors qu’il y a tant de choses à dire, tant de livres à lire et commenter, tant de vrais grands débats qu’il faudrait tenter d’ouvrir, j’ai presque honte, oui, d’avoir à consacrer ne fût-ce qu’un paragraphe de ce bloc-notes à un phénomène aussi minable, définitivement ringard et archaïque. Les faits sont là, pourtant. Les trente-cinq députés aussi, qui sont entrés tambour battant dans l’enceinte du parlement. Sans parler des 10 p. 100 de citoyens capables de se reconnaître dans ce polichinelle décoloré, bouffi de haine et de fatuité qui, avec son éloquence de sous-préfecture et ses ficelles de cabot usées jusqu’à la corde, incarne tout ce que la France peut avoir de plus vieillot. Hallucinante cocasserie d’un pays moderne, cultivé, civilisé qui, à quinze ans de l’an 2000, se paie le luxe absurde de recouronner Ubu…
Y a-t-il lieu de dramatiser, cela dit ? Et faut-il proclamer la patrie en danger sous prétexte que deux ou trois millions de Français ont, le 16 mars dernier, choisi le parti des bouffons ? Le danger n’est pas dans le nombre, bien sûr. Et la France, de ce point de vue, n’en est pas à son coup d’essai — qui a vu défiler depuis un siècle, sans en être autrement bouleversée, le boulangisme, les Croix de feu, l’O.A.S. ou le poujadisme. Non. La menace, si menace il y a, serait plutôt dans le style de ces pitres-ci. Dans leur prudence bien tempérée. Dans cette façon qu’ils ont — et que n’avaient pas, notamment, les poujadistes des années 1950 — de jouer loyalement, tout à coup, le jeu républicain. La menace, si l’on préfère, vient de cette idée neuve, plus insistante au fil des mois et qui pourrait bien, avec cette élection, avoir achevé de s’accréditer : un fascisme de bon ton, de bon aloi et bon enfant qui serait tout à fait compatible avec le système démocratique qu’il récusait jusqu’à présent. Voilà des années que, personnellement, j’annonçais ce moment. Voilà des années que, dans mes livres d’abord, puis aux côtés de S.O.S. Racisme, j’affirmais que l’heure du plus haut péril ne serait pas celle de la multiplication des bataillons fascistes en France mais celle de leur banalisation ; de l’acclimatation de leurs idées ; de leur intégration lente, rampante, puis soudain plus foudroyante à l’ordre de nos discours ; bref, voilà des années que je redoute l’heure où les idées de l’extrême-droite, aussi discutables, condamnables, voire haïssables qu’elles puissent paraître, finiraient par figurer, au même titre que les autres, au catalogue des idées normales, convenables, acceptables. Eh bien, nous y sommes. Et la France est un pays — le seul en Europe, pour l’instant — où un électeur sur dix peut naturellement, sans l’ombre d’un remords ou d’une provocation, s’affirmer xénophobe, raciste, antisémite.
Fallait-il, si tel était le climat, doter pareilles idées d’une représentation parlementaire ? Et était-il bien judicieux, par la réforme électorale que nous savons, de faire à Jean-Marie Le Pen et à ses sbires le cadeau inespéré de trente-cinq écharpes tricolores ? La question se pose, bien sûr. Et il est difficile, de ce point de vue, de donner tout à fait tort à ceux qui, dans l’actuelle majorité mais aussi hors de ses rangs, en font grief aux socialistes. Ce que je crois, cependant, c’est que, quitte à la poser, autant vaut le faire sur le fond — au niveau des principes autrement dit, des présupposés ou des philosophies qui, en réalité, commandent à ce débat. Car enfin de deux choses l’une. Ou bien l’on considère qu’on ne pactise pas avec le mal, qu’on ne ruse ni ne joue avec les forces de la perversion et que la seule manière de les gérer est de dresser, sur leur route, tout un luxe de tabous, d’interdits ou de censures qui, sans nuances ni états d’âme, travaillent à les refouler — et alors, en effet, je comprends que l’on milite pour un mode de scrutin qui refuse à 10 p. 100 de Français leur expression parlementaire. Ou bien l’on pense au contraire qu’aucune société n’a intérêt à entretenir de tels refoulements, qu’elle prend le risque, en le faisant, de voir resurgir ce refoulé d’une manière plus explosive et que la bonne attitude est de le libérer donc, de le laisser éclore au grand jour pour, une fois l’abcès crevé, le kyste bien isolé, tout mettre en œuvre pour le traiter — et c’est une raison alors, c’est la seule bonne raison d’opter pour un système qui autorise les fascistes à avoir, eux aussi, leurs députés. J’avoue, en ce qui me concerne, pencher vers cette seconde formule dans mes moments les plus optimistes, quand je crois aux vertus de l’aveu, du verbe, de la vérité — quand je crois qu’une société capable d’exhiber ses plaies est une société qui, déjà, court à la guérison ; mais j’avoue incliner vers la première à mes moments plus sombres — lorsque je songe au pathétique destin de tous ces « guérisseurs », maîtres de vérité et stratèges en tout genre, qui ont cru jouer au plus fin avec les progrès de la barbarie et dont la barbarie, aux jour et heure prescrits, a balayé tous les calculs. Je suis farouchement partisan, autrement dit, du mode de scrutin proportionnel quand je me sens « freudien » et que rien ne vaut, à mes yeux, un bon symptôme bien net, parfaitement localisé, où se cristallise en quelque sorte toute la névrose d’une société ; et je suis non moins farouchement partisan du mode de scrutin majoritaire quand tout cela me semble vain, illusoire, absurde ou frivole et que, doutant soudain que l’espèce en finisse jamais avec les monstres qui la hantent, j’en reviens aux bonnes vieilles vertus du cordon sanitaire et de l’exclusion. Oui, deux philosophies. Deux systèmes de principes concurrents. Deux visions du monde qui s’affrontent et se contrarient. Si, en toute franchise, j’hésite personnellement à trancher, au moins suis-je convaincu que tel est le cadre du débat — que c’est sur ces bases, et sur ces bases seulement, qu’il conviendrait de l’aborder si l’on voulait, le temps de la réflexion, l’arracher aux tumultes et aux démagogies partisanes.
Ce dont je suis convaincu également c’est que, s’il y a une discussion possible sur les moyens, la tactique, la technique, il n’y en a pas, en revanche, sur le principe même de la répugnance que devraient inspirer aux démocrates les idées de l’extrême- droite ; ce dont je suis certain, c’est qu’ils ont gravement manqué aux règles de la morale, ces caciques de la droite traditionnelle qui, rompant au niveau local les pieux serments qu’ils avaient faits dans un cadre plus global, ont, sitôt l’élection passée, négocié avec le Front national la présidence de leurs régions. Oh ! Je connais leurs raisons, bien sûr. J’entends leurs justifications. Je sais qu’ils vont nous dire — qu’ils nous disent déjà — qu’ils ne pouvaient tout de même pas, en excommuniant Le Pen, faire le lit des socialistes — ni, au nom de grands principes abstraits, perdre complètement le contrôle d’une assemblée de province. Eh bien soit. Admettons. Prenons-les, même, au pied de la lettre. En clair cela signifie qu’il y a des libéraux dans ce pays qui aiment mieux faire le lit de Le Pen que celui d’un social-démocrate et qui sont prêts, quand il le faut et que passe sous leurs narines l’irrésistible fumet des cuisines politiciennes, à troquer leur morale abstraite contre un très concret plat de ragoût — à vendre leur âme et leur vertu au prix, sinon d’une poignée de deniers, du moins d’un maroquin dans la république de Clochemerle. Pardon d’employer les grands mots : mais je crois qu’ils ont, ces libéraux, sali outre leur honneur, celui des électeurs qu’ils étaient censés représenter. Un homme face à eux qui, en refusant l’idée même d’un marchandage, a sauvé et son honneur et sa région : il s’appelle Bernard Stasi. Un autre, qui appartient à l’histoire, pour ne pas dire à la légende et qui renonça, lui, à l’exercice même du pouvoir du jour où il s’avéra qu’il ne le conservait qu’au prix de voix qu’il récusait : il s’appelait Pierre Mendès France. Opposer, donc, ces deux exemples. Les rappeler aussi souvent, aussi bruyamment qu’il le faudra. Histoire, au moins, de se souvenir que la politique n’est pas toujours trafic, magouilles, complaisances — et qu’il est parfois possible de la conjuguer avec l’éthique.
Autant dire que je sors de ces élections législatives plus renforcé que jamais dans ma détermination à tendre la main à ceux que, faute de mieux, j’appellerai les « vrais libéraux ». La droite n’a pas la gale, disais-je. Non, en effet, elle ne l’a pas, quand elle a le visage d’un Stasi, d’un Seguin, d’autres encore — comme ces gaullistes par exemple qui, à l’image d’une Lise Toubon, refusent, dans le domaine de l’art, de céder au poujadisme. Mais toute la question qui se pose alors, tout le problème qu’il faut résoudre et dont dépend, plus que jamais, la figure de notre avenir est de savoir si ce sont ces visages-ci, justement, qui, dans l’actuelle majorité, finiront par l’emporter — ou bien ceux, tellement plus veules, des tartarins qui, par avance, ont accepté de se coucher. C’est leur affaire, dira-t-on ? C’est un peu la mienne aussi. La nôtre. Celle de tous les intellectuels qui, sachant que la politique du pire reste, quoiqu’il arrive, la pire des politiques, estiment de leur devoir de contribuer eux aussi, modestement mais fermement, à l’arbitrage de ce débat. C’était mon propos le mois dernier. C’est mon propos ce mois-ci. C’est ce que je ne me lasserai pas de redire — et de refaire — dans les mois voire les années qui viennent. Et, pour prendre un exemple plus net encore que celui de ce bloc-notes, peut-être est-ce, après tout, ce que j’avais déjà en tête lorsque j’ai, avant même les élections, remis à mon ami Jean-Marie Rouart, pour publication dans Le Figaro, un article dont le principe m’a valu, sur le moment, reproches et incompréhensions. Que le texte en question fût un texte littéraire, n’est certes pas douteux. Et j’aurais mauvaise grâce à ne pas dire que c’est à un « supplément » littéraire de qualité que je l’avais d’abord confié. Reste que si tout ce que j’explique est exact, s’il est vrai que la droite française d’aujourd’hui est à la croisée des chemins que je dis, s’il est vrai qu’elle est traversée par le formidable clivage dont je parle, alors il faut bien admettre que signer dans un journal de droite libérale peut devenir, en toute logique, non seulement normal mais utile. A la fin des années 1970, quand le problème numéro un qui se posait était celui d’un totalitarisme qui étendait déjà son ombre jusqu’au cœur de la gauche modérée, c’était du côté d’un organe, mettons, comme Le Matin qu’était la zone des tempêtes. Au milieu des années 1980, à l’heure où ce problème, sans être bien entendu réglé, perd un peu de son acuité pour laisser la place à celui, tout à coup plus vertigineux, d’une autre tentation qui, tout doucement, à bas bruit mais à coup sûr, commence d’étendre son ravage jusqu’au noyau de la droite traditionnelle, il n’est pas exclu que ce soit de l’autre côté — celui donc, et pour simplifier toujours, d’un organe comme Le Figaro — que soit en train de se déplacer l’épicentre du débat. Ne jamais oublier qu’une bourgeoisie libérale forte, renforcée dans sa mémoire et fière de son identité a toujours historiquement été le meilleur des remparts au fascisme. Ne jamais oublier non plus que c’est son déclin au contraire, son amnésie ou sa démission qui, historiquement encore, et n’en déplaise aux sectaires, ont fait que le fascisme a pu passer.
Voilà, oui. Ça y est. Cette chronique tire à sa fin. Et je suis en train de m’apercevoir qu’hésitant, tout à l’heure, à en consacrer « ne fût-ce qu’un paragraphe » aux aspects les plus nauséabonds de l’actualité récente, j’ai réussi, chemin faisant, à ne parler finalement que de ça. Pas un mot, du coup, du recueil de nouvelles de Grace Paley que j’aurais voulu saluer. Pas un mot du Proust de Léon-Pierre Quint, relu l’autre semaine, où l’on apprend que l’auteur de La Recherche fut le premier grand écrivain obsédé par les médias et la pub. Pas un mot, non plus, ni des eaux-fortes de Rembrandt exposées au Petit Palais, ni des œuvres de Saint Laurent rassemblées bientôt au Musée de la Mode, ni de ce recueil de photos de Richard Avedon, à paraître ces jours-ci, dont il faudra bien que j’aille parler ailleurs. Et à peine me reste-t-il quelques lignes pour dire — d’un mot, vraiment — combien me semble injuste le silence qui se fait autour de La Conspiration de Fiesque, cet admirable texte de Schiller adapté par Saskia Cohen Tanugi au théâtre Gérard Philipe. Mais peut-être est-ce, au fond, la première victoire d’un certain fascisme que de contraindre l’esprit à renoncer à l’essentiel ; peut- être l’a-t-il déjà à demi emporté quand il peut l’assigner ainsi à ses demeures les plus lugubres — alors que la vraie vie, comme d’habitude, était ailleurs.
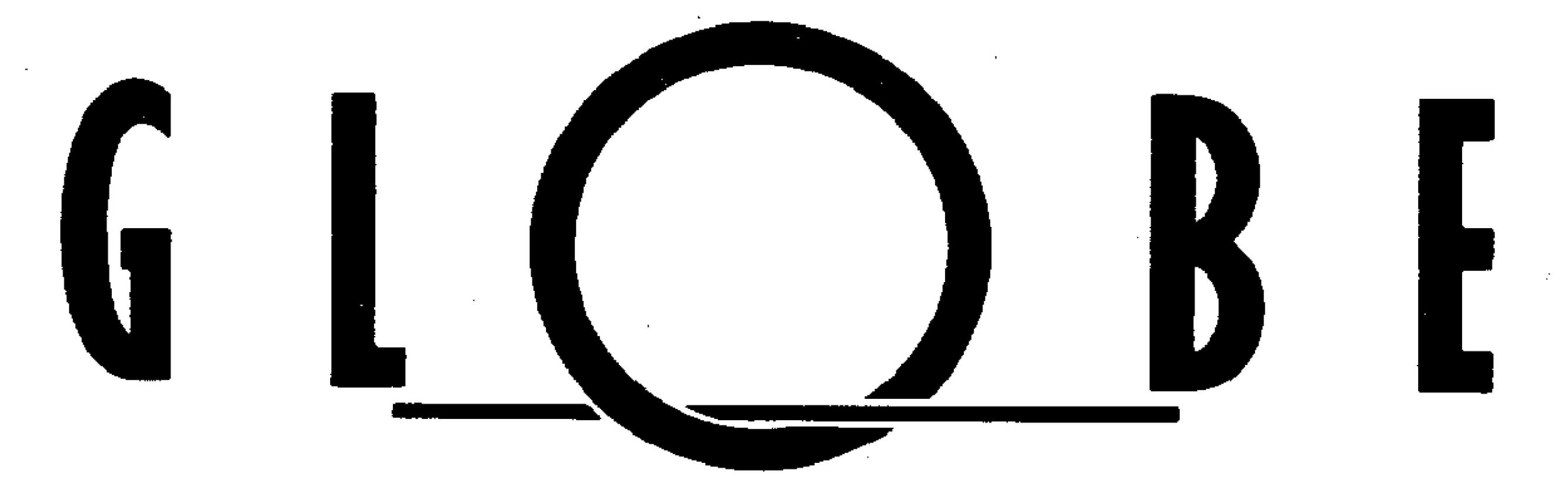
Réseaux sociaux officiels