Bon. Reprenons. Et puisque mes déclarations sur la privatisation de TF1 semblent avoir quelque peu scandalisé, autant mettre les points sur les « i ». Je n’ai absolument pas fait, bien sûr, le procès du service public. Et je n’ai jamais, au grand jamais nié qu’il ait pu être — qu’il demeure, bien souvent — le lieu d’une création, d’une innovation culturelles incomparables. Ce que j’ai dit, simplement, c’est qu’il y a un domaine au moins où l’affirmation de ses principes est archaïque et extravagante : le domaine de l’information. Que dirait-on d’un journaliste de la presse écrite qui se réclamerait du « service public » ? De Libération ou du Monde, s’ils étaient, structurellement, dans l’organisation même de leur capital ou de leurs statuts, des entreprises d’État ? Trouverait-on normal que Serge July, Jean Daniel, André Fontaine, ou d’autres, voient leur statut, leur carrière, leur position même ou leur pérennité mises à la discrétion d’une « Haute Autorité » dépendant du pouvoir politique ? Les directeurs de l’information de nos grandes chaînes nationales me pardonneront, j’espère. Mais quels que soient leur courage, leur compétence, leur sens de l’éthique ou du devoir, c’est dans cette situation que, malgré eux, ils se trouvent ; et je ne vois pas comment diable ils en sortiront sans que l’un d’entre eux — je veux dire une des trois chaînes — échappe au sort commun, s’émancipe de la tutelle et, obéissant à de tout autres règles, entraîne l’ensemble du système. C’est leur intérêt. C’est la nôtre. C’est celui, stricto sensu, de la démocratie.
Un opérateur privé ferait-il mieux, demandent les partisans du service public à tous crins ? Et la tutelle de l’Argent est-elle vraiment préférable à celle de la puissance publique ? Ma réponse c’est d’abord, et n’en déplaise au simplisme environnant, qu’il y a bien évidemment « opérateur » et « opérateur ». Et puis c’est, secundo, que, privatisation pour privatisation, il y a une formule qui, hélas, n’a pas l’air d’avoir été prise au sérieux, alors qu’elle avait à la fois le mérite de la clarté, de la transparence et de l’équité : la formule suggérée par François de Witt, de l’introduction en Bourse du capital de TF1. Sur le fond, en tout cas — et quelle que soit la solution concrète qui sera, au bout du compte, retenue — ma religion est faite : entre l’Etat et la Bourse, je choisis la Bourse ; entre l’intrigue des partis et la vérité des titres, je choisis la vérité des titres ; entre une « voix » de la France qui risque fort, au train où vont les choses, d’avoir pour de longues années l’accent de ce qu’il est convenu d’appeler la droite, et des sociétés de télévision privées, dotées d’un capital privé et susceptibles par conséquent, comme n’importe quelles sociétés privées, de voir leur capital tourner, circuler, changer de mains ou de composition, j’opte pour la seconde démarche. La démocratie est à ce prix. Ainsi que cette part d’« objectivité » que l’on est tout de même en droit d’attendre, dans un pays adulte, d’une information digne de ce nom.
Et la culture, dit-on encore ? La télé publique n’a- t-elle pas, dans ce domaine, fait la preuve de ses vertus ? Oui, bien sûr. Et loin de moi, je le répète, l’idée de refuser à une chaîne qui, dans quelques semaines, et pour ne prendre que cet exemple, diffusera l’intégralité de Shoah, le si beau film de Claude Lanzmann, le privilège de la qualité. Ce que je demande simplement, là encore, c’est que l’on traite avec le même esprit de mesure le cas de la télé privée et que l’on en finisse, au moins, avec l’imbécile argument qui veut que sa logique soit forcément, et en vertu de je ne sais quelle fatalité, celle de la bassesse, de la vulgarité ou de la culture au rabais. On cite parfois, au bénéfice du privé, l’exemple du « Channel 4 » britannique. On pourrait citer, à New York, celui de cette fameuse « treizième chaîne », financée par la fondation Rockfeller et où, de Nam June Paik à John Sanborn, de Kit Fitzgerald à Ed Emschwiller, les artistes américains les plus exigeants, les plus pointus, les plus avant-gardistes, produisent régulièrement des émissions. On pourrait, il faudrait peut-être aussi rappeler que, de la peinture au théâtre, de la littérature au cinéma ou à la musique, bref, dans tous les domaines de la création sans exception, le moteur dominant a toujours été, que l’on sache, celui de l’initiative privée. Aujourd’hui pourtant, je n’ai rien envie de citer du tout. Je ne suis même pas sûr d’avoir envie d’argumenter. Car l’affaire, me semble-t-il, défie tout argument… Elle excède toute espèce de logique… Comme si, dans ce procès de principe que l’on a si étourdiment instruit, se jouaient d’autres combats — plus discrets, moins avouables et qui n’ont qu’accessoirement à voir, en tout cas, avec la question de l’audiovisuel.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Et il est clair que je ne me serais pas engagé si brutalement dans ce débat si je n’avais eu le sentiment que l’on était en train, sous le très convenable pavillon de la « défense du service public », d’essayer de nous refiler une drôle de petite contrebande. Télé-test, si l’on veut… Télé-prétexte… Télé-symptôme et télé-brêche où s’engouffrent toute une foule de thèmes et de concepts que l’on croyait disqualifiés… Il a fallu cette affaire de télé, par exemple, pour que l’on s’amuse à nouveau, comme aux beaux temps de la gauche dite unie, à voir dans l’Argent l’image du grand Satan ; dans l’Amérique, celle du petit Satan ; dans la forme-État, au contraire, le meilleur pourvoyeur de sens et d’idéal ; il a fallu cette affaire de télé pour que, oubliant soudain ce qu’elle avait pu dire, faire ou apprendre pendant ces cinq années d’exercice du pouvoir, une partie de la gauche remette subrepticement à l’honneur quelques-uns de ses vieux démons — avec, en prime, et pour couronner le tout, cette forte thèse que, même en U.R.S.S., personne n’oserait plus proférer sans rire : la preuve que la télé est « à nous », c’est qu’elle appartient à l’État ou à la Sainte Collectivité qu’il représente… En bon français, ça s’appelle une régression. Et on peut, je crois, faire le pari : quelques mois encore de cette « bataille » — et c’est tout un dispositif idéologique qui, de proche en proche, et mine de rien, viendra se reconstituer. Fallait-il vraiment chanter sur tous les tons l’air de la modernité, de l’aggiornamento idéologique ou de la « culture de gouvernement » pour retomber, si vite, dans l’ornière de la gauche jacobine la plus éculée ? Personnellement je dis, j’espère de tout mon cœur que non. Et j’ai bien l’intention, par-delà cet épisode TF1, de trouver d’autres occasions — nombreuses — de le répéter.
D’autant que, sur le fond, et comme à l’accoutumée, le débat est probablement déjà réglé et que l’on voit mal à quoi peut bien rimer la vieille référence jacobine dans l’univers des satellites, des câbles, des espaces géo-stationnaires ou des antennes paraboliques qui feront l’audiovisuel de demain. Il y a des villes américaines où l’on reçoit jusqu’à trente chaînes. D’autres où fonctionnent des systèmes de « free access » qui permettent aux téléspectateurs d’élaborer leurs propres programmes. D’autres où la transmission des images par télex ou téléphone est quasiment monnaie courante. Et même si nous n’en sommes pas encore là, il est évident que nous entrons, nous aussi, dans un monde d’images, de reflets, de reflets d’images ou de reflets de reflets dont il devient de plus en plus hardi de prétendre contrôler la production. Quel est l’Etat qui pourra se targuer de maîtriser ces bombardements d’informations ? A quelle « Haute Autorité » s’en remettra-t-il pour arrêter les flux d’images qui, se jouant des frontières et des nations, en seront le corrélât ? De quel « service public » parlera-t-on le jour, pas si lointain, où nous serons tous pris dans un véritable mouvement brownien d’ondes devenues folles et littéralement déréglées ? Tout cela n’aura, bien entendu, plus grand sens. Et il est permis de se demander si, derrière les beaux discours des vestales de la télévision d’hier, il n’y aurait pas d’abord une formidable réaction de panique devant les manifestations de la révolution télématique en cours.
Que cette révolution pose des problèmes, j’en suis le premier convaincu. Et il est difficile, c’est vrai, d’envisager avec sérénité les processus de décomposition qui sont sans doute à l’horizon de ses fractures les plus brutales. Fellini, au moment de l’attentat contre le pape, a dit de très belles choses sur la « disparition de la réalité » à quoi nous exposait la multiplication soudaine des images. Un autre Italien, Pier Paolo Pasolini à fort justement insisté, lui, sur l’uniformisation des modèles, des codes et des comportements qui pourrait en résulter. Et nous avons un romancier, Guy Scarpetta, qui a bâti toute une fiction, pas si « fictionnelle » qu’elle en a l’air (L’Italie), sur l’idée d’une planète s’épuisant, se dissolvant et, finalement, disparaissant avec les derniers relais hertziens. Devenir-ondes du monde… Devenir-monde des ondes… Exténuation ondulatoire d’une réalité proprement éclipsée par ses signes, ses ombres, ses simulacres ou ses semblants — avec, à l’extrême, la vertigineuse histoire de ces stratèges israéliens de la guerre du Kippour qui, sachant qu’un déplacement de troupes induisait, sur une longueur d’ondes donnée, une vibration particulière, induisirent artificiellement la vibration en faisant l’économie du déplacement… Nul ne sait, encore une fois, que penser au juste de tout cela. Et nul ne sait, surtout, comment conjurer les conséquences, à certains égards effroyables, de ces processus de dissolution. Ce qui est sûr, c’est que les réponses, si elles existent, ne ressortissent certainement pas aux pauvres combats d’arrière- garde menés sous nos yeux depuis quelques jours.
Je ne suis, en ce qui me concerne, ni politique, ni législateur, ni même expert ou technicien de ces affaires. Écrivain en revanche, entretenant un certain type de rapport au symbolique et à la langue, je dis que la télévision moderne m’assigne, en tant qu’écrivain, un certain nombre de défis. Celui d’y intervenir par exemple, d’apprendre à s’en servir : un peu comme l’ont déjà fait, dans d’autres disciplines, des gens comme Wenders (jouant, très tôt, le jeu du petit écran), Warhol (inaugurant, dès 1980, son Andy Warhol’s TV), Bob Wilson (proposant avec son Vidéo 50 ou son Deafman glance, une véritable révolution dans la rhétorique télévisuelle classique). Celui de s’y adapter ensuite, de rendre le style littéraire authentiquement contemporain de celui que propose la mécanique audiovisuelle : un peu comme, en d’autres temps, et toutes proportions gardées ! des gens comme Joyce ou Ezra Pound ont travaillé (mais y ont-ils vraiment « travaillé » ?) à rendre l’effet-littérature contemporain de ce qui apparaissait alors comme le tout nouvel « effet radiophonique ». Celui, enfin, de sauver cet effet- littérature en arrachant à la décomposition générale ce fragment très particulier du réel que sont les mots dont je me sers : ou bien, dit Scarpetta, les romanciers de demain ignorent la révolution dont je parle et se bercent de l’illusion d’être au-dessus ou en dehors — et alors, en effet, la télé les avalera ; ou bien, au contraire, ils traitent cette révolution, l’intègrent, se situent résolument dedans ou sur ses bords — et alors le Livre aura toutes les chances de préserver son éminence. Ces défis concernent, au-delà de moi, tous ceux qui ont le souci de la lettre et de la culture. Puisse le présent débat, si mal engagé soit-il, faire que nous soyons quelques-uns à en ressentir au moins l’urgence.
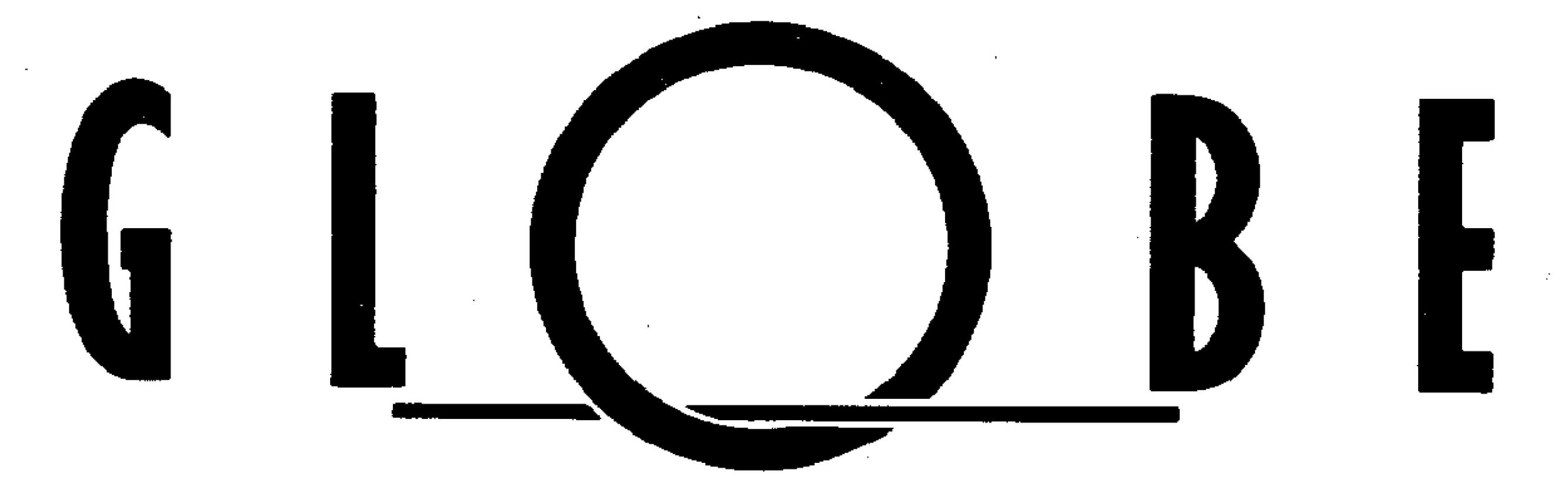
Réseaux sociaux officiels