OLIVIER ZAHM : Vous êtes un des personnages de la scène intellectuelle les plus connus en France et hors de la France. Est-ce un atout ou un problème ?
BERNARD-HENRI LÉVY : Un atout. Quand on croit à ce qu’on fait, quand on veut rendre justice à Daniel Pearl, quand on nourrit l’ambition d’alerter l’opinion sur le sort des massacrés du Darfour ou sur la Géorgie martyre, il vaut mieux jouer les médias que la clandestinité et le silence. C’est évident.
Mais est-ce que le fait d’avoir eu tout de suite beaucoup de succès, comme de polémique, autour de vos textes, ne vous a pas desservi auprès du monde intellectuel ?
Si, bien sûr. Ici, en Amérique, le succès est une vertu ou, en tout cas, un mérite. En France, c’est suspect et même assez détestable. Raison pour laquelle, en effet, je me suis tout de suite, dès 30 ans, mis à dos une large part du clergé pensant parisien.
Trop de visibilité ?
Voilà. Il faut que vous compreniez que la France est un pays où une pensée se porte mieux quand elle est furtive, invisible, presque clandestine. Tocqueville disait que l’Amérique était le pays des « associations ». Mais, en réalité, ne vous y trompez pas : c’est la France qui est le vrai pays des chapelles et des sectes.
Votre formation initiale est la philosophie ; or la philosophie, en France, se fait traditionnellement à l’université.
Aujourd’hui, oui. Mais, en même temps, est-ce que ça a toujours été comme ça ? Descartes n’était pas un universitaire. Ni Voltaire. Ni Malebranche. Ni Spinoza qui polissait et taillait des lentilles de lunettes. Ni, encore moins, Sartre ou Camus qui n’ont jamais enseigné dans quelque université que ce soit. Et je ne parle même pas des Grecs qui pensaient, eux, carrément, que c’était dans la rue que se faisait la bonne philosophie.
Vous avez eu la chance historique d’être étudiant au début des années 70, à un moment où la philosophie se renouvelait de fond en comble. Surtout en France…
J’ai vécu, oui, la fin de ce moment où la France a pris, comme dit Jean-Claude Milner, le relais de l’Allemagne dans le rôle du candidat au Savoir Absolu. On était vingt ans après la défaite du nazisme et l’ouverture des camps. Paul Celan est encore vivant et nous a définitivement convaincus de la corruption profonde, durable, de la langue allemande. Il écrit en allemand, certes ; il continue d’être ce « triste poète de la langue teutonique » qui avait donné, en 1945, son célèbre Todesfuge, ce long poème sur l’extermination qui prétendait dire la mort dans la langue même des assassins ; mais justement ; la mort seulement ; l’allemand devenu la langue, non du Savoir, mais du Deuil ; et c’est en français qu’il chante, en 1968, dans les rues de Paris, L’Internationale – et ce au moment même où c’est en français, dans une langue française devenue, comme l’allemand de Hegel, la langue par excellence du Sujet épris de Vérité, que se dit la volonté de savoir…
Et c’était enthousiasmant pour le jeune homme que vous étiez ?
Évidemment ! C’est rare, les moments comme ça. Il y a eu le moment grec. Il y a eu, donc, le moment allemand autour de l’hégélianisme. Et il y a eu ce moment français, ce passage de relais à la langue française, à travers ce qu’on a appelé le structuralisme.
Vous avez été un étudiant brillant (École normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégation de philosophie), remarqué des professeurs, en particulier d’Althusser, et tout d’un coup vous ne choisissez pas une voie universitaire, vous désertez…
Je ne déserte pas. Je fais un pas de côté. C’est bizarre cette manie qu’ont les gens de croire que c’est la continuité qui est louable, désirable, préférable. Vous savez bien : tout le côté « il faut être fidèle, absolument fidèle – à sa tradition, à sa famille, à sa classe, à ses idées, etc. » C’est idiot. C’est le niveau zéro de l’activité de l’esprit. Si vous voulez vraiment penser, chercher la vérité, avancer, il vous faut tourner le dos aux clichés, aux idées toutes faites – y compris celles qu’ont faites des gens que vous aimez et y compris, parfois, celles que vous avez faites vous-même et qui sont vos propres idées. C’est le mot d’ordre sartrien : penser contre soi-même. C’est sa formule : se casser les os de la tête. C’est cet autre « beau mandat », le mandat d’infidélité, dont il nous fait obligation.
C’est alors, avec le scandale, en 1977, de La Barbarie à visage humain que vous dénoncez, parmi les premiers, l’idéologie marxiste dominante. Et ce, tandis que quasi tous les philosophes étaient à gauche…
Mais je l’étais aussi, à gauche ! Et je le suis toujours. Vous aviez – vous avez – deux façons de dénoncer le marxisme. Soit : « ouh là là ! ces gens sont des fauteurs de troubles ! ils menacent l’ordre établi ! ils gênent le doux sommeil des puissants » – c’était la critique de droite. Ou bien : « ces gens sont des tyrans ! des hommes de discipline et d’ordre ! le vrai problème du marxisme c’est que c’est une machine à fabriquer du consentement, de la soumission, de l’esclavage ! » – et c’était ma position. J’en voulais, non pas exactement au marxisme, mais au progressisme. Et, si je lui en voulais, c’est parce qu’il dit aux gens qui souffrent : « ne bougez pas ; ne vous révoltez pas ; l’Histoire travaille pour vous ; elle vous libère à votre insu ; vous n’avez qu’à vous laisser porter – et vous verrez comment la main invisible de la dialectique finira par vous affranchir… ». C’est ça, le progressisme philosophique. Et c’est pour ça qu’il est hideux.
Et, en même temps, dans ces années où vous dites non au marxisme, vous ne tombez pas dans l’apologie du libéralisme, d’un état du monde réglé par une injustice grandissante…
Si vous voulez, oui. Car c’est la même chose. La même idée d’une main invisible qui agirait dans le dos des hommes et leur demanderait, en attendant, de s’accommoder des désordres du monde. Pour les uns, la main invisible c’est celle de la dialectique prometteuse d’une société sans classes. Pour les autres, c’est le marché et son supposé talent pour harmoniser les intérêts, les passions, contradictoires. Dans les deux cas, on dit aux hommes de rester sur la banquette arrière, de se laisser rouler et porter – car la main invisible travaille pour eux.
Ce qui est frappant, aussi, chez vous, c’est que vous allez sur les terrains de conflit les plus périlleux : très jeune en Afghanistan ou au Bangladesh ; puis en Bosnie ou dans les guerres d’Afrique ; ou encore sur les traces de Daniel Pearl. Pourquoi ?
Il y a des tas de raisons. Des raisons avouables et inavouables. On commence par celles que vous voulez…
Les avouables ?
Une révolte instinctive face à la souffrance, la détresse, l’injustice. Héritage paternel, je pense : à 18 ans, mon père part s’engager, en Espagne, dans les Brigades internationales.
Et les inavouables ?
Le goût de l’aventure, j’imagine. Le goût, aussi, de faire des choses que les autres ne font pas.
Est-ce que ce n’est pas, aussi, un peu suicidaire de retourner sur les traces d’un Daniel Pearl ? J’ai l’impression que vous ne prenez pas beaucoup de précautions.
Je pense, au contraire, que c’est un devoir – vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres… – de prendre des précautions quand on fait des choses comme ça. Cette enquête au Pakistan, je n’ai pu la mener que parce que j’ai caché, au mépris de toutes les déontologies chères au journalisme américain, son objet véritable. Le jour où les Pakistanais ont compris, le jour où ils ont réalisé que j’étais sur la trace de ce savant pakistanais qui vendait ses secrets nucléaires à la Corée du Nord, à la Libye et peut-être à Al-Qaïda, j’ai commencé à faire très très attention.
Dans un livre comme celui-là, êtes-vous plutôt reporter philosophique ou philosophe journaliste ? Comment mêlez-vous le subjectif et l’objectif ?
La règle est simple. Quand le fait est connu, ou connaissable, je m’y tiens. Quand il est inconnaissable, c’est-à-dire quand je décide, par exemple, de reconstituer le monologue intérieur de Pearl ou de son assassin au moment décisif de la mise à mort ou du kidnapping, c’est l’imagination qui, par définition, reprend ses droits. Vous autres, Américains, connaissez ça très bien. C’est la méthode de Norman Mailer dans son livre sur Oswald. Ou celle de Truman Capote dans De sang-froid.
Vos modèles ?
Disons : mes modèles américains. Avec, dans un autre genre, mais toujours en Amérique, Paul Bowles.
Que vous avez connu ?
Assez bien, oui. Dans les dernières années. A Tanger. Il habitait une sorte de garage. N’en pouvait plus de tous les cons qui venaient lui parler d’Un thé au Sahara. Et était persuadé que c’est par erreur qu’il était devenu romancier – que son vrai talent, son grand œuvre, c’était la musique.
Vous voulez donc voir, vous voulez être témoin physique, oculaire des conflits et des drames…
Oui. Car à quoi bon penser si ce n’est pour essayer de penser, de voir donc de penser, ce que le monde fait tant d’efforts pour vous cacher ?
Par exemple ?
Par exemple ce que j’ai appelé les « guerres oubliées ». Ces guerres où on meurt en vrac, en tas, en très grand nombre, dans l’indistinction. Ça, pour moi, cette inégalité entre les hommes qui ont droit à leur mort et ceux qui n’y ont pas droit, entre ceux qui ont droit à une sépulture et ceux qui meurent sans que leur mort soit consignée où que ce soit, c’est le plus grand des scandales, c’est la plus scandaleuse des inégalités. Je le dis souvent à ceux de mes amis qui, en Europe, militent pour la cause palestinienne. Chaque fois qu’un Palestinien – ou, d’ailleurs, un Israélien – meurt, c’est horrible. Mais il a droit à des funérailles, à une tombe, à une place dans la mémoire des survivants. Alors que vous avez des situations – le Darfour, le Rwanda, ou même la Colombie – où vous n’avez rien de tout ça et où les morts sont sans visage et, littéralement, sans nombre. Des vies minuscules qui débouchent sur une mort imperceptible : pour le philosophe que je suis, l’essence même du tragique…
Vous allez enquêter du côté de la victime ; mais ce qui me semble unique dans votre position d’intellectuel, c’est que vous allez aussi à la rencontre du terroriste. Alors que le terroriste, aujourd’hui, n’a globalement pas droit au chapitre et encore moins à la parole – il est considéré d’emblée hors du jeu politique, hors la loi…
Je pense, moi aussi, qu’il est hors la loi et qu’il n’a aucune légitimité. Mais je sais, en même temps, qu’il existe. Et je pense donc qu’il faut lui parler : non pour engager le dialogue car, pour les terroristes sérieux, c’est malheureusement peine perdue ; mais pour savoir comment ça fonctionne dans leur tête et, donc, pour mieux les combattre. Il y a là, si vous le permettez, une vraie faiblesse de la pensée américaine d’aujourd’hui, une vraie défaite : cette incapacité à s’intéresser à l’intelligence du Mal…
Votre sujet, c’est donc le Mal ?
Peut-être, oui. Aller regarder de près comment ça marche le fascisme. Comment ça raisonne une brute poutinienne au lendemain du jour où elle s’est amusée, pour rien, presque gratuitement, à détruire la ville de Gori, en Géorgie. Entrer dans la tête, non seulement de Daniel Pearl, mais de l’autre « héros » de mon livre, son antihéros, Omar Sheikh, ce citoyen britannique, formé aux meilleures écoles, issu d’une famille quasi laïque, intégré dans la société anglaise, et qui devient ce criminel.
C’est ça un intellectuel engagé ? C’est d’aller physiquement rencontrer et comprendre comment la partie adverse dysfonctionne ?
C’est deux choses. C’est tenter d’abord, je vous le répète, de rendre un visage et un nom aux suppliciés – surtout quand ils sont anonymes. Mais c’est aussi faire l’autre voyage, le plus long, celui qui m’amène dans la cervelle de leurs bourreaux.
Comprendre les raisons du terroriste ne justifie pas la barbarie de ses actes, mais en même temps, cela lui donne une humanité – et ce n’est pas la façon dont les Etats dits « démocratiques » traitent aujourd’hui les terroristes.
Eh bien ils ont tort. Là aussi, c’est une chose qui me désespère quand je parle avec un conservateur américain. Je me dis toujours : « mon pauvre garçon ! tu ne peux pas gagner contre des gens que tu ne reconnais même pas comme des humains ; ils te baiseront ; they will fuck you ! »
Ce qui me plaît dans votre position, c’est que vous n’avez pas peur. Vous allez du côté de l’adversaire et vous lui parlez.
Je vais surtout le combattre. Car je vous répète que je ne crois pas tellement au dialogue. Je suis trop nietzschéen pour ça. Trop convaincu que les gens ont des positions qui correspondent à un être-au-monde très profond…
Et indéracinable…
Pas justiciable, en tout cas, d’une sage argumentation rationnelle. C’est la leçon de la philosophie grecque. C’est l’échec de Socrate face à Calliclès dans le Gorgias. Socrate se rend compte qu’il a beau expliquer à Calliclès que ce n’est pas bien d’être méchant, l’autre lui répond en substance : « je m’en fous ; j’ai une passion fondamentale qui est la méchanceté ; c’est mon désir ; c’est comme ça ; et j’irai, par principe, au bout de ce désir et de ce ça. » Il faut avoir une conception combattante, guerrière, de la philosophie et de la pensée. Calliclès, tous les Calliclès du monde, nous contraignent à avoir cette conception combattante, guerrière, de la pensée.
Une guerre pacifique ?
Oui, bien sûr. Mais une guerre quand même. Prenez l’exemple de l’antisémitisme. Il ne faut pas s’imaginer qu’on va aller voir les antisémites pour leur expliquer gentiment qu’ils font fausse route. Il faut faire front. Lutter pied à pied. Sans doute pas les dissoudre, les faire disparaître – mais les faire reculer, les contenir, les tenir en respect. C’est ça la philosophie. C’est un art, pacifique, de la guerre. Encore que…
Oui ?
Encore que je ne suis pas, non plus, un pacifiste professionnel. Je pense, comme Hemingway, ou mon père, qu’il fallait se battre, en Espagne, entre 1936 et 1938. Je pense – et j’ai plaidé pour cela – qu’il fallait, dès 1992, mettre les fascistes serbes hors d’état de continuer à faire des cartons sur les enfants de Sarajevo. Et je n’exclus nullement que des circonstances de ce genre puissent se présenter à nouveau, dans l’avenir.
Le modèle que vous incarnez, celui de l’intellectuel engagé médiatique, n’existe guère ici, outre-Atlantique. Pourquoi ?
Je ne suis pas tout à fait de votre avis. Regardez quelqu’un comme Christopher Hitchens. Il fonctionne comme un « public intellectual » à la française.
Et est-ce que les intellectuels ont l’influence qu’on dit ?
Ils sont courtisés. Il n’y a pas de campagne présidentielle, en France, où tous les grands candidats ne battent le rappel des intellectuels pour essayer d’obtenir leur soutien. De vous à moi, je trouve cela bien excessif.
Parlons de ce que signifie être encore de gauche aujourd’hui – thème que vous abordez dans votre dernier livre, Ce grand cadavre à la renverse, qui vient d’être traduit en anglais. Est-ce une question spécifiquement française, ou est-ce que cela s’entend aussi aux États-Unis ?
Cela s’entend aussi aux États-Unis. Là aussi, on voit bien le partage entre ceux que l’injustice fait souffrir et ceux que l’injustice fait sourire. Entre ceux qui pensent que l’injustice est un scandale sans doute insoluble, mais un scandale quand même – et ceux qui pensent qu’elle est dans l’ordre des choses.
C’est cela le partage, pour vous, entre être de droite et de gauche ?
Oui. Avec, dans ce pays, des paradoxes intéressants. Ces gens – la droite américaine – sont, par exemple, créationnistes, donc antidarwiniens et hostiles, en tout cas, à l’entrée de la pensée de Darwin dans les écoles. Mais sortez de l’École, entrez dans la vie professionnelle et sociale, voyez les solutions proposées pour traiter de la pauvreté, des prisons, du système de santé : les mêmes deviennent adeptes de la loi du plus fort, donc de la sélection, donc de ce qu’il faut bien appeler le darwinisme social.
Pourquoi, dans ce cas, est-ce à la gauche que vous vous en prenez ? Pourquoi est-ce elle, le « grand cadavre à la renverse » ?
Ça dépend. J’attaque la droite quand il me semble nécessaire d’attaquer la droite. Et je vous signale, d’ailleurs, que le livre auquel vous faites allusion n’est pas spécialement tendre avec le Président français Nicolas Sarkozy. Après, la gauche est ma famille. Et cette famille est menacée par des démons terribles qu’il faut bien dénoncer aussi, et que l’honneur d’un homme de gauche est de dénoncer de l’intérieur : tous ces démons dont nous venons de parler – plus d’autres, comme le différentialisme ou même l’antisémitisme.
L’antisémitisme ?
Naturellement. C’est une des thèses du livre. S’il veut être crédible, s’il veut fonctionner efficacement, s’il veut faire masse ou se donner une chance, tout au moins, de soulever un jour les masses, l’antisémitisme n’a pas le choix : il ne peut que puiser dans l’arsenal de la gauche. C’est pourquoi il passe, désormais presque toujours, par l’antisionisme, par la concurrence des victimes, ou par le déni de l’Holocauste – ce crime extrême, comparable à aucun autre, que le progressisme traditionnel n’a jamais su intégrer à la table de ses catégories mentales et qu’il a donc une tendance naturelle, sinon à nier, du moins à banaliser ou minimiser.
Et la gauche différentialiste ? Qu’est-ce que vous entendez par là ?
Les gens qui n’ont rien compris à la tolérance. Rien à la justice. Et qui, sous le drapeau d’une tolérance et d’un souci de justice compris de travers, nous expliquent qu’il faut accepter toutes les pratiques de toutes les civilisations – y compris la lapidation des femmes adultères ou l’excision des petites filles.
Un autre exemple ?
Le Darfour. Vous avez, aux États-Unis comme en Europe, une catégorie de progressistes, « left in dark times », qui, au nom de l’héritage anticolonialiste, au nom du préjugé selon lequel un Etat récemment décolonisé ne saurait être criminel, refusent de condamner le Soudan. Quoi, disent-ils, l’horrible Amérique, cette Amérique impérialiste, kissingérienne, raciste ou post-raciste, prétendrait donner des leçons de conduite à un pays du Tiers-Monde ? Inacceptable.
On vous dit antiantiaméricain…
On peut penser ce qu’on veut de l’Amérique. On peut être horrifié par l’état de ses prisons, la misère de certains quartiers de ses villes, le niveau de la pauvreté qui y règne. Mais l’antiaméricanisme, c’est-à-dire la détestation de l’Amérique comme telle, sa transformation en une catégorie métaphysique incarnant tout le mal du monde, est un de thèmes de prédilection du fascisme. Voyez Maurras en France. Heidegger en Allemagne. Les islamistes radicaux aujourd’hui. C’est un fait.
On vous voit de plus en plus souvent à New York.
Je m’y sens bien.
A quoi tient ce succès – rare pour un intellectuel français aux États-Unis ?
Je ne sais pas. Peut-être au fait que j’aime vraiment ce pays et que les gens le sentent. J’aime ses valeurs, son style de vie, son rapport à l’espace et au temps, le sens de la mobilité qu’on y trouve, son cosmopolitisme – et tant d’autres choses encore.
Vous voulez dire que l’Amérique serait le pays qui convient le mieux au philosophe-reporter errant que vous êtes, incapable de vraiment se fixer quelque part, toujours entre deux avions et deux points ?
On peut dire ça comme ça, oui. Cet éloge de la contradiction, de l’infidélité à soi, dont je vous parlais tout à l’heure, s’il y a bien un endroit où il a son sens, c’est ici, en Amérique.
Et c’est stimulant pour vous ?
Vous connaissez la définition sartrienne du « bourgeois » ou du « salaud » ? C’est celui qui est fixé à sa place. Qui y adhère. Qui croit qu’il est là par on ne sait quel décret naturel ou fatal. C’est celui qui ne doute pas une seule seconde de sa légitimité ontologique. Eh bien l’Amérique c’est le contraire. C’est le pays où personne n’est jamais à sa place…
Peut-être apprécie-t-on aux USA ce qui peut énerver en France : un intellectuel de haut niveau doublé d’une vie glamour (femme actrice, grands hôtels, voyages incessants et fortune personnelle) ?
Je ne sais pas. Mais c’est vrai que vous avez, en France, ce satané et ridicule rapport à l’argent. L’argent maudit. L’argent coupable. L’argent qui vous disqualifie. En Amérique, pays protestant, vous n’avez pas cela.
J’ai l’impression, en vous écoutant, qu’être de gauche c’est s’intéresser à la politique étrangère et pas trop aux problèmes de proximité, au prix du baril de pétrole, au pouvoir d’achat, à l’insécurité…
Il y a là deux choses. S’intéresser à l’insécurité et au pouvoir d’achat, il y a des tas de gens qui le font, et très bien – alors que raconter ce qui se passe au Sri Lanka, sanctifier le nom de Daniel Pearl, aller voir les nazis colombiens dans leur repaire ou, encore, créer Action contre la faim, ça il n’y a pas trop de monde pour s’y coller. Et puis que voulez-vous ? J’ai 60 ans dans quelques semaines et il y a un point, au moins, sur lequel je n’ai jamais varié : je suis aussi soucieux du monde, attentif à l’altérité extrême, bref, internationaliste, que quand j’étais marxiste-léniniste.
Vous l’avez été ?
Oui, bien sûr. Et l’internationalisme est l’un des rares pans de l’héritage auxquels je reste fidèle.
Aux États-Unis comme en Europe ?
Aux Etats-Unis comme en Europe. C’est la force d’Obama. Il a – enfin – compris que la politique ce n’est pas seulement la fermeture du puits de mine dans l’Ohio ou la question des subventions agricoles aux producteurs de maïs du Minnesota – mais que c’est aussi le désir du monde chez les jeunes Américains d’aujourd’hui.
Parlons de votre vie plus personnelle. Comment faites-vous pour combiner plusieurs vies ? Cette vie d’aventures périlleuses au bout de la planète. Et, de l’autre côté, une vie très privilégiée, des grands hôtels, des villas. N’y a-t-il pas un côté schizophrénique de votre personnalité ?
Sans doute, oui… Et pourquoi pas ? Au nom de quoi un intellectuel devrait-il renoncer aux délices de la schizophrénie et, au passage, aux voluptés de l’existence ? Je ne suis pas un anachorète. Je suis un être de chair. Et j’aime, réellement, physiquement, cette idée de la multiplicité des vies. D’ailleurs dans mon nom, en français, on entend cette schizophrénie, cette aspiration à plusieurs vies, dont vous parlez. Lévy, c’est Lévy. Mais c’est aussi « les vies »…
Mais vous passez d’un extrême à l’autre…
C’est vrai.
Et cela du jour au lendemain…
C’est vrai. Et je ne nie pas que, parfois, ça donne le vertige. La Bosnie, par exemple. Ça a duré quatre ans. Et, chaque fois, sortant en quelque sorte de l’enfer, la tête pleine d’images abominables, de scènes inoubliables, d’amis blessés ou morts, je rentrais dans le cadre privilégié qui est le mien. Grande culpabilité. Sentiment d’une dette inextinguible. Et rage redoublée. Il y a d’ailleurs une anecdote… Je ne sais pas si je peux la raconter…
Mais si !
On est en juin 1993. Le 19, je dois me marier, à Saint-Paul-de-Vence, dans le cadre en effet enchanteur de la Colombe d’Or. Et il se trouve que, dans les semaines qui précèdent, je me trouve à Sarajevo. Or, malchance. Au moment où je commence à penser à me rapatrier, les Serbes ferment l’aéroport et interrompent le pont aérien qui était le seul minuscule cordon qui reliait Sarajevo au monde extérieur. On est le 12… Le 13… Le 14… On arrive à la veille du 19. Et je m’aperçois avec horreur que je vais rester bloqué dans cette ville de cauchemar. Vous savez qui m’a sauvé ? François Mitterrand. Nous étions fâchés. A cause de la Bosnie justement. Mais j’ai pris mon courage à deux mains. Et je lui ai téléphoné pour lui demander, au nom du bon vieux temps, des complicités enfuies et envolées, de m’aider à trouver une solution. Ce qu’il a fait.
Comment ?
Un vol humanitaire qui, le matin du 18, au terme de tractations dont je n’ai jamais su le détail, a enfin été autorisé à décoller et est allé se poser à Toulon. J’ai pu me marier en temps et en heure. Et c’est vrai que j’ai touché là du doigt le « grand écart » entre les deux rives de mon existence.
Vous êtes un travailleur infatigable. Est-ce que c’est vrai que vous dormez quatre heures par nuit ?
Oui. Même quand je vis, je travaille. Et même quand je travaille, je vis. Vous connaissez la phrase de Mallarmé : « le monde est fait pour aboutir à un beau livre. » Eh bien c’est un peu ce que je pense. Je fais partie de cette catégorie de gens pour qui la vie n’a d’intérêt que si elle nourrit les livres, que si elle se traduit en écriture, que si elle se traduit en mots.
C’est quand même la voie la plus difficile. Tous les écrivains se plaignent de la dureté, de la peine qu’est l’écriture.
Ça dépend. L’imaginaire d’un artiste, c’est comme un puits artésien. Il y a des moments où la baguette du sourcier a touché au bon endroit et, là, ça sort très vite. Et puis il y a des moments où c’est le contraire et où vous ne tirez que du plomb, ou de la boue.
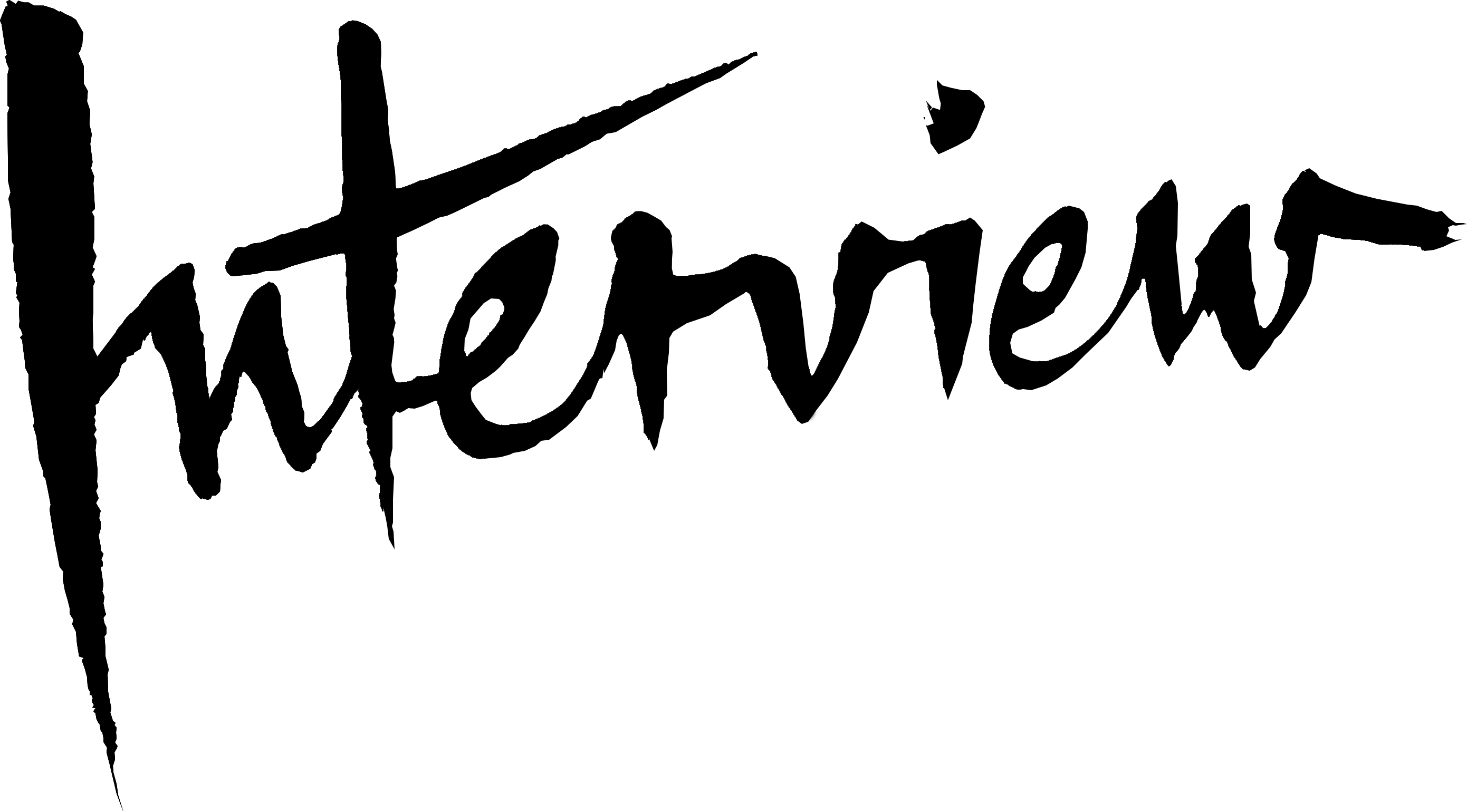
Réseaux sociaux officiels