Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce projet ?
C’est Francesco Vezzoli qui est venu me trouver. Il venait de lire American Vertigo. Et il a demandé à François Pinault, le célèbre collectionneur et propriétaire du Palazzo Grassi, à Venise, d’organiser le contact. Au début, j’ai trouvé l’idée étrange. Et puis elle m’a séduit, comme une sorte de prolongement de ma propre réflexion sur les ressorts de la démocratie américaine.
Avez-vous été impliqué dans la conception, l’écriture, de ce film ?
Dans la conception, non. Dans le texte que je prononce, en revanche, oui. L’équipe de professionnels qui sont venus me voir, qui ont fait, comme vous savez, la campagne de John Kerry et qui feront, selon toute vraisemblance, la campagne du prochain candidat démocrate, m’ont proposé un texte qui ne me convenait pas et que j’ai donc complètement récrit. Sous leur contrôle, certes. Mais complètement récrit. Pourquoi il ne me convenait pas ? Le ton, où j’avais du mal à entrer. Et, aussi, le contenu qui, dans mon souvenir, était presque exclusivement consacré à l’Irak. Alors que je souhaitais, moi, parler aussi de la peine de mort, des armes de guerre en vente libre, du système de santé et du système des prisons.
Le personnage de Sharon Stone est assez hillary-clintonesque. Pensez-vous que c’était là le modèle ? Ou, peut-être, Ségolène Royal ? Ou Nancy Pelosi ?
J’ai l’impression, oui, que le modèle était Hillary. Une Hillary républicaine, mais une Hillary quand même. Est-ce que cela veut dire que, pour Vezzoli, Hillary est une républicaine qui s’ignore, une républicaine à visage démocrate ? Peut-être. Je ne sais pas. Si c’est ce qu’il pense, il n’a pas forcément tort.
Et vous, jouez-vous votre personnage en songeant à un candidat américain particulier ? Ou à Sarkozy ? Votre prestation est-elle une sorte de commentaire de l’américanisation de la vie politique en Europe ?
Le candidat que je joue est, comme vous savez, supposé être démocrate. Alors, non, je n’avais pas Sarkozy en tête. Pas du tout. Ni d’ailleurs aucun candidat français. Ce que je peux vous dire, par contre, c’est qu’il y a eu cette coïncidence : au moment même où je faisais ce film, je voyais assez souvent Ségolène Royal et nous parlions de sa propre campagne. Et ma réflexion a plutôt été celle-ci : quel dommage que Madame Royal n’ait pas eu, pour l’aider, la conseiller, la piloter, des hommes et des femmes du niveau de ceux que m’a amenés Vezzoli et qui sont au cœur de la vie politique américaine ! Dit autrement : je ne serais pas contre un peu d’américanisation de la vie politique de mon pays ! Quand je vois l’amateurisme des conseillers de nos candidats, quand je vois la médiocre qualité de l’entourage de Royal (qui était, elle, une bonne candidate), je me dis : vivement un peu d’américanisation !
A quoi sert une œuvre comme celle-ci ? Politiquement ? Quel est son public ?
Le public de cette œuvre, c’est d’abord les collectionneurs et amateurs d’art. Mais je pense en même temps que cette œuvre, comme toute œuvre d’art, nous dit des choses sur ce dont elle traite, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la chose politique. Par la parodie et l’ironie, elle en explore la coulisse. Elle nous raconte l’envers du décor. Elle montre comment marche une campagne, quels en sont les ressorts secrets. Et, du coup, elle a une vraie puissance de subversion. C’est la force des grands artistes.
Allez-vous vous investir dans l’élection en cours ? Ecrire dessus ?
M’investir ? Certes non. Ecrire. Sûrement. Peut-être aussi revoir Barack Obama que j’avais rencontré, comme vous savez, pour American Vertigo.
Dans ce film, vous portez une cravate. Quand cela vous était-il arrivé pour la dernière fois ?
Il n’y a pas de dernière fois. Je n’ai jamais, de ma vie, porté de cravate. Ni pour mes mariages, ni pour des enterrements, ni pour aller voir le pape, ni pour déjeuner à l’Elysée, ni pour rien – ce fut vraiment, là, la vraie de vraie première fois. Au point, d’ailleurs, que quand, au milieu de cette fameuse journée, les gens de Charvet – qui font mes chemises – ont reçu la visite d’une assistante venant chercher « des cravates pour Bernard-Henri Lévy », ils ont cru à une blague, à une émission de la caméra cachée, que sais-je ? et ont commencé par refuser de les donner… Est-ce que cela veut dire qu’un grand artiste peut me faire faire des choses qu’un président de la République n’obtiendrait pas de moi ? Il faut croire.
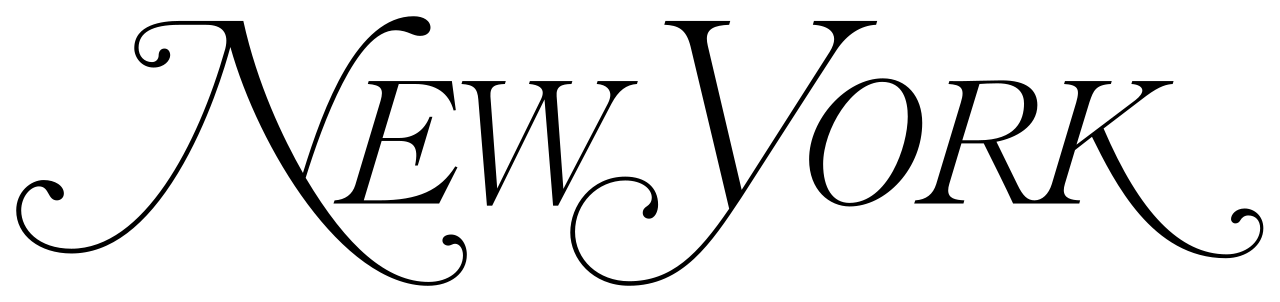
Réseaux sociaux officiels