Émile Malet : Après avoir soutenu François Mitterrand, vous voilà, Bernard-Henri Lévy, dans Questions de principe (Ed. Denoël), qualifiant le régime du 10 mai 1981 comme « le plus authentiquement réactionnaire que nous ayons connu depuis Vichy ». Que s’est-il donc passé en France ces derniers dix-huit mois pour justifier pareil jugement ?
Bernard-Henri Lévy : Ce qui s’est passé ? Eh bien ! Dix-huit mois de régime simplement. C’est-à-dire dix-huit mois de régression. Dix-huit mois d’archaïsme, à mon avis sans précédent. Et dix-huit mois où j’ai vu triompher, jour après jour, quelques-unes des idées qui m’écœurent le plus. Je suis effectivement de ceux qui, le 10 mai, ont voté pour Mitterrand ; et il est de fait qu’aujourd’hui, presque deux ans après, je me sens terriblement déçu.
Je n’avais pas prévu que ça aille si vite. Ni si loin. Ni aussi profond dans la sottise et le ringardisme. Prenez un exemple que je connais bien. Celui de la politique culturelle. Je m’attendais à beaucoup de choses. Mais certainement pas à cette débauche d’ignorance. De poujadisme satisfait. De bienpensance affichée. Ou de populisme débile, sur fond de retour des bérets, des bourrées, des binious. Jack Lang est, à mon avis, le ministre le plus décevant que nous ayons jamais eu. Et ce n’est pas un hasard si tous les grands artistes, les grands créateurs de ce pays semblent s’être donné le mot pour bouder une politique qui leur ressemble si peu.
E. M. : Vous pensez qu’il y a un divorce entre l’intelligentsia de gauche et le régime ?
B.-H. L. : Nous sommes dans une situation exactement inverse de celle du Front populaire : la « gauche » est au pouvoir et il n’y a pas un grand intellectuel de gauche, bizarrement, pour lui accorder son soutien.
E. M. : Mais pourquoi évoquer Vichy à propos du régime socialiste actuel ?
B.-H. L. : Parce que c’est là qu’il puise, à mon avis, l’essentiel de son inspiration. L’anti-américanisme primaire du brave Lang, par exemple, vient en droite ligne de là. De même ces éloges insistants d’une « latinité » culturelle qui n’a de sens, en France, que dans le contexte de la théorie maurassienne. De même cette apologie lourdingue de la France des terroirs, des régions, des folklores, dont vous savez, comme moi, les nauséabonds parfum. Ou de même, encore, les grandes lignes d’une politique industrielle dont il serait facile de montrer qu’elle renoue discrètement avec l’esprit « corporatiste » qui prévalait il y a quarante ans, au temps de la Révolution nationale. Écoutez donc. Regardez autour de vous. Humez le vent qui nous vient des hauteurs du nouvel État français. Ne trouvez-vous pas que tout ça fleure bon le pétainisme ressuscité ?
Le pétainisme, vous savez, n’a jamais été vraiment exorcisé dans ce pays. Je ne suis pas très surpris qu’il nous revienne quarante ans après, et de ce côté-là du spectre politique.
E. M. : Le discours socialiste ne serait-il pas un discours de gauche ?
B.-H. L. : Prenez le cas des immigrés. C’est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Or il est tout de même incroyable qu’il ait fallu attendre un gouvernement dit de « gauche » pour que la xénophobie soit le fondement de la politique officielle de l’État ! Pour que la France des beaufs et des salauds se sente enfin justifiée dans ses répulsions séculaires ! Bref, pour que, à coup d’expulsions, de visas d’entrée et de sortie, des petites allusions assassines distillées au détour des fins de banquets officiels, le racisme retrouve officiellement droit de cité dans la France des droits de l’homme !
E. M. : Cette politique « réactionnaire » reste néanmoins exercée par un gouvernement qui tient comme à la prunelle de ses yeux à son ancrage de gauche.
B.-H. L. : C’est possible. Mais ça ne change rien à la réalité. Ne vous êtes-vous pas demandé pourquoi ses mesures réputées les plus « à gauche » passent finalement si bien dans un pays dont chacun connaît le vieux fonds conservateur ? Eh bien ! Je pense que c’est parce qu’il sait jouer sur ce fonds. Qu’il en fait vibrer comme personne les cordes les plus sensibles. Qu’il s’entend merveilleusement à flatter ses instincts les plus bas ou les plus débiles. Et que, finalement, il s’exprime dans la langue de la vieille droite nationale jusque, et y compris quand il prétend faire du progressisme. Rompre avec le capitalisme tout en s’abritant derrière les thèmes les plus fascinants du vieux fonds français : voilà le secret du régime ; la clef de son succès ; celle, peut-être, qui lui permettra de durer…
E. M. : Pour être plus précis, à qui pensez-vous ?
B.-H. L. : L’exemple type c’est Jean-Pierre Chevènement. Voilà un homme viscéralement réactionnaire. Qui a fait ses classes dans les marges de l’Algérie française. Dont tous les propos, aujourd’hui, portent la marque de cette origine. Et qui ne dédaigne pas, à l’occasion, de se lancer dans des apologies douteuses du « soldat français », de la « fibre nationale » ou des hommes politiques capables de « rassembler tout ce qui est fort et sain »… Croyez-vous que ça la gêne ? Au contraire ça l’aide. Ça lui permet de rassurer les gogos. Ça lui donne son image d’homme d’État responsable. Et c’est sous ce pavillon « droitier » qu’il arrive à faire passer sa contrebande « gaucharde »…
E. M. : Mais au-delà de Chevènement, et en entrant dans le concret de la politique gouvernementale, où opère ce virus néopétainiste ?
B.-H. L. : Partout, j’en ai peur. Savez-vous par exemple, que c’est Edouard Drumont, le pamphlétaire antisémite bien connu, qui est, dans notre pays, l’inventeur de l’idée de nationalisation ? Croyez-vous que les thèmes démagogiques du type « faire payer les riches » seraient si bien passés s’ils n’avaient trouvé un répondant dans la bonne vieille tradition poujadiste de la haine des « gros » et des « ploutocrates » ? N’entendez-vous pas comme, derrière les attaques apparemment de gauche contre les trusts et les multinationales, revient l’écho des factieux de 1930 vitupérant la « finance cosmopolite » ? Et imaginez-vous que le marxisme même de nos « instits » socialistes aurait eu la moindre chance de réussite s’il n’avait emprunté les chemins plus familiers de nos idéologies antilibérales traditionnelles ?
E. M. : Les récentes propositions du ministre de l’Éducation nationale, Alain Savary, au sujet du système scolaire laïque et unifié ne vont pourtant guère dans ce sens.
B.-H. L. : Effectivement non. Mais elles vont bel et bien dans le sens, en revanche, de cette autre passion de la gauche archaïque qu’est l’anticléricalisme. Et là encore, je crains que le thème n’aille à l’encontre des vrais combats qu’une gauche digne de ce nom se devrait de mener. Comment peut-on encore « bouffer du curé » à l’époque de Jean-Paul II et de Walesa ?
E. M. : Vous vous en prenez sans arrêt aux saints et aux sanctuaires du socialisme mais vous ne portez jamais l’attaque dans le sérail de Dieu lui-même.
B.-H. L. : Vous voulez parler de Mitterrand. Mettons que des liens anciens m’en retiennent. Et m’obligent à une manière de devoir moral de réserve.
E. M. : Le croyez-vous néanmoins plus lucide que ses prédécesseurs sur la question fondamentale du totalitarisme soviétique ?
B.-H. L. : Ce qui est sûr c’est qu’il a une intelligence plus grande de l’Histoire de son temps. Des forces qui la travaillent. Des démons qui la hantent et reviennent, de loin en loin, la tarauder. Et notamment, j’en suis sûr, de la vieille Bête ressuscitée sous les traits de Brejnev et Andropov… Cela dit, est-ce que ça suffit ? Je ne le pense pas. Car je pense que l’on peut tout à fait résister sans merci au totalitarisme extérieur, sans reconnaître le moins du monde le mouvement qu’il impose à l’intérieur même de nos sociétés.
E. M. : Voulez-vous dire que la France est menacée de soviétisation par l’intérieur ?
B.-H. L. : On peut parfaitement être antisoviétique par haine de la Russie. Par amour de la France éternelle. Ou en vertu de l’idée que nul ne peut ni ne doit dicter à notre pays ses choix. Et puis, en même temps, dans le même mouvement de l’âme et de l’esprit, céder à un totalitarisme plus discret, plus insidieux, plus acceptable surtout, parce qu’issu, lui, du libre choix populaire. C’est, pardonnez-moi d’y revenir, ce qui s’est passé entre 40 et 42, à l’époque où la France entière était patriote. Nationaliste. Anti-allemande. Et d’autant plus à l’aise du coup, pour réaliser un bon fascisme domestique, frappé aux couleurs de notre pays, parlant la plus pure langue de ses patois et sentant si bon le doux parfum de ses terroirs. Là encore, nous n’en sommes pas là. Et je me garderai de comparer l’incomparable. Reste que le danger qui nous guette est de ce type. Et que si le totalitarisme devait un jour revenir ce serait de cette façon ; selon cette logique ; à l’ombre d’un nationalisme tout à fait exigeant ; sans la moindre intervention des chars ou des soldats soviétiques ; et à l’initiative d’hommes d’autant plus irréprochables qu’ils n’auraient jamais manifesté la moindre complaisance vis-à-vis d’un empire extérieur.
E. M. : Nous serions donc menacés d’une sorte de nouveau fascisme « à la française ». Mais où est là-dedans le soviétisme ?
B.-H. L. : C’est une tendance commune à tous les États démocratiques de notre temps. Appelez ça un soviétisme sans Soviétiques. Un soviétisme mou. Un soviétisme doux. Un socialisme soft. Un « softcialisme » à la française qui n’aurait besoin, pour s’imposer, de rien d’autre que de nous-mêmes et ne nos propres faiblesses. Le fond de l’affaire, en tout cas, c’est qu’il y a une tendance inexorable qui pousse toutes les sociétés modernes, quel qu’en soit le régime, à glisser vers ce soviétisme…
Je crois que l’Europe vit une crise morale sans précédent depuis les années 30. Et que nos contemporains voient s’effondrer autour d’eux les croyances les plus sûres auxquelles ils ont toujours adhéré. Qui suis-je ? Qu’est-ce qui me relie à mes semblables ? Qu’est-ce qui fait que l’homme n’est pas un loup pour l’homme ? Qu’est-ce qui nous interdit, à tous, de nous entretuer ? Et au nom de quoi les rassemblements humains continuent-ils de conserver le minimum de tolérance qui les rend vivables ? Quand ces questions se font trop pressantes, on est tenté de leur donner des réponses simples. Sommaires. Rassurantes. Remplaçant nos identités défaillantes par de bonnes grosses valeurs solides, sûres, sans histoires ni discussions. Eh bien ! Les valeurs qui structurent les sociétés de type soviétique sont de celles-là. Et il n’est pas exclu que le jour arrive où, pour conjurer Orange mécanique, on se replie sur Le meilleur des mondes.
E. M. : La présence de ministres communistes au gouvernement vous paraît-elle aggraver ce risque des poches de soviétisation dans la vie quotidienne des Français ?
B.-H. L. : Dans le schéma que je vous décris, le problème ce n’est pas le PC. Ce n’est plus le PC. Ça va bien au-delà du PC. Reste, cela dit, que la présence de ces quatre ministres au gouvernement est en soi très choquante. Que dirait-on si l’on nommait, demain. Le Pen et Tixier-Vignancour à la Santé ou à la Fonction publique ?
E. M. : Mais le pouvoir potentiel du PCF n’est pas circonscrit aux frontières de l’Hexagone…
B.-H. L. : Oui, bien sûr, le PCF c’est l’URSS. C’est Andropov. C’est les SS-20. C’est peut-être même les services bulgares en direct. Et c’est, à coup sûr, un chaînon essentiel dans une stratégie planétaire d’ensemble.
E. M. : Comment interprétez-vous le durcissement actuel de sa ligne ?
B.-H. L. : Il est clair que les dirigeants de la place du Colonel-Fabien assument avec de moins en moins de complexes ce rôle de valets du Kremlin. Et que le grand parti de masse de jadis ressemble de plus en plus à une phalange, un escadron pur et dur attendant, l’arme au pied, le triomphe des forces de la « Révolution » mondiale… Cela dit, je ne pense pas, une fois de plus, que les choses se passeront ainsi. Et, durcissement ou pas durcissement, je suis prêt à parier que les communistes auraient un rôle marginal dans une éventuelle dérive soviétisante.
E. M. : Négligeables alors les attaques de L’Humanité contre une presse française — la télévision est en bonne place — qui « ment », « déforme », « censure », et constitue un « danger » pour la « démocratie ».
B.-H. L. : Poursuivons la comparaison de tout à l’heure. Je tiens ces attaques pour ni plus ni moins importantes que les glapissements des collabos purs et durs de 1940, inconditionnels de l’Allemagne et qui, depuis l’hôtel Meurice et la rue Lauriston, trouvaient les maréchalistes de la zone Sud trop mous et trop timorés. Georges Marchais est un « collabo pur et dur » de ce genre. Il a quelque chose, dans la voix et dans le maintien, qui ressemble de plus en plus à Jacques Doriot. Mais Jacques Doriot, je vous le rappelle, était beaucoup trop vulgaire et voyant pour être associé aux messieurs bien élevés qui bâtissaient, sans tapage, leur fascisme à la française… Peut-être l’actuel secrétaire général du PC a-t-il compris cela. Peut- être sait-il qu’un processus est en route, qu’il a appelé de ses vœux mais qui se passera de ses services. Ce serait une explication psychologique assez bonne de l’incroyable déchaînement d’hystérie que vous évoquez.
E. M. : Avez-vous été choqué par l’intervention de l’ambassadeur soviétique auprès des médias français ?
B.-H. L. : C’est un bien mauvais signe. Et ça prouve que, du côté de l’ambassade, on se considère déjà en terrain ami.
E. M. : Et que penser de l’empressement de l’Europe occidentale à aider l’URSS dans la construction du gazoduc transsibérien ? Ou des mains tendues par certains dirigeants européens au nouveau maître du Kremlin ?
B.-H. L. : Je pense que ce sont des signes supplémentaires de notre finlandisation spirituelle. Je dis bien spirituelle. Car je n’arrive pas à démordre de l’idée que si nous sommes un jour asservis ce sera comme ça. Sans violence. Sans coup de fusil. Presque sans s’en rendre compte. Et par glissements progressifs d’un désir venu des profondeurs de notre mémoire.
E. M. : Ne craignez-vous pas de sous-estimer le rôle du Parti ? L’union de la gauche, que l’on sache, est toujours en vigueur. Et elle vient même de valoir, dans les négociations autour des listes électorales des municipales, de fabuleux cadeaux à Marchais…
B.-H. L. : C’est vrai. Mais, là encore, c’est un problème qui dépasse le PC. Ou qui, plus exactement, ne le concerne que marginalement. Le fond du problème c’est que le PC est mort, mais que le PS ne peut pas s’y faire. Comme s’il avait lui-même besoin, pour survivre, de maintenir son vieux complice en état de réanimation artificielle.
E. M. : Pourquoi cela ?
B.-H. L. : Il y a deux raisons. La première c’est qu’avant d’être son partenaire électoral, le PC est le tuteur idéologique du PS. Son grand instituteur culturel. Son maître dans les choses de l’esprit. Et qu’il y a, si j’ose le dire, un petit PC portatif dans la tête de chaque militant socialiste… On l’a bien vu, l’année dernière, au congrès de Valence. On le voit chaque fois que les tartarins socialistes haussent le ton et tentent de faire la théorie. On dirait même deux vases communicants, le contenu du discours communiste se transfusant peu à peu dans l’appareil socialiste. Le dernier exemple de ce bluff culturel étant constitué par tout ce qui s’est passé au moment de la mort d’Aragon.
E. M. : Aragon n’était-il pas un grand poète national ?
B.-H. L. : Je veux bien qu’Aragon soit un bon poète. Un honnête romancier. Un digne représentant de la littérature dix-neuviémiste. Voire même un témoin assez exemplaire de son temps. Mais tout le monde sait qu’il n’est en aucun cas un géant de la modernité. Et que son œuvre apparaîtra bien pâle aux historiens de l’avenir quand ils la compareront à celle de ces authentiques novateurs que furent Proust, Céline ou Bataille. Aragon, autrement dit, ne fut pas seulement une canaille. Ce fut aussi un écrivain somme toute assez ordinaire. Et il a fallu tout le terrorisme mental de la place du Colonel-Fabien pour nous faire croire le contraire…
E. M. : Quelle est la seconde raison ?
B.-H. L. : Elle est plus générale encore. Car elle concerne la classe politique tout entière dont le programme se formule ainsi : sauver le PCF, l’empêcher coûte que coûte de sombrer dans le néant, parce que c’est tout le petit jeu politicien qui risquerait de se perdre dans le naufrage. Ça peut sembler bizarre mais c’est ainsi : la France est le seul pays, avec peut-être l’Italie, où le principe même de l’activité politique soit historiquement défini, structuré autour du pôle communiste ; et où l’effondrement dudit pôle aurait pour conséquence automatique l’effondrement de ladite activité politique.
E. M. : Vous êtes en train de dire que sans le PC les autres partis de l’Hexagone seraient des potiches dans une vitrine sans éclairage idéologique.
B.-H. L. : Ce que je suis en train de dire c’est que le PC, même moribond, est comme un grand astre fixe autour duquel gravite l’ensemble de la galaxie. Depuis soixante ans maintenant, faire de la politique en France c’est toujours, d’une manière ou d’une autre, être pour, contre, plutôt pour ou plutôt contre les communistes. Et je suis convaincu que si demain leur électorat devenait numériquement négligeable la France deviendrait un pays très différent dont la vie publique ressemblerait, mettons, à celle d’un pays anglo-saxon. Des forces différentes s y opposeraient certes encore. Elles reprendraient du service tous les quatre ou cinq ans à l’occasion des élections. Elles s’affronteraient sur des choix de société modérés. Mais il n’y aurait plus cette espèce de bouillonnement permanent qui donne à nos débats leur air de quasi-guerre de religion. Faudrait-il s’en réjouir ? Le déplorer ? Ce dont je suis sûr c’est que personne, parmi les professionnels de la politique, n’y a intérêt.
E. M. : Quel effet cela vous fait-il d’entendre Marchais dire que « au cœur de notre combat » (communiste) il y a « les droits de l’homme » ?
B.-H. L. : Un drôle d’effet bien sûr. Et une légère sensation de nausée…
E. M. : Parce qu’un dirigeant communiste vous paraît être, sur ce chapitre, d’avance disqualifié ?
B.-H. L. : Ça me paraît évident, non ! On peut difficilement avoir couvert les millions de morts du Goulag, applaudi l’écrasement de la paysannerie afghane par les blindés russes, chanté la louange de ces tortionnaires modernes que sont Fidel Castro ou les dirigeants du Vietnam d’aujourd’hui, approuvé dans son propre pays les maires racistes qui cassent du travailleur émigré à coups de bulldozers, et venir nous dire, après cela, qu’on se soucie du bonheur, de l’honneur, ou même de la dignité des hommes.
E. M. : Comment expliquer l’acharnement du secrétaire général du PC à prétendre maintenant voler au secours des victimes de la tyrannie du monde ?
B.-H. L. : Je crois qu’il ne faut pas se laisser prendre au côté pitral de l’homme. Et que nous sommes en présence là de l’un de nos politiciens les plus avisés. Tout se passe en réalité comme s’il avait compris que cette affaire des droits de l’homme était en train de devenir une sorte de lieu commun, de passage obligé du discours. Et qu’il fallait la récupérer dans la langue de bois du Parti.
E. M. : Oui, mais comment cette récupération est-elle possible sans accuser directement Moscou et ses alliés ?
B.-H. L. : Justement, tout est là. Car je crois que, correctement utilisé, le thème les accuse moins qu’on ne croit. Prenez le cas de Valladares. Ce n’est bien entendu pas la légion d’honneur pour le régime de La Havane. Mais il est clair en même temps qu’insister là-dessus peut servir à minimiser le problème. À localiser le débat. À le réduire à un cas certes horrible, mais finalement marginal. Et à esquiver du coup, si vous préférez, la question fondamentale du fascisme cubain… Le poète, une fois libéré, innocente Castro autant qu’il l’accable. Et chacun rentre chez soi, persuadé que la question est réglée, l’abcès percé, la parenthèse refermée…
E. M. : A vous écouter, tout se passe comme si le camp communiste cherchait à faire l’impasse sur les structures mêmes des systèmes totalitaires ?
B.-H. L. : Oui, bien sûr. Mais ce que je dis, surtout, c’est que l’idée des droits de l’homme devient une pièce maîtresse de cette stratégie. Le coup de génie des communistes est en effet d’avoir compris qu’ils ont là un moyen magnifique de nous convaincre que les tares d’une société totalitaire sont des accidents ; des ratés ; des bavures ; et qu’il suffirait de vider quelques prisons, de fermer quelques camps, d’épurer quelques appareils policiers, pour que le pays devienne, comme par enchantement, un pays vivable et respirable… La manœuvre est habile. Et c’est ainsi qu’une arme brandie contre les sociétés despotiques risque de devenir peu à peu leur plus solide rempart.
E. M. : C’est incroyable de vous entendre dire ça, vous qui avez été, avec quelques autres, à l’origine de la popularisation de cette problématique.
B.-H. L. : Incroyable mais vrai. Car ainsi va la raison politique. Et ainsi, surtout, la dialectique des idées lancées dans le domaine public. Toutes proportions gardées, il m’arrive la même aventure qu’aux sincères propagandistes de la paix, qui, dans les années 50, voyaient les staliniens les prendre au mot et en faire la farce que vous savez.
E. M. : Y-a-t-il à votre avis truquage communiste sur les droits de l’homme ?
B.-H. L. : Le pire c’est que je ne suis même pas sûr qu’il s’agisse d’un véritable truquage. Et que je me demande s’il n’y avait pas, dans l’idée de départ déjà, des choses qui se prêtaient à tout cela. Dire en effet qu’un mort est un mort, qu’un camp est un camp, que rien ne doit plus distinguer entre les formes d’oppression ou entre les carnages, c’était très joli. C’était très vertueux. C’était très utile, pour alerter l’opinion sur, par exemple, les victimes oubliées du Goulag. Ça nous a servi à attirer l’attention sur les millions et les millions de morts que dissimulaient les sociétés communistes. Mais il est clair que l’argument peut se retourner. Qu’on peut tout aussi bien en déduire que les millions de morts en question méritent ni plus ni moins d’attention que des accidentés du travail en Lorraine ou des mineurs silicosés. Ça permet d’ôter à l’oppression totalitaire tout ce qu’elle peut avoir de spécifique, d’exemplaire, d’irréductible à tout autre. En clair : on banalise l’horreur.
E. M. : Est-ce à dire que, selon vous, les dirigeants communistes continuent de servir les intérêts de l’URSS lors même qu’ils dénoncent ses excès ?
B.-H. L. : Exactement. Car le résultat final de tout ça, c’est, j’y insiste, que les sociétés de type soviétique se trouvent ramenées à la mesure commune. Forts de l’angélique décision de ne plus faire le tri entre les victimes, on met Andropov et Margaret Thatcher sur le même pied. On plonge insensiblement dans une grande nuit de l’esprit où toutes les vaches sont grises. On abolit tous les repères, tous les critères qui permettent de distinguer entre les fautes d’un régime libéral et celles d’un régime totalitaire. Bref, on retrouve, à l’enseigne des droits de l’homme, le vieux sophisme des staliniens d’autrefois : la démocratie et le fascisme c’est du pareil au même ; et il n’y a, entre les deux, qu’une différence d’échelle.
E. M. : En fin de compte, tout se passe comme si le combat communiste battant le pavillon de l’ultra humanisme venait à la rescousse d’un socialisme moribond ?
B.-H. L. : Tout à fait. Ce n’est pas un hasard en effet si toute cette campagne voit le jour à une époque où la « patrie du socialisme » se trouve sur la défensive. Et où les signes s’accumulent par exemple, de plus en plus nombreux, de sa participation à l’attentat du siècle. Quelle époque ! Marchais nouveau philosophe et la Pravda dénonçant Jean- Paul II comme l’ennemi numéro 1 du socialisme : il y a de quoi perdre son latin ou, peut-être, se remettre sans tarder à l’ouvrage.


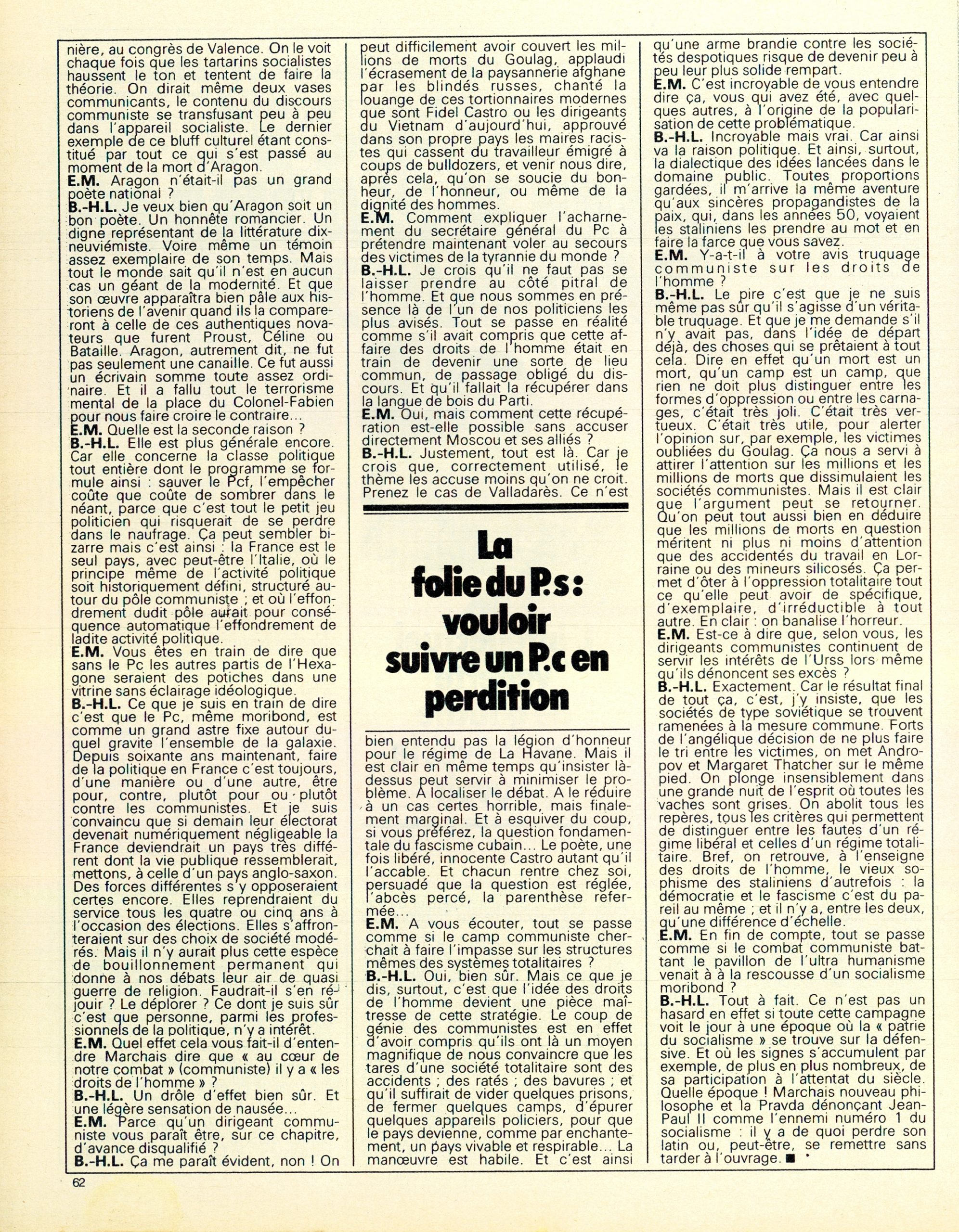

Réseaux sociaux officiels