Dans Récidives vous abordez la philosophie, Israël, le grand reportage, la littérature, le cinéma… Pourquoi cet éclectisme ?
Parce que je suis ainsi. Libre. Me moquant éperdument, et de plus en plus, des étiquettes. Est-ce que c’est une faiblesse ? Non. Je crois que c’est une force. Les gens croient que l’on est fort quand on a du pouvoir, des alliés ou, comme ils disent, des « réseaux ». Ils ont tort. Ma vraie force, ce qui me permet de mener mes combats et, parfois, de les gagner, c’est d’abord ma liberté.
Aujourd’hui, quels sont ces combats ?
Les mêmes, d’une certaine façon, qu’il y a dix, vingt ou trente ans. Autrefois, on disait : le fascisme. Ou : le stalinisme. Eh bien voici la troisième étape, le troisième volet de la même volonté de pureté c’est-à-dire, au sens propre, du même intégrisme, et cela s’appelle le « fascislamisme ». Brun, rouge et maintenant vert, l’intégrisme n’a qu’un visage. Et c’est vrai que je regrette parfois de ne pas retrouver, dans cette nouvelle bataille, tous ceux que j’ai côtoyés face aux précédents totalitarismes. Prenez l’affaire Tariq Ramadan. Souvenez-vous de la façon dont une partie de la mouvance altermondialiste a accueilli cet idéologue nauséabond qui, lorsqu’on l’interroge sur la lapidation des femmes en Islam, répond qu’il est, non pour son abolition, mais pour sa suspension, son moratoire. J’aime bien les altermondialistes. Nous avons été, souvent, du même côté dans la lutte contre le lepénisme et le stalinisme. Mais là, rien ne va plus. Quand ils ouvrent les bras à ce genre d’homme, ils se déshonorent, ils passent de l’autre côté.
Vous allez contre les idéaux « tendance » des trentenaires.
De quels idéaux parle-t-on ? Si c’est le souci d’autrui, celui des damnés de la terre et des incomptés, si c’est le sort des plus humbles, l’attention prêtée à ces vies minuscules dont les puissants se fichent, alors très bien – on est sur la même longueur d’onde et ma vie, si je puis dire, plaide pour ces idéaux. Mais si le programme consiste, au nom d’un anticonformisme de principe, à bénir n’importe quel rebelle de salon ou de tréteaux, n’importe quel adversaire du « système », n’importe quel crétin nous expliquant que l’ennemi du genre humain s’appelle, non Ben Laden, mais Bush, alors, non, en effet, ce n’est plus mon combat. Je ne suis pas jeuniste. Je crois que, quand les trentenaires se trompent, il n’y aucune raison de ne pas le leur expliquer.
C’est pour cela que vous dites qu’il faut se méfier des enthousiasmes ?
En politique, oui, l’enthousiasme est dangereux. C’est la leçon du premier Sartre, celui qui mettait en garde contre la tentation inévitablement « lyncheuse » du groupe en fusion, et il avait raison. Il y a assez de domaines, dans la sphère privée, où l’enthousiasme a sa place. Il y a la passion amoureuse, l’amitié, le goût de la littérature, le rapport aux œuvres d’art. Quand ça déborde dans la sphère publique, quand ce sont les acteurs politiques qui se croient ou se prétendent possédés par Dieu, alors, attention ! Vous n’êtes pas loin de l’« homme nouveau » des années 30, quand la grande lueur se levait à l’Est. Vous n’êtes pas loin des SA en Allemagne, de Pol Pot au Cambodge. Vous n’êtes pas loin, non plus, du bon Théophile Gautier criant « la barbarie plutôt que l’ennui ». Un démocrate c’est quelqu’un qui, dans l’espace public, accepte de dire l’inverse : l’ennui plutôt que la barbarie.
N’est-il pas illusoire de vouloir exporter les valeurs des Lumières ?
Ce n’est pas facile, bien sûr. Ce n’est pas automatique. Et il faut, là comme ailleurs, faire attention aux rêveurs qui nous disent : « un petit effort, messieurs dames, un peu de lucidité, une poussée ici, une brèche ou une ouverture là, et le Mal se dissipera comme un mauvais cauchemar, un brouillard » – il faut se méfier de cet éternel optimisme, de ce messianisme progressiste ou même simplement démocratique qui nous fait imaginer qu’il suffit de savoir pour vouloir, de voir pour se déprendre, et qu’une bonne cure de Lumières liquidera l’obscurantisme. Cela étant dit, j’y crois quand même. A l’intérieur de ces limites, je parie sur les Lumières et l’universalité des Droits de l’homme. Et surtout, surtout, je suis choqué de la connotation inévitablement raciste de tous les discours qui nous disent que, sous prétexte que c’est difficile, c’est impossible – je suis indigné par ces gens qui, autour de nous, acceptent les prémisses d’un relativisme qui ne dit pas son nom mais qui condamne bel et bien, par exemple, les femmes musulmanes à la soumission.
La guerre, cela peut être le combat pour la laïcité ?
Bien sûr. Et tant pis pour ceux qui, au nom d’une conception dévoyée de ces Droits de l’homme, au nom d’un « il a bien le droit » sottement psalmodié, au nom d’une tolérance qui n’est bien souvent que le masque du compromis, abandonnent ces femmes à la loi des pères, des frères, des caïds.
Tolérance caractéristique de la génération « Touche pas à mon pote ».
Non. Car ceux qui ont fondé SOS Racisme, Coluche, Simone Signoret, Harlem Désir, Julien Dray, Marek Halter, moi-même, savaient que les Droits de l’homme ce n’était pas l’équivalence des opinions. A l’époque, les jeunes Français d’origine maghrébine savaient que les sociétés basées sur l’égalité des femmes sont meilleures, mais oui, que celles où on leur excise le clitoris. Ils savaient, nous savions, que tout n’est pas dans tout, que les régimes de société ne sont pas équivalents et qu’aucun « respect des différences » ne doit nous dissuader de dire que, dans l’échelle des régimes, ceux où l’on respecte le droit d’un corps à ne pas être dépecé, torturé ou même soumis sont quand même supérieurs à ceux où on ne le respecte pas. Par ailleurs, je vous rappelle ce détail : quand ils défilaient contre le racisme, ils chantaient La Marseillaise, ils ne la sifflaient pas. Je n’aime pas trop, personnellement, La Marseillaise. Je ne suis fou ni de ses paroles ni de l’espèce de transe idiote où elle met les tenants de la religion patriote en France. Mais enfin, dans le contexte, cela fait quand même une différence.
Bientôt, et en application de la loi sur les signes religieux, des filles voilées risquent d’être exclues du collège. Qu’auriez-vous à leur dire ?
Que le voile est un signe, non religieux, mais politique, et qu’il contrevient au principe d’égalité. Il y a quinze ou vingt ans, il y avait peut-être dans cette affaire une dimension de jeu, de fantaisie. Aujourd’hui tout a changé. Le rapport de forces ambiant, le discours des mollahs irresponsables et des caïds machistes ont modifié la donne. Une femme qui arrive voilée à l’école affirme implicitement qu’elle n’entre plus dans la logique d’émancipation que suppose la fréquentation d’un roman de Stendhal, d’une pièce de Racine ou d’un poème musulman du IXe siècle.
L’intellectuel que vous êtes a-t-il pu mobiliser, sur ces questions, des intellectuels musulmans ?
Ils n’attendent personne pour se mobiliser. En Afghanistan, au Pakistan, chez les Palestiniens, je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines de clercs qui ont compris que la seule guerre de civilisation qui tienne est celle qui traverse l’islam et oppose, en islam, les courants intégristes aux courants démocratiques. Alors, ils ont peur, bien entendu. Ils disent ce qu’ils ont à dire à voix basse. Ils savent qu’en le disant, ils prennent des risques sans commune mesure avec ceux que nous prenons, nous, ici, en Europe. Mais enfin ils le disent. Et avec un courage qui force le respect.
Au questionnaire de Proust vous répondez comme défaut le plus aisément pardonnable : « la lâcheté, bien sûr ».
C’était un peu une provocation. Mais une part de moi le pense. C’est l’éternelle histoire, n’est-ce pas, des gens qui parlent sous la torture, de comment on réagirait soi-même si, etc… J’ai couvert, vous le savez, beaucoup de conflits pour beaucoup de journaux. Chaque fois, j’ai vu des situations où les hommes, loin d’être les matamores que l’on imagine et que dépeint la littérature de guerre, redeviennent des enfants, de pauvres enfants humiliés, apeurés, tremblants, appelant à l’aide, priant. C’est un spectacle pathétique, pitoyable. Mais c’est comme ça. C’est l’ordinaire de ce que j’ai vu en Bosnie, au Soudan, dans l’Afrique de l’épouvante, chez les enfants soldats des maquis du Sri Lanka. Et c’est en pensant à cela, c’est en pensant à ce jeune Bosniaque qui se souillait chaque fois qu’il devait monter au front, ou à cet autre qui préféra, un jour, se suicider plutôt que d’obéir, que j’ai dit, ce jour-là, que la lâcheté était le défaut pour lequel il fallait avoir le plus d’indulgence. J’ai eu, il y a longtemps, deux conversations sur le sujet que je n’oublierai, je crois, jamais. Je ne suis toujours pas prêt à les raconter, dans le détail, aujourd’hui. Mais croyez bien qu’elles sont gravées, au fer rouge, dans ma mémoire. L’une, à la fin des années 1970, avec René Hardy, alias Didot, spécialiste des sabotages de trains qui traînait après lui, malgré deux acquittements successifs à la Libération, la réputation d’être l’homme qui avait conduit la Gestapo au fameux rendez-vous de Caluire où Jean Moulin fut pris : je ne sais pas ce qu’il en est ; je ne me prononce évidemment pas sur cette question ; mais je me rappelle que je le voyais dans un petit appartement de la rue des Saints-Pères, peut-être au-dessus des Éditions Fayard je ne sais plus, où il habitait à l’époque, je devrais dire : où il gisait, presque constamment alité, grosse robe de chambre de laine crasseuse, montagnes de médicaments sur les tables de nuit mêlés à des bouts de biscuits mâchouillés, vieux journaux, paquets de livres ficelés comme s’il s’apprêtait à partir, le beau visage de jeune homme qu’ont fixé les photos de jadis transformé en un masque empâté, gestes flous, regard vague, l’impression d’un air, d’une atmosphère, soudain trop épais pour ses bronches sans doute malades – et puis des souvenirs qui, visiblement, le hantaient et auxquels il ne parvenait pas à donner congé… Et l’autre conversation, quelques années plus tard, avec Paul Nothomb, l’oncle de la romancière Amélie Nothomb, un hébraïsant de bonne qualité, qui est mort, lui, beaucoup plus tard mais qui avait été, dans une autre vie, le compagnon d’armes de Malraux dans l’escadrille España avant d’entrer, comme lui, avec lui, dans la Résistance : grande allure, lui, en revanche ; beau vieillard, jusqu’au bout ; panache ; stature ; les yeux comme des billes de marbre impeccablement logées dans le visage ; mais quelque chose de cassé dans le regard bleu ; un affolement d’insecte traqué à l’évocation de certains épisodes de sa vie magnifique et, en particulier, de sa saison antifasciste – et une façon de fléchir un peu, de se troubler, ou, parfois, de laisser affleurer un autre sourire, un sourire caché, un sourire plus timide que l’autre, apeuré, qui m’a tout à coup fait penser que c’était à lui, à une conversation avec lui, que pensait l’auteur du Temps du mépris, puis de l’« Hommage à Jean Moulin », dans l’apostrophe célèbre : « Entre ici Jean Moulin, avec ton terrible cortège – avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé ». Mais je vous en ai déjà trop dit…
Regrettez-vous, vous-même, d’avoir parfois manqué de courage ?
Mais oui. Forcément. D’aucun de ces reportages difficiles, d’aucun de ces séjours répétés dans les trous noirs de la planète, d’aucun de ces bord-à-bord avec l’horreur, je ne suis rentré sans me dire : « j’aurais dû faire plus, un peu plus ; ce maquis du GIA j’aurais dû prendre le risque d’y entrer ; cette femme kamikaze repentie du Sri Lanka j’aurais pu et dû faire davantage pour l’arracher à l’enfer ; ces hommes en train de mourir de faim, sous mes yeux, dans les monts Nouba, j’aurais dû tout faire, vraiment tout, pour les tirer de là et les sauver – au lieu de quoi cet “ordre des choses”, cet horrible “ordre des choses” qui fait que, au bout de quelques jours, j’ai été bien obligé de rentrer… ». Mais voilà. C’est comme ça. La seule façon de n’avoir jamais de regrets, c’est, comme les donneurs de leçons parisiens, de ne pas quitter son bureau.
Est-ce par le reportage que vous en apprenez le plus sur l’humain et sur vous- même ?
Comme dans toutes les situations extrêmes. Les choses, pour moi, sont très simples. A Paris, je ne vois rien. A la lettre, rien. Et tout se passe comme si, dès que je suis en reportage, mes sens étaient affinés, décuplés…
Comment travaillez-vous ?
C’est la question que m’a posée, un jour, Jean Hatzfeld. Je lui réponds que je note assez peu mais que j’ai une grande mémoire visuelle. J’entends tout. J’enregistre tout. Il suffit, je vous le répète, que je sois sur le terrain pour que s’opère en moi une sorte de décuplement des radars, d’hypertrophie de la mémoire.
Ce qui vous anime, c’est la passion de l’écriture ?
Avant l’écriture, il y a les autres, le souci des autres – toute une galerie de visages, croisés depuis mon premier contact avec la guerre, il y a trente ans, au Bangladesh, et qui me hantent. Je rentre, bien sûr. Je rentre toujours. Mais, croyez-moi, je n’oublie rien.
Comme chez Riszard Kapuscinski, l’effondrement semble marquer votre œuvre ?
Peut-être. Et aussi, je dois l’avouer si je veux être parfaitement honnête, un bizarre sentiment de liberté. Vous connaissez le mot de Sartre : « les Français n’ont jamais été aussi libres que sous l’Occupation » ? Eh bien c’est un peu ce que je ressens quand je me trouve dans ces situations extrêmes et où je joue aussi, un peu, ma propre vie : je n’ai jamais été aussi libre que dans ces reportages consignés ici ou là et qui me mènent au Nigeria, en Irak, dans Sarajevo bombardée, ailleurs. J’aime ces moments.
Quels auteurs vous semblent à même de nous fournir des outils pour comprendre le monde en mutation d’aujourd’hui ?
Le maître absolu, pour un écrivain comme moi, c’est évidemment Malaparte, le Kaputt de Malaparte. Et puis il y a mes maîtres en philosophie. Althusser, toujours secrètement là. Foucault, tellement plus important que Bourdieu. Sartre, bien sûr. Et puis Lacan, l’un des rares à nous donner des armes dans la lutte, par exemple, contre la volonté de pureté intégriste – cela peut surprendre, mais c’est pourtant vrai ! Il y a une politique de Lacan dont Pierre Legendre a explicité, naguère, les premiers principes et dans le fil de quoi j’essaie, depuis trente ans, de penser.
Et le succès de Rien de grave, le livre de votre fille Justine Lévy, en êtes-vous fier, avez-vous été meurtri par sa souffrance ?
Les deux. Bouleversé, meurtri, comment un père ne le serait-il pas face à un livre pareil ? Mais fier en même temps, très fier, de voir comment elle a su transformer en littérature ce paquet de mémoire et de vie.
La séparation de votre fille avec Raphaël Enthoven vous a-t-elle rapproché ou éloigné de votre grand ami l’écrivain et éditeur Jean-Paul Enthoven ?
Je vous ai dit que j’étais d’accord pour qu’il n’y ait pas de sujet tabou. Mais là, quelle drôle de question !
Vous aviez tout de même uni vos enfants.
Depuis quand les pères unissent-ils leurs enfants ? Avec Jean-Paul Enthoven, c’est une amitié qui dure depuis si longtemps, et qui est scellée dans l’aventure croisée de deux vies, dans le goût partagé de la littérature, dans tant d’autres choses encore. Alors, pour le reste, no comment.
Êtes-vous féministe ?
Je crois, oui. Et je le suis, il me semble, par instinct autant que par raison. L’instinct, c’est mon amour des femmes et mon peu de goût, inversement, pour la meute virile, ses emportements, ses codes imbéciles. Et puis l’argument de raison c’est que la haine des femmes est, je le sais depuis longtemps, l’une des pierres d’angle de tous les délires totalitaires. Prenez, une fois de plus, les islamistes. Leur relation phobique au corps féminin. Leur dégoût. Leur peur. Comment ne pas être féministe quand on rentre du Pakistan, ce pays où, quand on est lassé d’une femme, on dit à la cantonade qu’elle vous a humilié et on la brûle vive – cela s’appelle un crime d’honneur !
Et que vous inspire l’affaire Cantat ?
Je m’en suis expliqué dans un de mes livres. Un texte consacré à la Colombe d’Or où j’ai, avec Arielle Dombasle, longtemps vécu. Lisez bien. Vous y trouverez une solution à ce type de drame. Se frapper soi-même quand on veut frapper l’autre. Alors, on mesure la violence de ses coups et, si l’on va trop loin, l’on est sa propre victime. J’en ai fait l’expérience. Jusqu’au sang.
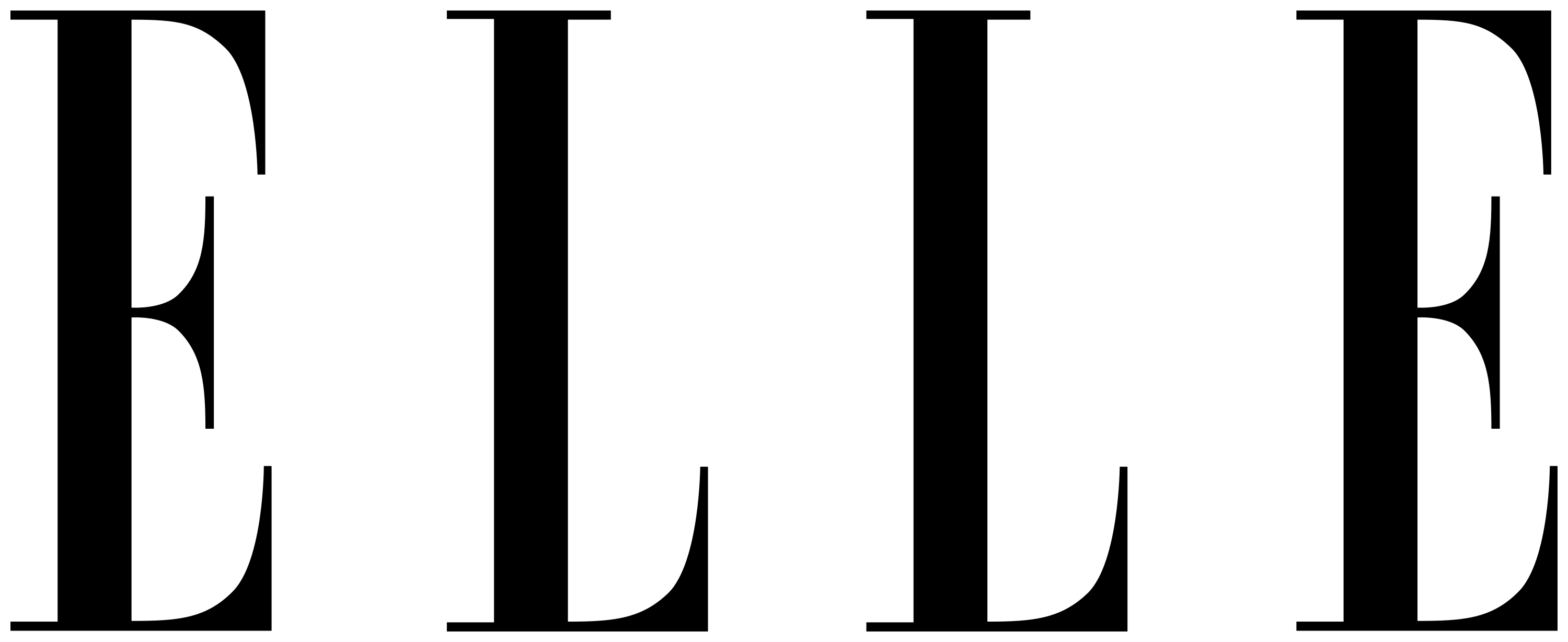
Réseaux sociaux officiels