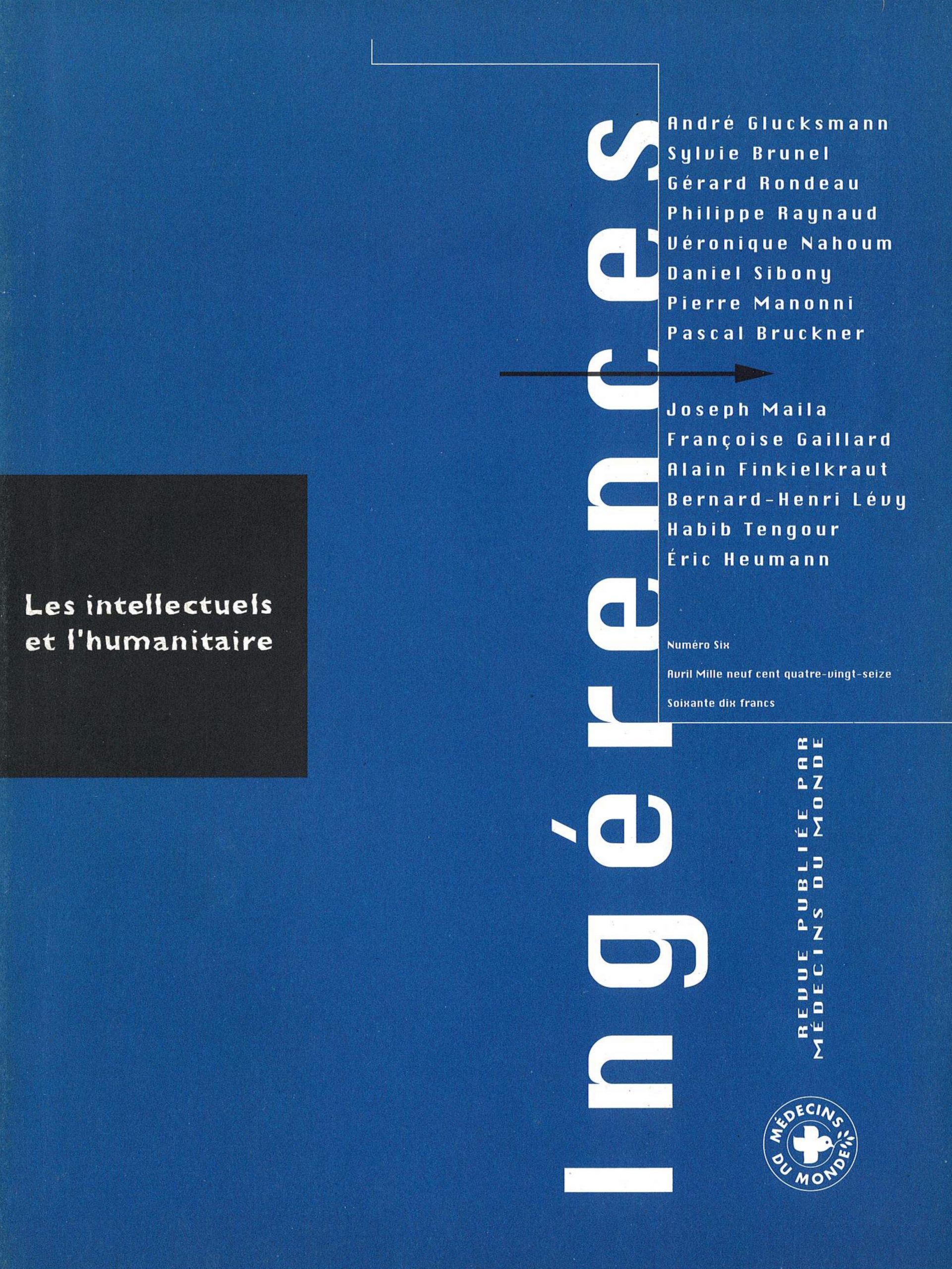
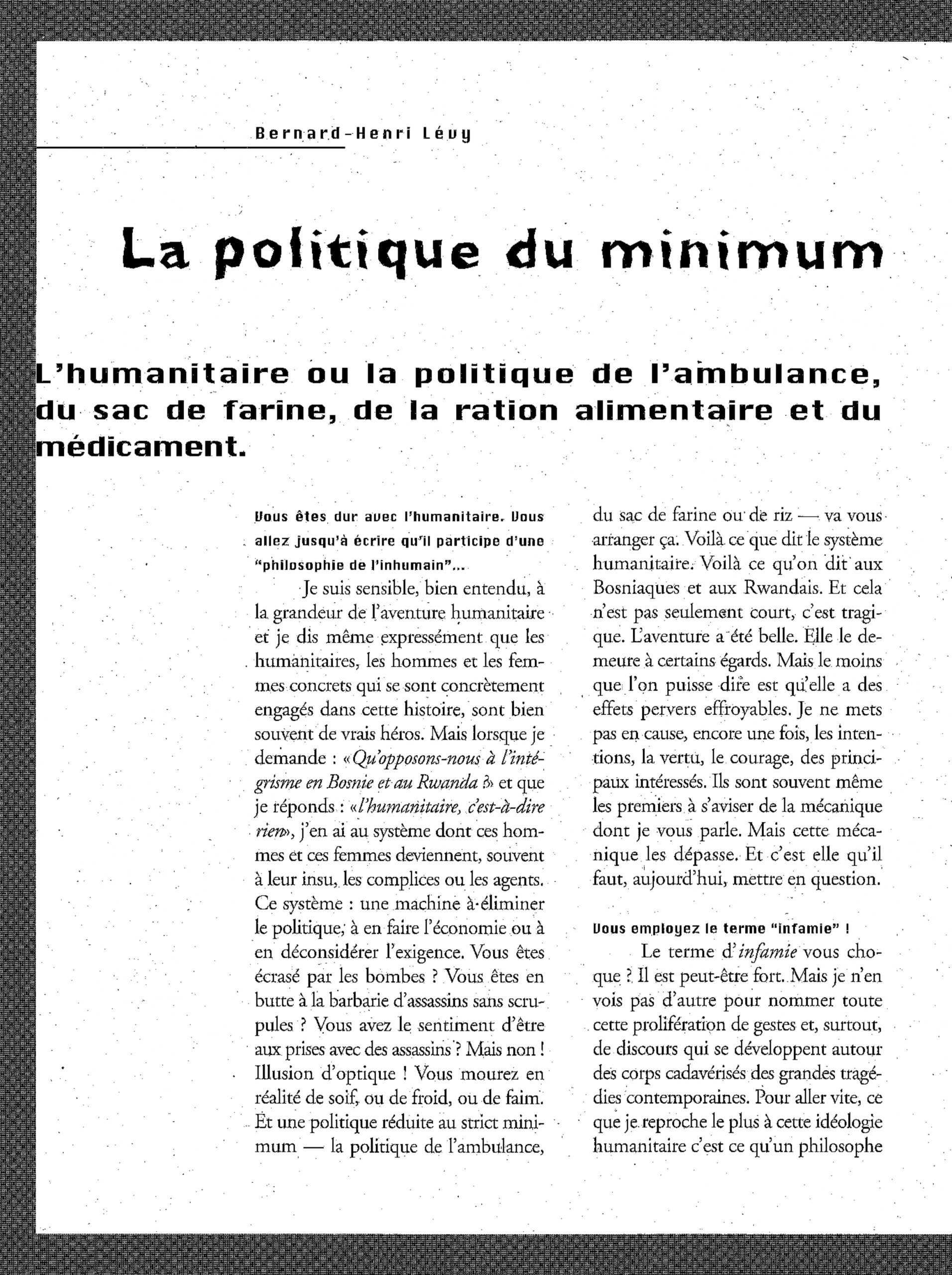

*
LA POLITIQUE DU MINIMUM
L’humanitaire ou la politique de l’ambulance, du sac de farine, de la ration alimentaire et du médicament.
Vous êtes dur avec l’humanitaire. Vous allez jusqu’à écrire qu’il participe d’une « philosophie de l’inhumain »…
Je suis sensible, bien entendu, à la grandeur de l’aventure humanitaire et je dis même expressément que les humanitaires, les hommes et les femmes concrets qui se sont concrètement engagés dans cette histoire, sont bien souvent de vrais héros. Mais lorsque je demande : « Qu’opposons-nous à l’intégrisme en Bosnie et au Rwanda ? » et que je réponds : « L’humanitaire, c’est-à-dire rien », j’en ai au système dont ces hommes et ces femmes deviennent, souvent à leur insu, les complices et les agents. Ce système : une machine à éliminer le politique, à en faire l’économie ou à en déconsidérer l’exigence. Vous êtes écrasé par les bombes ? Vous êtes en butte à la barbarie d’assassins sans scrupules ? Vous avez le sentiment d’être aux prises avec des assassins ? Mais non ! Illusion d’optique ! Vous mourez en réalité de soif, ou de froid, ou de faim. Et une politique réduite au strict minimum – la politique de l’ambulance, du sac de farine ou de riz – va vous arranger ça. Voilà ce que dit le système humanitaire. Voilà ce qu’on dit aux Bosniaques et aux Rwandais. Et cela n’est pas seulement court, c’est tragique. L’aventure a été belle. Elle le demeure à certains égards. Mais le moins que l’on puisse dire est qu’elle a des effets pervers effroyables. Je ne mets pas en cause, encore une fois, les intentions, la vertu, le courage, des principaux intéressés. Ils sont souvent même les premiers à s’aviser de la mécanique dont je vous parle. Mais cette mécanique les dépasse. Et c’est elle qu’il faut, aujourd’hui, mettre en question.
Vous employez le terme « infamie » !
Le terme d’infamie vous choque ? Il est peut-être fort. Mais je n’en vois pas d’autre pour nommer toute cette prolifération de gestes et, surtout, de discours qui se développent autour des corps cadavérisés des grandes tragédies contemporaines. Pour aller vite ce que je reproche le plus à cette idéologie humanitaire c’est ce qu’un philosophe appellerait son vitalisme. J’entends par là le fait de traiter les victimes comme de simples corps souffrants, ces corps comme des amas d’organes, et ces amas d’organes comme une sorte de matière indifférenciée, purulente et vouée à je ne sais quelle ingénierie de l’horreur. L’attitude opposée serait celle qui admettrait que ces corps ont une âme, que leur martyre n’est pas tombé du ciel et que leur souffrance n’est pas une simple affaire physiologique. Trop de physiologie dans l’humanitaire d’aujourd’hui. Trop d’esprit clinique. Pas assez, j’insiste, de considération des sujets – avec tout ce que cela implique. Traiter des hommes comme des bêtes, les réduire à une vague bouillie de chairs broyées –, c’est un crime dont je sais bien que les premiers responsables sont les assassins eux-mêmes, mais dont on ne m’empêchera pas de penser que sont complices tous ceux qui arrivent par là-dessus et, à cette masse indifférenciée, ne savent offrir que des rations alimentaires ou des médicaments. J’ajoute qu’il y a dans cette affaire une autre dimension encore dont nous sommes, d’une certaine façon, tous complices (je parle des intellectuels, des journalistes, etc., qui allaient, par exemple, à Sarajevo) et qui est sa dimension de spectacle. Je raconte cela dans Le Lys et la cendre. Je dis à plusieurs reprises comme je me suis surpris à observer avec une curiosité morbide le spectacle de cette humanité souffrante. Je force le trait, là encore. Mais qu’il y ait, sur la scène humanitaire, un côté laboratoire de l’inhumain, ou chasses du comte Zaroff, ou que les agents de cette idéologie ressemblent souvent à des voyeurs qui, au balcon, regarderaient comment cela se passe quand l’humanité arrive aux frontières extrêmes de la souffrance, comment ça réagit, comment ça geint, comment ça geint, comment ça survit, quels sont les ressorts ultimes, les ressources secrètes des sujets martyrisés, que l’on contemple tout cela avec une curiosité navrée mais passionnée – je crains que ce ne soit attesté.
À force de tout reprocher à l’humanitaire, ne le mettez-vous pas, de ce fait, à la place du diable et de l’impur ?
Le diable n’est, pour le coup, pas le mot et je ne l’emploie, au demeurant, jamais. Mais que l’humanitaire soit aujourd’hui dans l’œil du cyclone, qu’il ait à redéfinir sa vocation et ses missions, j’en suis persuadé. J’insiste sur le fait que cette critique émane d’une homme qui fut, à sa façon, partie prenante de l’aventure. Et je précise que je l’adresse, cette interpellation, aux humanitaires eux-mêmes qui ne sont pas, soit redit en passant, les derniers à s’aviser du problème. Mon rêve serait, au fond, celui-ci : que les associations continuent de susciter ou d’accueillir la générosité des citoyens, qu’elles persistent (car elles le font aussi !) à soulager la souffrance des hommes, mais qu’elles soient aussi capables (et tout est là) d’intégrer à leur démarche un minimum de souci politique. Faute de quoi, elles resteront prisonnières, en effet, de ce système de la pitié dangereuse. Faute de quoi, elles pratiqueront une compassion vide, ou perverse, dont on a que trop vu les effets en Bosnie. Tout est à refaire. Tout est à repenser. Je sais que le processus est en route.
Réseaux sociaux officiels