NELLY KAPRIÈLIAN : Êtes-vous satisfait de la réponse de Hollande à votre appel ?
BERNARD-HENRI LÉVY : Oui, bien sûr. Envisager une intervention militaire pour faire stopper les massacres, c’est déjà bien. Mais cela ne suffit pas. La politique, ce n’est pas le ministère de la parole, c’est celui des actes.
Quels actes ?
Un G8 par exemple. Convoquer, de toute urgence, un G8 sur la Syrie. On l’a bien fait pour l’Afghanistan. On le fera peut-être pour l’euro et la Grèce. Le sauvetage du peuple syrien ne vaut-il pas l’empêchement du retour de la drachme ?
Imaginez-vous Hollande agir, en Syrie, comme Sarkozy en Libye ?
Oui s’il ne se laisse pas aveugler par son obsession de prendre, en tout point, le contrepied de Sarkozy. Si c’était le cas, le malheureux peuple syrien ferait les frais de cette maladie infantile de la gauche qu’est l’antisarkozysme primaire.
Que pensez-vous, alors, qu’il fera ?
Il a, en pure logique des places et des espaces, deux choix possibles. Agir comme son maître (Mitterrand, la Bosnie…) ou comme son prédécesseur (Sarkozy, la Libye…).
Lors de sa rencontre vendredi dernier avec Poutine, aurait-il pu le faire fléchir davantage ?
Oui. Sauf qu’il a été, si j’ose dire, « saboté » par Merkel. Poutine, ne l’oubliez pas, a fait, avant de venir à Paris, un crochet par Berlin. Et, là, Merkel lui a dit quoi ? Qu’elle saluait son attitude « constructive » ! En apportant au bourreau des Tchétchènes ce brevet de bonne conduite, ce renfort, elle a poignardé Hollande dans le dos.
Peut-on intervenir sans la Russie et la Chine ?
Bien sûr. C’est ce que vient de déclarer, pas plus tard que mercredi, la représentante permanente des États-Unis au Conseil de sécurité, Susan Rice. Cette dame est la voix de l’ONU. Elle y fut l’une des architectes de la résolution légalisant l’intervention en Libye. Or c’est elle qui nous dit : « Si l’ONU y va, c’est bien ; mais si elle n’y va pas, eh bien on ira sans l’ONU… ».
Y aller, ça voudrait dire quoi ?
Assad n’est pas Kadhafi. Il n’est pas aussi fou que Kadhafi. Et il n’est donc pas exclu qu’une simple démonstration de force, un simple début d’escalade, suffisent à lui faire lâcher prise. Les non interventionnistes se fichent de nous quand ils font semblant de croire qu’on les entraine dans une guerre totale. Personne ne parle de ça.
On dit néanmoins qu’une intervention en Syrie serait plus difficile qu’en Libye.
Plus facile, au contraire. Ne serait-ce qu’à cause de la Turquie, complètement mobilisée contre Assad alors qu’elle ne l’était pas contre Kadhafi. Ou à cause de la Ligue Arabe qui a déjà suspendu la Syrie et veut, à l’unanimité, se débarrasser de son chef. Nous n’avions pas, au moment de la Libye, une configuration si favorable.
Alors, où est le problème ?
Dans l’extension sans précédent du principe de précaution. On a un type dont la maison brûle. Et on attend, avant de lui envoyer les pompiers, d’être certains qu’une fois sauvé il ne va pas aller commettre un crime. C’est débile. Et criminel. Car on prend le risque, ce faisant, de deux, trois dix, nouveaux Houla.
Est-ce que ce qui manque ce n’est pas un homme qui, comme vous, rassemble toutes les parties ?
Ce qui manque c’est un pilote dans l’avion. C’est-à-dire un homme d’Etat capable de donner l’impulsion, de fédérer les énergies. Si ce n’est pas Hollande, ce sera Obama.
Au moment de la Libye, aviez-vous reçu des soutiens de Hollande ou d’autres politiques au gouvernement aujourd’hui ?
Il y a eu, sur la Libye même, Martine Aubry qui fut la première, début mars, à rappeler la lâcheté française au commencement de la Guerre d’Espagne, en 36. Mais, quant à la Syrie, nous avons, le 3 juillet 2011, avant le grand meeting anti Assad organisé par La Règle du Jeu, eu un contact téléphonique avec François Hollande qui nous apparut d’une redoutable fermeté. Et puis il y eut Laurent Fabius qui vint au meeting pour nous dire en substance : « nous sommes entrés dans un nouvel âge, où la souveraineté des Etats doit composer avec l’internationalisation des droits ». Puissent-ils, l’un comme l’autre, maintenant qu’ils sont aux affaires, se souvenir de leurs professions de foi anti souverainistes. Porter secours au peuple syrien martyrisé devrait être la grande cause nationale de ce début de quinquennat.
Poutine et les opposants à une entrée en guerre en Syrie brandissent le spectre d’une guerre civile…
Ils ont raison. Sauf que c’est Assad qui la veut, cette guerre civile. Et plus on tarde à intervenir, plus on temporise, plus on laisse la situation pourrir – et plus on a de chances de la voir se développer. S’il y a la guerre civile en Syrie, elle aura un responsable principal, ce sera Asad, donc Poutine.
Vous vous êtes rendu en Bosnie, au Bangladesh, au Darfour, en Afghanistan où vous avez rencontré Massoud…
Oui. Et je tiens beaucoup, dans le film, à cette scène avec Massoud. A cause de sa mélancolie. De sa tristesse. Comme s’il se savait dépositaire, ce jour-là, d’un lourd et terrible secret et qu’il savait, d’avance, qu’il ne serait pas écouté. Ce secret c’était, nous l’avons compris depuis, celui de la naissance d’Al Qaeda, de sa diabolique nocivité. Mais Chirac, et donc la France, allaient, quelques temps plus tard, lui fermer leur porte…
Vous dîtes à Massoud, dans cette scène, à peu près les mots mêmes que vous prononcerez, quinze ans plus tard, devant le chef libyen…
C’est exact. Et c’est le raison pour laquelle je l’ai montée dans le film. Je vous fais observer, soit dit en passant, que tous les pays que vous venez d’énumérer sont, Afghanistan en tête, des pays de culture, disons, « musulmane ». Ajoutez-y le Pakistan. La Tchétchénie où je ne suis jamais allé mais dont j’ai maintes fois dénoncé la quasi liquidation par le même Poutine. Et vous constaterez que je suis l’un des juifs vivants qui se seront battus avec le plus de constance pour l’émancipation et la dignité des peuples de l’Islam…
Vous avez également témoigné des guerres que vous appelées « oubliées » dans des reportages et des livres. Vous avez écrit sur ces peuples abandonnés à leur sort par une communauté internationale indifférente.
Je vous interromps à nouveau. Car c’est une belle histoire, je crois, que celle de ces guerres oubliées. C’était l’époque où le journal Le Monde était dirigé par Colombani et son fidèle lieutenant Plenel. Nous étions plutôt amis tous les trois. Nous l’étions, si j’ose dire, sur des « vraies bases » puisque c’est Plenel qui, par exemple, avait rendu compte, dans le journal, de mon livre sur La Pureté dangereuse. Or voilà qu’ils viennent me voir, un jour, pour me convaincre de faire des reportages de guerre à l’ancienne. D’accord, je leur dis. Mais à une condition. Oublions les guerres dont vos journalistes rendent déjà compte, et fort bien, à longueur d’année. Listons, à l’inverse, celles dont, sans doute parce que vous pensez que votre public s’y intéresse moins, vous ne parlez jamais. C’est celles-là que je veux bien couvrir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous dressons la liste, Plenel et moi, des cinq ou six conflits auxquels Le Monde n’a pas consacré de vrai reportage depuis un certain nombre d’années. Et en avant ! C’est ainsi que la série naît !
Vous avez passé plus de trente ans à tenter d’alerter, en vain, les politiques en place. Ce n’est qu’aujourd’hui, après des décennies de non-ingérence, que vous réussissez. Comment expliquez-vous que les choses aient changé ? Que s’est-il passé pour qu’une intervention en Libye ait pu avoir lieu ?
La honte. Eh oui, la honte que nous sommes un certain nombre à avoir ressentie face à ces échecs répétés en Bosnie et, pour ce qui me concerne, sur ces théâtres des « guerres oubliées ». Cette honte a engendré une rage. Cette rage, une volonté de revanche. Et c’est pourquoi tant Nicolas Sarkozy que David Cameron et Hillary Clinton présentent leur succès en Libye comme l’éclatante et nécessaire revanche sur l’échec de leurs aînés en Bosnie. La Bosnie comme une brûlure. La Bosnie comme une déchirure. Plus jamais la Bosnie. Nos aînés avaient dit « plus jamais Auschwitz » et c’est pourquoi ils ont fait l’Europe. Eux, Sarkozy, Cameron, Hillary, ont dit « plus jamais Sarajevo » et c’est pourquoi ils ont gagné en Libye. C’est un beau et fécond sentiment, la honte, en politique.
Y a-t-il eu une lâcheté typiquement occidentale ?
Cette lâcheté occidentale est de tous les temps. C’est une constante absolue, je dis bien absolue, de l’histoire de l’Occident depuis au moins un siècle. Il n’a pas bougé au moment du massacre des Arméniens. Pas bougé quand est tombée la république espagnole. Toujours pas bougé au moment de la Shoah (et n’en déplaise à Claude Lanzmann dans son débat avec Yannick Haenel, on pouvait bouger, Roosevelt pouvait écouter Jan Karski…). Et toujours pas bougé non plus quand on a tiré sur les ouvriers à Berlin Est, puis à Budapest, puis quand a été écrasé le printemps de Prague. Il y a un beau texte de Léon Blum, dans les années 1920, sur l’incapacité des démocraties à faire la guerre et sur l’oxymore qu’est la formule de « démocratie en guerre ». Tout y est. C’est terrible.
La guerre ne va pas avec l’esprit démocratique ?
Les démocraties font la guerre quand elles sont directement agressées. Mais sinon ? C’était l’amère conviction de Bataille et de ses amis du Collège de Sociologie, face à la montée de ce qu’ils appelaient, à juste titre, la « religion nazie » : elles sont indécises ; impotentes ; incapables de répondre, avec des armes équivalentes, à la brutalité des totalitarismes. Des belles paroles, oui. Des ronds de jambe. Des moulinets. Mais, à la toute dernière minute, la tragique vérité : pas question de mourir pour les Arméniens, pour les juifs, pour Dantzig, pour la Bosnie. C’est comme ça.
On pourrait vous objecter que c’est la prudence géopolitique, realpolitique, qui les empêche de prendre trop de risques.
Je ne crois pas. Car regardez, encore une fois, l’exemple de la Syrie. L’intérêt géopolitique commanderait, au contraire, de faire partir Assad. Le bon, le sain calcul serait de tendre la main aux jeunesses arabes en train de s’émanciper. Au lieu de quoi ces discours de gâteux sur la « boite de Pandore » qu’il ne faudrait surtout pas « ouvrir ». Mais quelle boîte de Pandore, mon dieu ? Ce n’est pas celle de l’Islamisme qu’on ouvre. C’est celle de la démocratie. C’est l’extraordinaire, imprévisible, boîte de Pandore de la démocratie en marche. Le fond de l’affaire n’est pas là. C’est l’accord fondamental Léon Blum-Georges Bataille sur ce point aveugle des démocraties qui s’appelle, qu’on le veuille ou non, la guerre.
C’est ce dont vous aviez voulu témoigner dans votre documentaire Bosna ! ?
Exactement. Car la Bosnie fut le point culminant de la forclusion. Pensez à cette figure que l’on a vue, alors, surgir et triompher : la figure du casque bleu. C’était un soldat, et ce n’était pas un soldat Il avait toutes les apparences du soldat, et il en était la caricature. Il était censé être le rempart de la justice et du droit ; et il fut, en réalité, le fourrier, de l’injustice et du carnage. Quelle leçon. Quelle dérision. Figure absurde, et tragique, qui nous a, tous, servi de leçon.
Êtes-vous vraiment sûr que tous les intellectuels aient, comme vous semblez le dire, tiré ces leçons de la Bosnie ?
Je ne sais pas, finalement. Car je viens de lire, à l’instant, l’incroyable édito de Jacques Julliard, dans le dernier Marianne. Il fut, Julliard, mon compagnon de combat bosniaque. Il fut l’un des plus ardents à pourfendre ce qu’il appela le « fascisme qui vient » et qui était le fascisme serbe. Or voici que, faisant, dans cet édito, le bilan des combats de sa vie, il se met à dire que la plupart des pays pour lesquels il s’est battu ont fini dans l’islamisme et la charia. Et comme exemple de cette chute dans la Charia, devinez ce qu’il cite ? La Bosnie. Notre pauvre et douloureuse Bosnie qui a payé tellement cher le droit de rester fidèle à son islam de tolérance et de lumière et qu’il renvoie donc, contre toute logique, absurdement, idiotement, à un islamisme imaginaire. Que se passe-t-il dans la tête d’un Julliard quand il profère une énormité pareille ? C’est incompréhensible. Sauf à l’imaginer encombré de ce qu’il a fait, embarrassé de sa propre grandeur d’autrefois – et prêt à tout, à n’importe quel lapsus, contre vérité, mensonge, pour parvenir à s’en décharger. La Bosnie multi ethnique est décrétée, alors, « gagnée à la Charia ». Navrant.
Venons-en à votre film, Le Serment de Tobrouk, et au reproche qui vous est d’être narcissique. Qu’en pensez-vous ?
Je suis très intrigué par ce reproche. Plus exactement, je suis surpris que les mêmes qui ont vu, à Cannes, quelques jours avant mon film, et sans que cela les gêne, celui de Raymond Depardon, Journal de France, où l’auteur est présent à chaque plan, ou presque, trouvent tout à coup insupportable de me voir apparaître dans Le Serment de Tobrouk. Ou bien ce film de Michael Moore où l’auteur était omniprésent – cela ne l’a pas empêché d’obtenir la Palme d’Or. Je ne dis pas que cette Palme ne soit pas méritée, je m’en fous. Mais j’aimerais juste savoir pourquoi ce qui est acceptable, et même louable, chez Moore devient brusquement critiquable, en tout cas embarrassant, chez moi…
Vous n’aimez pas Michael Moore ?
Ce n’est pas la question. Mais il ne me viendrait pas à l’idée, en tout cas, de lui reprocher son narcissisme. Un artiste parle toujours de soi. En littérature, au cinéma, il y a deux solutions : soit c’est soi, soit c’est du faux, du bluff, de la littérature littératureuse, du cinéma genreux, endimanchée, du toc.
Mais que le narcissisme, certains vous soupçonnent de vouloir à tout prix vous glorifier ou vous inscrire dans l’histoire.
Ça, en revanche, ce n’est pas faux. Ce que je veux inscrire dans l’Histoire, c’est ce que j’ai fait, que je suis seul à avoir fait et qui n’a donc que moi, que nous, Roussel et moi, pour laisser sa trace dans la chronique de cette guerre. Important ou pas, glorieux ou non, ce n’est pas la question. Mais enregistrer cela, apporter notre part de vérité, même modeste, ça, oui, il le fallait.
Donc pas d’objectivité ?
Vous avez déjà vu un documentaire objectif ? Le propre du documentaire est d’être subjectif. Parfaitement subjectif. Ne serait-ce qu’à cause de de cette décision souveraine que prend, à chaque instant, le documentariste et qui consiste à faire la part entre le cadre et le hors champ. Quiconque, dans le genre, prétend à l’objectivité est un tartuffe. Subjectivité et vérité, c’est le pari des écrivains. Et les cinéastes, ceux-là en tout cas, ceux qui ont repris des mains d’Astruc sa belle caméra-stylo, ne sont-ils pas des sortes d’écrivains ?
Vous ne m’expliquez toujours pas pourquoi vous êtes de tous les plans, comme vous le reprochent vos détracteurs.
D’abord parce que c’est mon choix. Mon choix, absolument souverain. Mais, ensuite, vous êtes drôle ! Les plans dans lesquels je suis ce n’est pas des plans préexistants dans lesquels je m’introduis. Ce sont des plans que je produis et qui n’existeraient pas sans moi. C’est comme ce que disait Benjamin quand il se moquait de la théorie de l’écrivain « témoin de son temps ». Pas du tout témoin, disait-il. Mais géniteur. Instaurateur. Origine en même temps que témoin de ce qu’il s’assigne la tâche de raconter. Un écrivain ne dit pas son temps, il l’invente.
Justement, oui. Vous êtes écrivain. Votre sujet, ce sont les mots. Pourquoi avoir eu besoin de faire un film ? Est-ce que le livre, La Guerre sans l’aimer, ne suffisait pas ?
Il n’y a pas d’un côté un livre et, de l’autre, un film. Il y a deux livres. Vraiment deux. Dont l’autre, le second, a pour matériau d’écriture les images. Et attention ! Quand je parle de l’écriture du film, je ne parle évidemment pas du commentaire et de la voix off – ce serait trop facile. Je pense à un autre texte, invisible, silencieux, mais beaucoup plus construit que celui La Guerre sans l’aimer et qui est au cœur secret du film. La Guerre sans l’aimer est un texte épars, écrit au jour le jour, fragmentaire. L’autre, le film, est un texte construit, architecturé, bouclé sur lui-même, cohérent, bref, un vrai livre. La forme élaborée de La Guerre sans l’aimer, c’est Le Serment de Tobrouk – voilà.
C’est la seule différence ?
Non. Il y en a encore une autre. Le Serment de Tobrouk m’a, aussi, permis d’aller plus loin dans ce qui est l’autre grande affaire des écrivains et qui est de retoucher, de livre en livre, leur autoportrait en mouvement. Dans ce film, il s’est joué deux choses, très intimes, et qui furent, pour moi, très importantes. Retrouver l’ombre de mon père, jeune Français Libre foulant soixante-dix ans plus tôt les mêmes sables que moi. Et puis voir surgir, pour la première fois, une autre figure, non moins constituante, qui est celle de mon grand-père maternel, Chalom de Chalom Siboni, dont le fantôme me saute pour ainsi dire à la figure dans des conditions bien romanesques. Alors Le Serment n’est pas un roman, mas un film ? Eh bien non, justement. Un film, donc un roman. Un roman par le film. La preuve.
Je retiens, en tout cas, que vous assumez la dimension d’autoportrait…
Oui. Non sans crainte. Car vous connaissez le titre de Derrida : L’autoportrait et autres ruines. Et puis cet autre mot, je ne suis pas sûr qu’il soit de lui, peut-être de Deleuze, je ne sais pas : l’autoportrait c’est le « tombeau du sujet en film », Mais bon. Je prends le risque.
Était-ce la fonction d’un film sur la guerre ?
C’est l’aventure de tout écrivain. Régler la focale entre soi et soi. Entre son commencement et son origine. Un écrivain est quelqu’un qui ne cesse de fouiller dans cet espace-là, cet entre-deux, et de le mesurer. Que cela relève d’une autre logique que le sauvetage des libyens, je le conçois. Mais une fois ceux-ci sauvés, une fois les travaux de la politique achevés, pourquoi pas ?
Vous êtes, comme Cocteau, pour un décloisonnement des domaines artistiques ?
Je ne suis pas « pour » ce décloisonnement. C’est une donnée de la situation. Du point de vue d’un écrivain, il n’y a pas de différence entre un essai, un film, une pièce de théâtre, un haïku, un roman. Son imaginaire est, de fait, décloisonné. Et cela pour la bonne et simple raison que c’est quelqu’un qui travaille avec le même souffle, avec le même corps, sur les mêmes réserves, avec les mêmes arrières, quand il écrit avec les mots ou bien avec les images.
Il y a bien des différences, tout de même ?
Oui. Mais pas si grandes qu’on croit. Et bien moins importantes que les ressemblances. Pour moi, en tout cas, c’est très clair. Les quelques camarades qui m’ont vu à la table de montage, avec Vojta Janiska, savent que j’ai monté ce film comme on monte un texte. Collures… Collages… Palimpsestes… Reprises… Ponctuations… Brouillons… La même chose.
Pour vous, les films d’écrivains constitueraient un ensemble à part, étrange, singulier, dans l’histoire du cinéma ?
Sans doute, oui. Et c’est même la grande erreur que commet le Syndicat quand il voit paraître le film d’un écrivain…
De quel syndicat parlez-vous ?
Le Syndicat de la critique. Ce groupe de gens qui se connaissent tous et qui décident souvent, avant de voir, ce qu’ils vont collectivement penser des films. Je n’ai rien contre, notez bien. C’est un mode de fonctionnement comme un autre. Il faut juste en être conscient. Le Syndicat, donc, quand il voit arriver un film de Houellebecq, ou de moi, ou de Moix, ou, jadis, de Romain Gary ou de Cocteau décide, a priori, que c’est nul. Pourquoi ? Parce qu’il a ses cadres préétablis. Et que, le film de Gary, il le compare aux films de Truffaut, ou de Chabrol, ou à n’importe quel film contemporain – alors que son vrai contexte, celui où il fait sens, c’est évidemment les autres films de Gary, je veux dire, ses livres, le reste de son œuvre. De même pour Cocteau dont on trouvera les films emphatiques, grotesques, lamentables si on les compare à ceux d’Autant Lara – mais qui deviennent magnifiques si on les réfère à ses poèmes, ou à Thomas l’Imposteur.
Et le Syndicat, comme vous dîtes, n’est pas capable de comprendre cela ?
Ben non. Pas toujours. D’autant qu’il a des méthodes bizarres, le syndicat. Prenez le cas Assouline, Pierre Assouline, qui a une sorte de blog où il éreinte mon film tout en disant qu’il n’ira pas le voir (il est vrai qu’il n’est pas exactement critique de cinéma). Je me souviens de ce situationniste, à la fin des années soixante, qui s’appelait Mustapha Khayati et qui avait publié un mémorable De la misère en milieu étudiant On attend, quarante ans après, un « De la misère en milieu écrivant ».
Quel est la nature des liens entre littérature et cinéma ?
Si on prend le problème du point de vue des écrivains, je viens de vous le dire : une extension du domaine de la lutte littéraire. Si vous le prenez de l’autre côté, celui des gens de cinéma, c’est autre chose : une source d’inspiration – voyez Truffaut citant le Journal de la Belle et la Bête de Cocteau comme l’un des arts de filmer les plus importants de l’époque…
Mais le cinéma, n’est-ce pas tout ce qui échappe au scénario ?
Au scénario, d’accord. Mais à la littérature ? N’échappe pas qui veut à la littérature. Que voulez-vous dire ? Qu’il y a une servitude innée du cinéma à la littérature. Celle-là même dont un de mes maîtres, Jacques Derrida, disait qu’elle asservit la parole à une sorte d’archi écriture. Ça ne veut pas dire, naturellement, que le cinéma n’en sorte pas. C’est le cas de Godard. Il est celui qui a le mieux reconnu, identifié cet asservissement fondamental (voyez toute l’histoire de la Nouvelle Vague dont il aura passé sa vie à tenter de s’extraire ; voyez ce qu’il dit, justement, de l’histoire de la caméra stylo – je cite de mémoire : « un truc que Sartre a refilé au jeune Astruc pour faire passer l’image sous la guillotine des mots »). Et il est celui qui, par exemple dans A Bout de souffle, est allé le plus loin dans la tentative d’émancipation.
Mais il n’y a pas qu’A bout de souffle…
Oui, mais il y a un héroïsme godardien qui est d’avoir tenté, et parfois réussi, cette émancipation du cinéma hors du champ de la littérature. Il aime la littérature. Il est lui-même une sorte d’écrivain. Mais il a lu Derrida et il sait que l’écriture, on ne s’en déprend pas si aisément ; il sait que l’écriture est une prison terrible ; et il est un Maître pour ces raisons mêmes – il connaît la question et il est celui qui s’est donné le plus de mal pour conjurer la malédiction. Alors, après, le problème reste entier. Le grand problème du cinéma c’est celui de cette servitude à la littérature. Ou, si vous préférez, le surmoi littéraire du cinéma, Et c’est d’ailleurs sans doute pour ça qu’on fait généralement la peau aux écrivains qui font du cinéma. Ils lâchent le morceau. Ils passent aux aveux. Ils sont ces mal élevés qui décident de lever le voile sur la servitude originaire du cinéma par rapport à la littérature. Et ça ce n’est pas acceptable.
Après la guerre de Libye, vous avez déclaré avoir agi au nom de votre judéité. En quoi le judaïsme est-il un moteur ?
Je ne l’ai pas seulement dit après. Je l’ai dit tout le temps. Et, en particulier, à chaque étape, à mes amis libyens. Ce judaïsme a forgé ma vision du monde. Ou, en tout cas, ma morale. Il l’a fait tard, d’accord. Je suis issu, comme je le disais à Houellebecq dans notre livre de correspondance, d’une famille déjudaïsée où l’on pensait que le judaïsme est un fardeau, qu’il met en danger, qu’il faut l’oublier. Mais enfin j’y suis venu. Et ce judaïsme de la dette, de la responsabilité pour l’autre, du surplomb, qu’ont pensé Rosenzweig ou Levinas, j’ai dû le retrouver, je l’ai fait mien et c’est lui qui m’anime en Libye. On m’a beaucoup reproché d’avoir dit que c’est « en tant que juif » que j’ai participé à cette guerre en Libye. C’est, pourtant, tellement évident.
Et quand Abdeljalil, que vous avez si ardemment soutenu, fait cette déclaration sur la Charia ?
Je me dis, comme Swann à la fin de La Recherche : « et dire que j’aurai fait tout cela pour quelqu’un qui n’était pas mon genre ».
Ma théorie c’est qu’Odette est parfaitement le genre de Swan et qu’il se ment.
Vous avez sans doute raison. Proust n’est pas idolâtre. Il ne croit pas non plus, tant que cela, aux Idées. Et moi, finalement, non plus. Abdeljalil, je l’accepte tel qu’il est – empêtré dans ses insolubles contradictions.
Marine Le Pen veut vous poursuivre en justice pour diffamation. Votre réaction ?
Excellente chose. A transformer en grand procès public montrant que le Front National n’a pas changé ; que le fond nazi est toujours là ; je suis enchanté.
Comment seraient reçu un Malraux ou un Sartre aujourd’hui ? Impression que nous vivons dans un temps où l’on se moquerait de l’un pour son lyrisme, de l’autre pour son tonneau à Boulogne-Billancourt, que l’héroïsme et l’engagement sont souvent moqués…
Nous vivons dans un temps où l’on ne supporte pas qu’un écrivain « la ramène ». Et, s’il « la ramène » trop, on fera tout pour le réduire, le rapetisser et, à la limite, l’annihiler. C’est embêtant pour moi, bien sûr. Car je suis, je le sais bien, le prototype de ça. Mais bon…
Vous parliez de ça avec Houellebecq dans votre correspondance…
J’ai une vision « héroïque » des choses et de mes contemporains. Houellebecq, lui, a une vision plus nihiliste. Mais ce dont on s’est aperçu en écrivant Ennemis publics c’est qu’on nous reprochait quand même la même chose : de la ramener ; et qu’on avait à peu près les mêmes ennemis, comme l’étrange Pierre Assouline, l’homme qui parle des livres ou des films en disant qu’il ne les verra pas.
Qu’appelez-vous, au juste, « vision héroïque » ?
La nostalgie de la grandeur. Celui qui en a le mieux parlé c’est Pierre Guyotat dans ses entretiens avec Marianne Alphant. Je ne m’y résigne pas, moi non plus, à vivre dans un monde qui a perdu ce sens de la grandeur. Je ne me résigne à ce que le goût de l’héroïsme par exemple, ou tout simplement le souci de l’autre, disparaissent de notre univers. Les grands thèmes de mon film, finalement, c’est quoi ? La fraternité (avec les Libyens). La transmission (la mémoire de la France Libre). Le dialogue entre les vivants et les morts (ce que j’appelle, après Benjamin encore, la revanche des vaincus).
Les attaques vous affectent ?
Non. Encore qu’il m’arrive de repenser à ce mot de Rilke que cite Romain Gary en pleine affaire Ajar : « Si le temps passe et que ton nom circule parmi les hommes, n’en fais pas cas ; pense qu’il est devenu mauvais et jette-le ; prends-en un autre, n’importe lequel, pour que Dieu puisse t’appeler en pleine nuit ; et tiens-le secret à tous ».
Vous avez parfois dit qu’elles touchaient un « autre moi », un hologramme de soi…
Le modèle c’est Pythagore dont la légende voulait qu’il eût vécu « vingt vies en une vie » – un concentré d’expériences, sensations, libertés vécues, réflexes, fidélités et infidélités, entêtements et apostasies, ruptures encore. Donc deux moi, oui – au moins !
Aujourd’hui, qu’allez-vous faire ?
Essayer de convaincre François Hollande de prendre l’initiative en Syrie. Il a le choix entre son maître et son prédécesseur. Il peut être Mitterrand (non-intervention en Bosnie) ou Sarkozy (ingérence réussie en Libye). Ce film, Le Serment de Tobrouk sert à ça, à montrer ça.
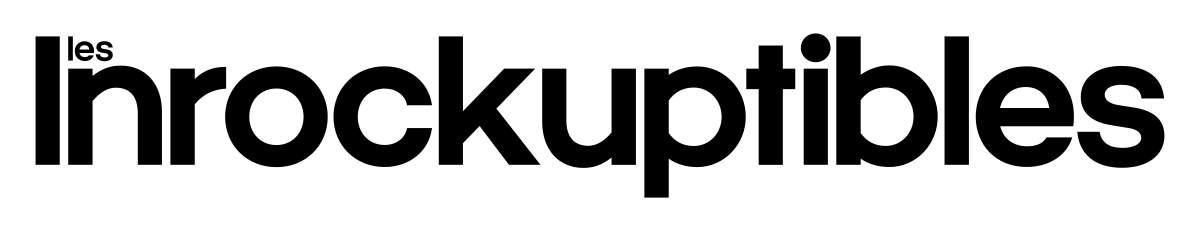
Réseaux sociaux officiels