Chacun se souvient, sans doute, de cette photo. Deux longues mains sorties d’une djellaba blanche, l’une empoigne les cheveux d’un jeune homme, l’obligeant à baisser la tête, l’autre presse un revolver sur son crâne. Le jeune homme, assis, les mains enchaînées, vêtu d’un jogging un peu criard, s’appelle Daniel Pearl. Il est encore vivant. Peu après, il sera égorgé, puis dépecé, et son supplice sera filmé. Cela se passe à Karachi, la ville la plus peuplée d’un grand pays, le Pakistan. Daniel Pearl, journaliste au Wall Street Journal, était juif et américain. Cela suffit-il à expliquer pourquoi il a été si sauvagement assassiné ? Bernard-Henri Lévy se trouvait à Kaboul, dans le bureau de Hamid Karzaï, alors président de l’Autorité intérimaire afghane, quand il a appris la mort de Daniel Pearl. C’était au début de l’année 2002. « J’ai reçu cette nouvelle comme un choc à l’estomac, très violent, et j’ai décidé d’aller voir de très pourquoi Daniel Pearl était mort, sans avoir pour autant encore l’idée d’en faire un livre. » Pendant un an, Bernard-Henri Lévy a enquêté. Pendant un an, on le sent à le lire, il n’a cessé, minute après minute, de penser à Daniel Pearl, à ses assassins, et de se répéter : pourquoi ? Pas à pas, il a suivi les traces du reporter américain, de la Californie jusque dans les méandres de Karachi. Et puis, à Londres et à Lahore, à Sarajevo et à Kandahar, il a cherché à comprendre qui était Omar Sheikh, un jeune homme lui aussi, l’architecte de l’assassinat de Daniel Pearl, celui qui a minutieusement préparé son enlèvement, sa séquestration et sa mise à mort. Au travers d’Omar Sheikh, brillant élève des meilleures écoles anglaises, fils de bonne famille, amateur d’échecs et de parties de bras de fer, c’est dans le vertige du terrorisme intégriste que nous entraîne Bernard-Henri Lévy. Les cinq cents pages de son livre se lisent d’une traite. Non sans effroi. Qui a tué Daniel Pearl ? dresse le portrait du Pakistan, pays, écrit-il, « drogué au fanatisme, dopé à la violence, qui a perdu jusqu’à l’idée de ce que peut être une presse libre. » Ce Pakistan dont les services secrets ont façonné les talibans en Afghanistan, cette république islamique si fière de posséder l’arme atomique. Enquête sur les réseaux fondamentalistes musulmans, Qui a tué Daniel Pearl ? pose les vraies questions sur le terrorisme international. « Qui triomphera, de l’islam modéré ou fanatique ? », demande Bernard-Henri Lévy. Et il précise : « C’est la grande affaire du siècle qui commence. »
ANNICK LE FLOCH’HMOAN : Vous semblez avoir ressenti la mort de Daniel Pearl comme un choc personnel. Le connaissiez-vous ?
BERNARD-HENRI LÉVY : Je l’avais probablement croisé une fois, mais je ne le connaissais guère plus. La nouvelle de sa mort m’a bouleversé, je l’ai reçue comme un coup de poing. Était-ce l’image fugitive que j’avais de lui ? Était-ce ce que je savais de lui, ce qu’on lisait dans les journaux ? Je sentais que c’était un type formidable. Un Juste. L’un de ces Occidentaux qui, sans tomber dans le tiers-mondisme bête qui consiste à accabler l’Occident de tous les crimes, était obsessionnellement ouvert à l’altérité, curieux du visage du différent, en quête perpétuelle de ce qui ne lui ressemblait pas. Occidental, il était à l’écoute de toutes les cultures du monde. Juif, il était à l’écoute de la culture arabo-musulmane. Il apprenait l’arabe. Il avait ce souci absolu de l’autre.
Vous ressemblait-il ?
Je n’en sais rien. Ce n’est pas la question. Ce que je peux dire, c’est que les valeurs qu’il défendait sont les miennes, ce sont celles pour lesquelles je me bats depuis longtemps. J’aime aussi sa gaieté, son optimisme. Et j’aime, en même temps, qu’il ait eu les yeux grands ouverts, qu’il ait été à l’écoute de la rumeur du monde dans ce qu’elle peut avoir de plus tragique. Ni aveugle ni mélancolique. Refusant de faire l’impasse sur le tragique de la condition humaine sans pour autant céder à la logique de ressentiment. Qui dit mieux ?
L’essentiel de votre livre est consacré à Omar Sheikh, l’assassin, le fondamentaliste musulman. Votre plongée dans l’esprit de cet homme d’à peine 30 ans donne le vertige.
Moi-même, je sors de là complètement effaré. Car la grande leçon de ce cas Omar Sheikh, c’est que les assassins sont là, parmi nous, proches de nous, nous ressemblant. Bien sots sont ceux qui les imaginent comme des êtres absolument étrangers, portant les stigmates bien visibles de leur monstruosité. Omar Sheikh a été un citoyen anglais exemplaire. Ses camarades d’alors, que j’ai retrouvés, se souviennent d’un garçon brillant, démocrate, bien-pensant. Et, un jour, ça bascule. Cela vaut pour Omar. Mais je suis sûr que la même logique vaudrait, exactement, pour des gens comme Ben Laden ou Mohammed Atta (un des terroristes du World Trade Center, ndlr), ou d’autres. Tous ces gens ne sortent pas des écoles coraniques obscurantistes du Pakistan. Ils sont passés par les meilleures écoles européennes. Ils ont été formés par nous, à l’intérieur même des sociétés démocratiques. Grande leçon de modestie : ces terroristes sont les enfants naturels de l’Occident et de l’islam ; ces gens qui veulent détruire l’Occident, qui haïssent la démocratie, qui en veulent à la liberté des mœurs des femmes et des hommes occidentaux, ils sont aussi les produits de l’Occident.
Vous écrivez que vous ne croyez pas aux explications style enfant humilié, rejet, désir de revanche. Pourquoi ?
Parce que la plupart de ces gens sont des nantis, des bourgeois, parfois des fils de famille : le contraire du profil damné de la terre né dans un faubourg pourri du Caire ou de Karachi et prenant sa revanche.
Et les gamins de nos banlieues qui se sentent rejetés de notre société ?
Dans cette mouvance islamiste, vous avez les chefs et les fantassins. Ceux-ci, bien sûr, viennent des couches déshéritées de la société. Mais les autres, ceux qui les envoient à la mort et qui se gardent, eux d’y aller, les gens qui programment l’enlèvement de Daniel Pearl ou la destruction du World Trade Center, bref, ceux qui dirigent Al-Qaïda, ne viennent jamais des banlieues. Ce sont des fils de famille, je vous le répète. Ils sont formés dans les meilleures écoles. Plus terrifiant encore, on ne peut même pas vraiment dire qu’ils soient étrangers à l’esprit des Lumières.
Omar Sheikh, avez-vous découvert, était vierge à l’âge de 29 ans. Et vous évoquez « le fond de panique et d’effroi, cette peur et parfois ce vertige face au sexe féminin » des fondamentalistes. Quel est cet effroi concernant les femmes ?
C’est l’une des sources de cette affaire. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le combat des femmes, et pour les femmes, est, en terres d’islam, si important. Quand les femmes se battent, ce n’est pas uniquement pour leur liberté, mais pour la liberté de tous. Elles sont les combattantes de première ligne. Elles sont le démenti vivant à une imbécilité criminelle dont le fond est, je crois, la volonté de pureté. Un intégriste – musulman ou non –, c’est quelqu’un pour qui la femme représente l’impureté. Le sexe féminin, dans son imaginaire, c’est le gouffre, la source des pires vertiges, le mal. Savez-vous que la seule disposition testamentaire que laisse Mohammed Atta, c’est qu’aucune femme ne s’approche de sa dépouille et ne touche son corps et, plus encore, son sexe sans s’être munie de gants ? Tous ceux qui ont approché Ben Laden savent qu’il y a, chez lui aussi, cet effroi, cette attitude de rejet et de dégoût vis-à-vis des femmes. Eh bien, Omar Sheikh, mon personnage, ce type qui est vierge à 29 ans et qui vit dans la phobie des femmes, est, là aussi, un prototype.
La toute première femme de son existence, Sadia, celle qu’il épouse, est une jeune angliciste, titulaire d’une maîtrise de l’université du Pendjab. Mais elle est voilée de la tête aux pieds, ne sort pas de chez elle et, en train, ne voyage que dans la partie femmes des compartiments, cachée derrière un rideau.
C’est une femme, je pense, intelligente, ouverte, frottée, encore une fois, aux Lumières. Voilà donc deux personnages, Omar et Sadia, qui ont été façonnés par les Lumières, par l’Europe, et qui sont devenus, l’une sous sa burqa, l’autre sous le soleil de Satan, des combattants de la grande armée du fondamentalisme.
À l’exception de Sadia, ce fantôme reclus, les femmes sont totalement absentes de votre enquête au sein du terrorisme islamiste.
Oui. Forcément. Puisqu’il s’agit d’un monde sans femmes. C’est la première chose qui me frappe dès l’instant où je débarque à l’aéroport de Karachi, dans cette atmosphère tendue, dans ce climat d’état de siège, avec des types qui vendent, sous l’œil indifférent des militaires, des cartes postales à l’effigie de Ben Laden : le Pakistan est un pays où les femmes sont invisibles. C’est une impression très étrange. Et très pénible. Comme si une bombe à neutrons très spéciale avait éliminé les femmes du paysage. À Islamabad, à Rawalpindi, c’est un peu différent, on voit des femmes. Mais Karachi, cette capitale du fondamentalisme, la ville d’Al-Qaïda où Ben Laden, encore récemment, est venu se faire soigner, est une ville sans femmes.
Votre longue enquête vous a permis d’établir que des liens étroits existent entre les groupes fondamentalistes musulmans établis au Pakistan, Al-Qaïda et les services secrets pakistanais.
En effet. Et cela pose, à mes yeux, un sacré problème. Vous avez là le plus voyou des États voyous. Un État terroriste qui, de surcroît, possède l’arme atomique.
Pourquoi George Bush, dans sa croisade contre le terrorisme, prend-il pour cible l’Irak et maintenant la Syrie, et non le Pakistan qui semble infiniment plus menaçant ?
C’est le grand mystère. Je n’ai cessé, tout le temps de mon enquête, de me poser la question. Il y a plusieurs interprétations possibles. Ou bien les Américains ne savent pas, ce dont je doute. Ou bien ils ne peuvent rien faire ou on le sentiment de ne pouvoir rien faire. Ou bien encore ils ont une stratégie à plus long terme qui consiste à frapper les maillons les plus faibles pour en venir, un jour, au point qui représente le plus grand danger. En tout cas, pour l’heure, le fait est là. L’administration américaine parle d’États-voyous. Mais elle n’évoque pas le plus voyou d’entre eux, le Pakistan. Ce pays dispose d’armes de destruction massive qu’une partie de son élite dirigeante est prête, demain matin, à livrer aux terroristes d’Al-Qaïda. Le Pakistan est l’œil du cyclone, le centre de gravité de cette lutte sans merci qui opposera les démocrates du monde (pas seulement de l’Occident) à l’islamisme radical. C’est du Pakistan que sont venus les assassins de Massoud, c’est le Pakistan qui a fait les talibans. Et une des découvertes de Daniel Pearl, ce qu’on craignait peut-être qu’il n’écrive, ce pourquoi on l’a assassiné, c’est que le Pakistan est un pays où des terroristes peuvent acquérir des éléments pour faire une bombe atomique.
Le chef de l’État pakistanais, le général Musharraf, parle-t-il donc un double langage quand il affirme faire la guerre au terrorisme ?
Il est possible qu’il soit sincère quand il dit qu’il prend le parti de la démocratie. Mais, dans ce cas, il est terriblement faible est isolé. C’est un président de la République désinformé par ses propres services secrets. Il n’a peut-être déjà plus la réalité du pouvoir. Il est peut-être une marionnette instrumentalisée par les groupes islamistes.
Votre enquête fait froid dans le dos. Allons-nous vers une « guerre des civilisations » ?
La vraie guerre des civilisations, c’est la guerre à l’intérieur même de l’islam, entre l’islam modéré et l’islam intégriste. Et l’issue de cette guerre est donc, au moins pour partie, l’affaire des musulmans eux-mêmes. Les intellectuels musulmans, les chefs religieux, les personnalités de la société civile se doivent de prendre position, de dire non à la politique du crime, de refuser la stratégie du martyre, etc. Mais c’est aussi notre affaire. Nous avons le devoir, nous, démocrates occidentaux, de les soutenir, de leur tendre la main, de leur montrer qu’ils ne sont pas seuls. Soutenir, aujourd’hui, les femmes algériennes, les démocrates afghans, les intellectuels du monde arabo-musulman, est aussi important que l’était, dans les années 70, le soutien aux dissidents de l’Est ou, dans les années 30, le soutien aux résistants antinazis. Il en va de notre responsabilité.
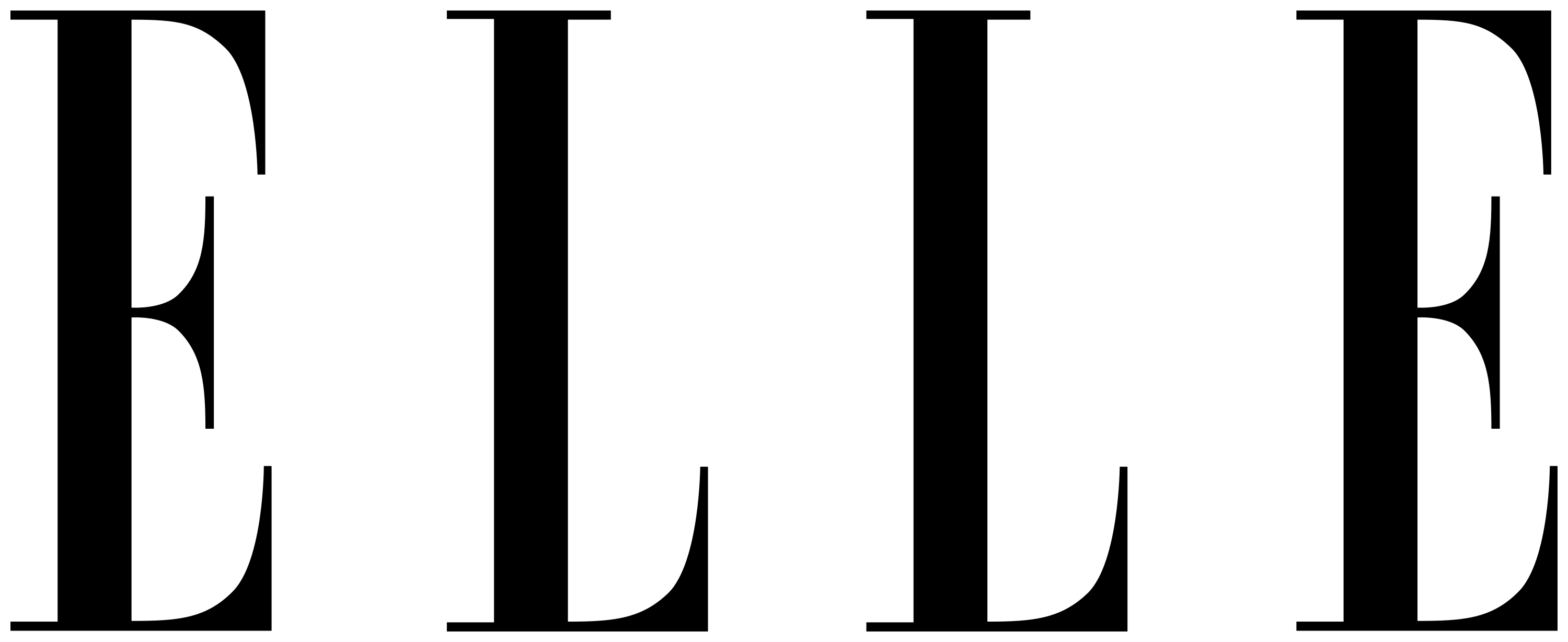
Réseaux sociaux officiels