On a, comme tout le monde, été parfois exaspéré par le personnage de Bernard-Henri Lévy. Voilà un garçon qui, depuis trente ans, publie un livre par an, qui est à chaque fois reçu sur tous les plateaux de télé où il semble chez lui et tient le crachoir. Et voilà qu’il sort un livre de 500 pages sur cette épouvantable histoire du journaliste américain Daniel Pearl, enlevé puis assassiné à Karachi, par des militants islamistes, en janvier 2002. Vous voudriez que nous marchions dans la combine, le houpla médiatique, et allions acheter ce bouquin dans lequel, si l’on comprend bien, un juif français dresse la statue d’un juif américain, fustige l’islam en général et le Pakistan en particulier, et reprend sur un mode plus intellectuel ces théories paranoïaques dont l’Amérique de M. Bush se sert pour asservir le monde ? Tenez. Sans même acheter le livre, je feuillette la préface en librairie. Page 11 je lis (sous la plume de M. Lévy, donc) cette question qu’il se pose : « Comment ça marche, le démoniaque, aujourd’hui ? » Et page 13, toujours dans la préface, ce jugement sur le Pakistan : « Je le voyais devenir la propre maison du diable ». Est-ce là du journalisme ou de l’exorcisme ? Allons. N’entrez pas dans le tapage des médias. Épargnez-nous BHL.
J’ai commencé à lire Qui a tué Daniel Pearl ? un mardi matin. Au bout de quelques pages, les préventions sont tombées. Un vent s’est levé : le souffle des grands livres. J’ai traversé des pages terribles, qui ôtaient jusqu’à l’envie de pleurer. J’ai été emporté, poussé dans le dos, de Londres à Karachi, de Kaboul à Dubaï, de Los Angeles à Delhi. J’ai senti des parfums inconnus, pénétré dans des arrière-boutiques sordides, dormi dans des lits où j’avais peur. J’ai déjeuné d’un sandwich, Paris paraissait si loin par la fenêtre. Vite, replonger. Retrouver les flics véreux et menaçants, les informateurs qui tremblent, les pistes qui se ferment, les salles de documentation où l’on se sent hors du monde, les pistes qui s’ouvrent, les doutes, les témoins qui se souviennent mal, les avocats un peu trop brillants, les barbus qui lancent de mauvais sourires. Les sentiments se succédaient en désordre, avec la brutalité hachée des éclairs de stroboscope dans une boîte de nuit. Stupéfaction. Pitié. Colère. Compassion. Admiration. Accablement. Puis le rythme s’est ralenti. Page 471, j’ai marché, au tempo accablant d’une marche funèbre, dans les derniers pas de Daniel Pearl. Le livre s’est bientôt achevé. Il faisait largement nuit. Je n’avais qu’une envie, parler de ces pages qui secouent le cœur, le cerveau et les tripes.
Un mot sur la méthode. BHL ne s’en cache pas : il écrit, dit-il, un « romanquête ». Lorsqu’il dispose d’informations sûres, tant mieux, il les donne. Lorsque les informations se font éparses, ou contradictoires, il doute, devant nous. Et lorsqu’il n’a rien dans les mains, il échafaude. Cette façon de faire, clairement annoncée, était celle de Norman Mailer dans un livre fameux, auquel celui-ci se compare, sur Lee Oswald, l’assassin de Kennedy. Elle suppose qu’on dispose de bonnes informations (c’est le cas), que les parties échafaudées soient étayées avec rigueur (c’est le cas) et qu’on distingue clairement ce qui ressort de l’un et de l’autre registre – ce n’est pas toujours le cas : seule faiblesse de ce livre.
Le tombeau d’un juste
Mais, contrairement à tant d’ouvrages approximatifs sur le terrorisme, l’effet de flou qui saisit parfois BHL n’est pas le moyen de cacher un fond médiocre. C’est au contraire la conséquence naturelle d’une sincérité qui saute aux yeux. Si ces pages brûlent parfois quelques feux rouges des conventions journalistiques, c’est qu’elles brûlent d’un feu autrement important, celui de l’urgence, de la nécessité et d’un engagement personnel radical. Lévy a fait sien le destin de Danny Pearl. « J’ai mis un contrat sur sa tête, explique-t-il, mais c’est pour le ressusciter. » Et il y parvient. C’est le premier mérite de ce livre, dresser le tombeau d’un juste. Pearl était un journaliste d’exception, un homme cultivé, un libéral, il aimait et pratiquait la musique, il cultivait le doute, il savait rire de lui-même, il incarnait au fond ce que l’Occident a de meilleur. Le chapitre où Lévy rencontre les parents de Pearl, dressant à travers eux son portrait, est un moment de grâce. Voilà pourquoi sa mort nous concerne tous. Ses assassins ont voulu, en le décapitant, trancher un idéal qui est le nôtre.
Mais voici que le livre s’enfonce dans les ténèbres. Il part sur la piste d’Omar Sheikh. Cet Anglais d’origine pakistanaise a 30 ans. Il attend aujourd’hui en prison, au Pakistan, son procès en appel, après avoir été condamné à mort pour l’enlèvement et le meurtre de Danny Pearl. Sheikh n’est pas un damné de la Terre. Tout le contraire. Né dans une famille aisée. Éduqué dans les meilleures écoles. Joueur d’échecs brillant. Puis un jour tout se brise. Il part en Bosnie. Se faufile dans la galaxie islamiste. Renonce à un avenir de banquier à la City. Apprend à tuer, multiplie les identités, gagne ses galons en Afghanistan, au Cachemire, au Pakistan. Le jeune homme lumineux, qui aurait fait un très bon copain pour Danny Pearl, se laisse happer par… Par quoi, d’ailleurs ? La religion ? Prétexte, bien sûr. L’envie de pouvoir, d’être un chef, en 4×4, avec gardes du corps et trois portables et des liasses de dollars dans sa poche ? Insuffisant. La haine des femmes, la mythomanie, la paranoïa ? Sûrement. Mais le mystère demeure. À ce mystère, BHL donne le nom du « mal », ou du « diable ». On peut lui chipoter les mots. Mais pas le fond. Et il faut lui reconnaître un mérite. Pour la première fois, grâce à ce livre, nous pouvons approcher (sinon comprendre) le creuset qui transforme un garçon sympathique en un guerrier recru de haine.
Le livre va plus loin encore. Au-delà d’Omar Sheikh, il entre dans le monde de ses semblables, les combattants de l’islam fanatique. BHL nous emmène, terrifiés, de madrasa (école coranique) en hôtel borgne, d’un camp d’entraînement à un bureau de ministre. Au centre de ce monde qui a un pied dans le Moyen Âge et l’autre dans Internet, un pays – le Pakistan –, une ville – Karachi –, et une hydre à vingt têtes, les services secrets de ce pays, allié des États-Unis et doté de la bombe atomique. L’avenir dira si la thèse de Lévy – que les services pakistanais dirigent le terrorisme mondial, Al-Qaida compris, et contrôlent déjà l’arme nucléaire – est prémonitoire. En tout cas, elle convainc, et fige le sang.
Une lourde nuit a passé depuis la lecture du mot Fin. Les deux figures symétriques de Danny Pearl et d’Omar Sheikh se sont estompées. Le récit tragique a déjà glissé dans la mémoire. Les thèses sur le terrorisme ont pris leur place dans le cerveau rationnel. Il reste, ce matin, le reste : des mots et des images. Karachi, « ciel d’automne humide et fumeux, lumière pluvieuse », où les adolescentes bangladaises coûtent 70 000 roupies, « dont 10 % pour la police ». Karachi où l’on voit des « spectres titubant dans la demi-pénombre de la nuit qui vient ». Lahore, où le chef de la police, dans son « bureau modeste et un peu sale » débite, l’air narquois, les habituelles saloperies de l’antisémitisme. Londres, où par la fenêtre d’une maison cossue, celle où est né Omar, on aperçoit les coquetiers prêts pour le petit déjeuner. Dubaï, « la Las Vegas arabe », et « son ciel bleu glacé ». Les cafés Internet miteux. Leur monde. Notre monde. Et là-dessus, le fantôme souriant d’un homme découpé en dix morceaux parce qu’il était journaliste, juif et américain, dans l’ordre que vous voudrez.
Post-scriptum : un drôle de sentiment qui émerge. Un mot qu’on a envie d’écrire, que suscite ce livre. Fraternité. Lévy, l’écrivain courageux. Pearl, le journaliste lumineux. Nos grands frères.
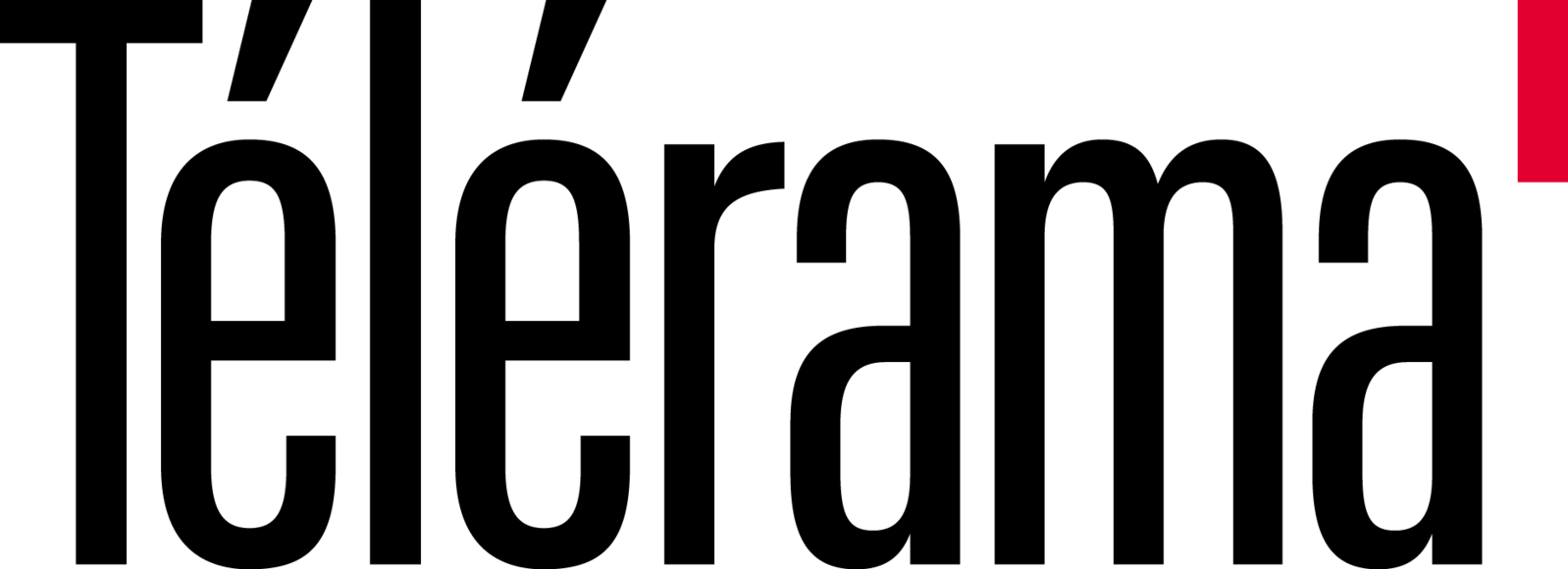
Réseaux sociaux officiels