JEAN-FRANÇOIS KERVÉAN – Le courage inquiet
C’est un livre. Juste un livre, 500 grammes de mots écrits solitairement. Cette vérité de la littérature honore quiconque la choisit et s’y consacre… quand bien même serait-il BHL. Comédie n’a rien de la fin d’un homme, mais plutôt le courage inquiet de faire face à la fin d’un moment. Moment qui dura vingt ans. Un écrivain y raconte son péril d’aller aux médias comme on va au chardon. Comment s’impulsa la méga-perfusion entre cet auteur et cette époque. Après la lumière, il vient en raconter le spectre. On le croit. L’écriture, tactile, changeante, exprime comme un froncement de conscience. Un peu de dépit, aussi, pour une vague de cinéastes « de cuisine » ou quelques maitres du silence… Gracq. Des Forêts. Debord… Debord, ce double qui théorisait en dehors du bocal une société du spectacle à laquelle l’autre, frelon de trois lettres, se mesurait en voulant (con)vaincre. Pour en sortir, BHL décida d’être ailleurs, d’être épique… On ne crut ni à son cinéma ni à son lyrisme. Comédie raconte ce choc, ce « bide-bang », dressant, en creux, l’autoportrait d’un artiste aux prises avec la modernité. Dans une société de plus en « rentrée », celui-là fut sans cesse hors de soi, hors de lui, mû non pas tant par l’arrivisme que par un désir adolescent d’exister, de servir. De tout traverser du monde, ses gouffres, ses causes, ses vanités, de tout obtenir, sans rien perdre de soi, ce qui demeure le rêve fêlé de chaque artiste. Lui a tout fait. Les thèmes tournoient, des amphétamines à la nécessité fantoche d’être reconnu. Il est entré partout, à cheval, romantique et condottiere, dans une époque petite. A travers les cent fragments d’un jour, Comédie raconte l’impossible fusion entre l’artiste et son monde. C’est un hommage obsessionnel à l’art, à toutes ses pulsions, belles et vilaines, façon de dire combien cette foi l’habite. Jusqu’à ce livre, où certains auraient voulu que deux phrases, si belles à la fin d’un chapitre saturé – « Je suis si triste, si fatigué » –, s’étalent sur deux cents pages, en expiation. Mais non. Bernard-Henri Lévy donnera encore du grain à moudre aux flics de sa prose et de son ego. Dans Comédie, deux beautés rayonnent ; un pays et un don, le Maroc et l’élan. Un désir, dans le monde auquel il s’est livré, de plisser les yeux sur tout ce qui vit, avec l’arme du langage pour le révéler. S’échappant sans cesse de l’introspection, ce regard tourné vers l’extérieur fascine, retenant une passante, un chat, un gamin… cent figures anonymes ou célèbres. Comme une disponibilité folle, malgré tout, à la vie, à l’humain. Au bout de cette journée, son vieux maitre, las de l’attendre, s’en ira sans le voir. Dans cette mise en abyme finale, ce frôlement dont rien ne résulte, il y a comme un aveu : ne peut-on que se manquer ? Lévy semble dire oui, mais il rêve non. C’est pour cela qu’on écrit. De ce chuchotement schizophrène naît la littérature, à laquelle il appartient.
PATRICE DELBOURG – Le tout-à-l’égo
Tout écrivain a bien le droit d’être amer comme chicotin tant qu’il n’a pas réussi. Pour M. Lévy, cette acrimonie devrait s’apparenter à une affaire classée. Voilà vingt ans qu’il quadrille le lopin médiatique. Il a connu le succès. Certes, l’année en cours fut plus maussade. Son film s’apparenta à un four. La belle affaire ! Tout créateur qui engendre s’expose aux sarcasmes de la critique (même quand il fait tout pour la contourner). A quoi bon publier alors un livre d’enfant gâté qui exprime son ressentiment vis-à-vis de tout ce qui bouge ? Le philosophe de Questions de principe I regrette d’être né éloquent. « Il n’y a qu’une imposture tenable, désormais. Une case gagnante et une seule. C’est celle du retrait vertueux, un peu glaireux, mais affiché – c’est celle des Blanchot, Le Clézio, Des Forêts… » (p.101). Ainsi donc, Julien Gracq n’apparaitrait jamais à la télévision uniquement dans le but de faire monter ses ventes chez Corti ! Allons donc, monsieur Lévy, l’aigreur vous égare. L’auteur ironise sur les confrères qui s’expriment avec difficulté. Hier Blondin, aujourd’hui Debray, Modiano. « Serait-ce une spécialité NRF ? leur botte secrète ? offriraient-ils à leurs auteurs des cours accélérés de bégaiement avec professeurs certifiés, travaux pratiques en vidéo, révision à la veille de la sortie des livres ? » (p.87). Et chez Grasset, quel est le rhésus ? L’arrogance paranoïaque. Avec une gravité abyssale, le philosophe de Questions de principe II égrène ses différentes nappes phréatiques : moi pétitionnaire, moi Solal, moi entarté, moi ontologique, il épépine sa « statue intérieure », tente l’intrépide scission du Bernard et du Henri, c’est le tout-à-l’ego. Devant ce catalogue des vanités, le dernier lecteur encore éveillé secouera l’autre. M. Lévy écume parce que, même en T-shirt noir, le public croit le voir arborant sa légendaire chemise blanche. Mais c’est la rançon du music-hall ! Jadis, même tête nue, le parterre des midinettes voyait Maurice Chevalier en canotier. L’auteur stigmatise le temps où « une génération nous tournait autour comme un papillon autour de la lumière ». Un phare, ne lésinons pas. Le philosophe de Questions de principe III veut poser au poète et à l’agitateur d’idées (comme la Fnac depuis 1954), il est à craindre que la postérité ne lui accorde que le second label. Les phrases semblent à peine tracées, tapées même comme certaines actrices s’étant trop montrées les soirs de générale. Quelques éclats cependant sur le maitre Althusser, Pessoa et ses hétéronymes, l’ombre de Malraux, la trajectoire de Romain Gary. Trop rares cependant pour faire oublier ce kouglof dépourvu de toute once d’humour, qui vous plombe durablement l’épigastre. Il y a cependant une belle phrase dans ce livre. Elle se situe à la quatrième ligne de la première page : « Ces gens qui vous serrent la main comme s’ils vous prenaient le pouls. » Hélas ! elle vient de Jules Renard. Tant pis.
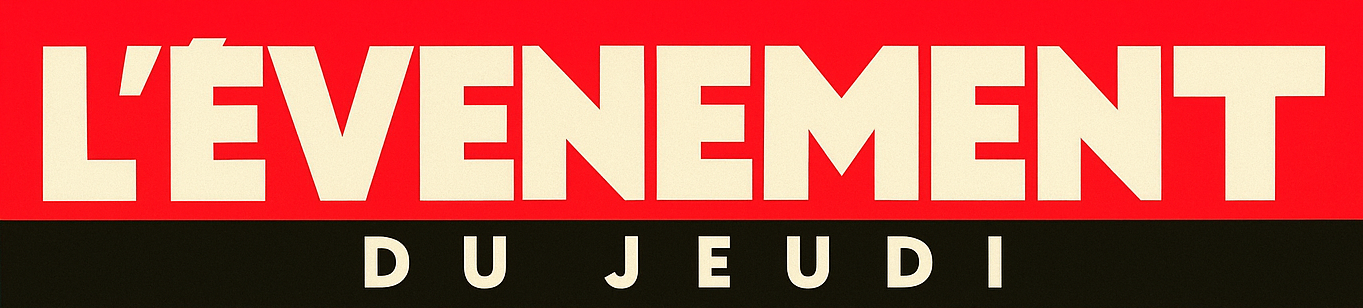
Réseaux sociaux officiels