Les Aventures de la liberté racontées par Bernard-Henri Lévy ont un goût de dérision. Un siècle, ou presque, de dogmatisme péremptoire avorte dans le désabusement. Les vérités successives de l’intelligentsia se sont évaporées sans retour. L’intolérance et la morgue de leurs défenseurs apparaissent après coup dans leur consternante bouffonnerie. Les maîtres à penser n’ont plus la cote, et leurs disciples sont échaudés pour longtemps.
Lévy propose un bilan historique, dans ce livre écrit parallèlement à la réalisation d’un film de télévision portant le même titre. Le « big bang » remonte à l’affaire Dreyfus, première ligne de partage entre conservateurs et contestataires, parmi lesquels Zola et Péguy.
À Verdun, un nouveau type de pensée naît sous le déluge de feu. Des jeunes commencent à découvrir comment l’ensemble de leurs aînés les a menés à l’abattoir. Henri Barbusse, Romain Rolland plaisent la cause pacifiste. Dans le même temps, les charniers accouchent du surréalisme, qui exige qu’on en finisse avec l’ancien régime de l’esprit.
La force des barbares
S’allume alors la grande lueur venue de l’Est. Les intellectuels flambent pour la Révolution, « épopée vivante, poème de l’héroïsme et de la fraternité ». L’austérité de la nouvelle Russie, son goût de l’ascétisme et de la pureté les fascinent. Les clercs adhèrent en masse au communisme stalinien. Barbusse prophétise que Lénine, mais aussi Staline, apparaîtront un jour comme les « messies d’une humanité recommencée ».
Rolland confesse son admiration pour la force des barbares, sacrifiant à ce culte de la vigueur, de la « puissance conquérante et vitale » qu’était aussi le socialisme. Aragon, sorte de pénitent rouge, vient se mettre à son tour à l’école de la jeunesse et de la vie.
On reconnaît chez tous ces prosélytes un ton de convertis : leur engagement est évidemment plus religieux que politique. Mensonges d’État, crimes, massacres demeurent occultés. Les procès truqués n’entament pas davantage la foi des militants.
Le stade de Nuremberg
Aberration similaire, le fascisme commence par être, lui aussi, révolutionnaire. Il séduit une autre clientèle, écœurée par la France de l’apéro et du petit commerce. Au stade de Nuremberg, Brasillach découvre la « communion mystique » des nazis, et Drieu La Rochelle avoue qu’il n’a rien vu de plus beau depuis l’Acropole. Auparavant, on lui avait fait les honneurs de Dachau.
Engouement qui suscitera une réaction non moins affirmée. La frontière idéologique se précise pendant la guerre d’Espagne, assez « claire » pour abolir toute ambiguïté. Mauriac, Bernanos, Malraux, Hemingway appuient sans équivoque la cause républicaine. La Deuxième Guerre mondiale et son dénouement, s’ils ont vaincu le nazisme, n’empêchent pas les camps staliniens de continuer leur besogne exterminatrice.
Dès les années 30, des témoins expriment leurs doutes. Nizan, parce qu’il a prétendu, à propos de l’URSS, cesser de mentir, est aussitôt désigné comme un « indicateur de police peureux et servile ».
Fête cubaine
Gide, l’un des premiers, dénonce l’illusion dans Retour d’URSS. La haine du clan le poursuit encore aujourd’hui. À l’époque, l’arrogant Aragon règne en despote sur les comités d’écrivains issus de la Résistance. Sartre continue cependant de fermer les yeux sur l’abomination totalitaire. En face, Malraux et Aron prennent nettement position contre l’impérialisme soviétique.
Pendant que l’intelligentsia conspue Camus (qui choisirait sa mère, s’il y avait lieu, contre la justice), le doute grandit de toutes parts. Le marxisme commence à se dissoudre dans les insurrections de l’Est. Avec la guerre d’Algérie revient le temps des « libelles, des manifestes et de la vérité en marche ». Le schisme s’accuse non seulement avec le Parti communiste, mais avec le modèle soviétique en général.
Dès les années 60, le tiers-mondisme s’empare des faiseurs d’opinion. Déjà, en 1925, les surréalistes compissaient la France, Genet vomissait sur l’Occident. On pense dès lors que la libération des États afro-asiatiques coïncidera avec l’anéantissement de l’infâme Europe. Au nom de leur volonté de pureté, « nos intellectuels vont s’égarer une nouvelle fois et aliéner leur liberté dans une aventure ultime ».
La fête cubaine enivre Sartre, qui séjourne à La Havane en février 1960. Il publie une série d’articles pour glorifier la force vitale de la jeunesse. En août 1968, on déchante quand Fidel approuve l’entrée des chars russes à Prague.
La nouvelle Mecque
Apparition, pendant et après la guerre du Vietnam, de l’intellectuel maoïste, qui tombe dans le même panneau que ses aînés. La Chine des gardes rouges devient sa nouvelle Mecque. Elle aura du moins eu raison de ses dernières attaches staliniennes. Le maoïsme prétend casser l’histoire en deux. Le désir de sainteté qu’il admet le rapproche curieusement du terrorisme : « Les appels à la libération des hommes se renversent en leur contraire ».
Sartre, après le massacre des athlètes israéliens à Munich, publie un impardonnable article qui donne ses lettres de noblesse à la violence sauvage. À propos du Cambodge, de l’Iran, certains vont cautionner la barbarie : « L’espérance en une révolution pure a aveuglé leur jugement ». Foucault lui-même ne cachera pas d’autre part son admiration pour Khomeiny et fera le voyage de Téhéran ! « Et si le rêve révolutionnaire était en soi un rêve barbare ? ».
Après tant d’avanies, restent les Droits de l’Homme, la morale (mais fondée sur quoi ?), l’idée démocratique : autant dire pas grand-chose. Telle aura été la « mystérieuse hécatombe des clercs », sans vraie relève, au cours d’un siècle pourtant fécond en invectives, palabres et décrets.
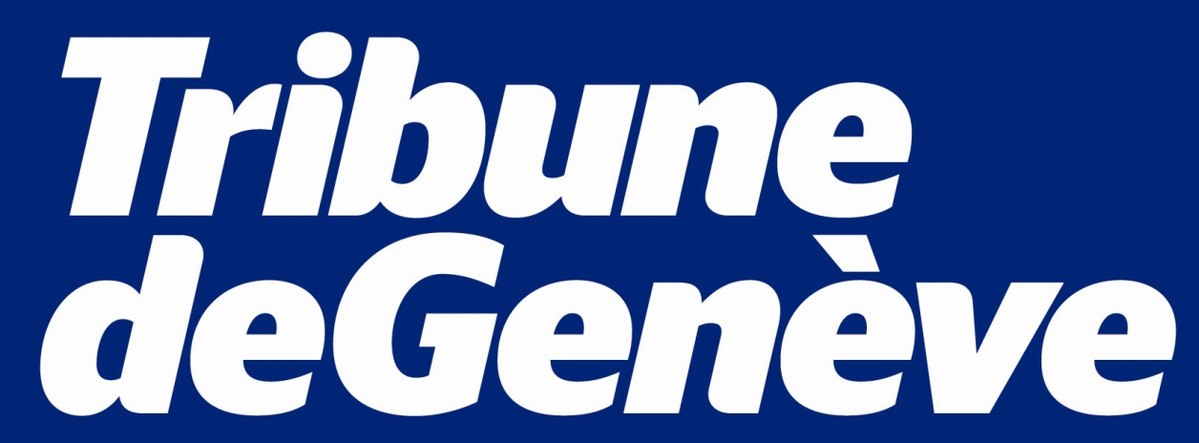
Réseaux sociaux officiels