De toute l’histoire de la sélection officielle du Festival de Cannes, il est le seul film à avoir été ajouté en dernière minute, comme s’il y avait urgence, comme si ce documentaire, parce qu’il est une archéologie du présent, devait être montré. Aujourd’hui et pas demain. Dans Peshmerga, Bernard-Henri Lévy nous révèle ce qui est soustrait à nos regards pourtant inondés d’images : la guerre au sol que les combattants kurdes mènent face à Daech le long de la frontière irakienne.
Vous venez présenter en Israël ce film qui est plus qu’un film, presque un tombeau, au sens poétique, à la gloire des soldats kurdes qui mènent contre le Califat islamique la seule guerre au sol. Le montrer ici, cela représente quoi ? Un acte d’affection, comme un privilège qu’on réserve à un ami cher, ou un acte politique ?
Les deux. Un acte d’amitié d’abord. J’ai l’habitude depuis très longtemps de venir présenter mes livres et mes films en Israël. Je suis très fier et très ému de montrer Peshmerga ici, avant New York, avant Londres, avant Berlin. Mais c’est un acte politique aussi. Car il y a quelque chose de Tsahal dans cette armée kurde, et je pense qu’il y a une proximité entre ces deux histoires, l’histoire des Kurdes et l’histoire juive, il y a une proximité entre la culture militaire israélienne et la culture militaire du Kurdistan irakien. Cette affinité, je la fais apparaître dans le film, et je ne suis pas sûr que les Israéliens en soient toujours aussi conscients qu’ils le devraient.
Vous voulez dire que vous aimeriez encourager une prise de conscience israélienne sur l’aide à apporter aux Kurdes ?
Les aider, je ne sais pas, en tout cas, ce qui me semble certain, c’est que dans un Proche-Orient idéal, il y aurait Israël et il y aurait un Kurdistan indépendant, qui seraient des pôles de stabilité, des pôles de démocratie.
Vous avez traversé ces mille kilomètres de frontières, caméra au poing et drones dans les airs, vous avez filmé le temps long de la guerre, ses accélérations aussi, la mort, son côté très géographique. Pourquoi avoir tant travaillé sur la notion de territoire alors qu’on a l’impression, nous, que la guerre est généralisée, que le terrorisme est un cercle dont la circonférence est partout et le centre nulle part, que le territoire importe peu ?
Parce que Daech le voit ainsi. Daech pense en termes de territoire. En termes de Califat. Et ça me paraît très important de reprendre ce territoire à ce prétendu Califat. Et puis, on a beau dire, la guerre n’est jamais dématérialisée. Et ce ne sont pas les robots tueurs ou les drones qui y changeront quelque chose. Ils ne réduiront pas cette dimension physique et archaïque de la guerre. J’ai voulu montrer cela dans tous mes films et dans celui-là en particulier. On y voit des hommes et des femmes se battre pour cent mètres de territoire. Ces cent mètres paraissent peut-être dérisoires mais ils charrient néanmoins, chaque fois, une part de l’essentiel. Je voulais aussi montrer que toutes les guerres sont hideuses. Je ne crois pas à la moralité de la guerre. Je crois qu’il existe des guerres justes. Elles peuvent être justes et hideuses. Elles peuvent être justes et abaisser l’homme. Quiconque a vu la guerre de près ne peut pas penser autrement. Il y a ce mot d’Apollinaire « Dieu que la guerre est jolie ! » Moi je le renverse : « Dieu que la guerre est laide. » Mais, malgré cette laideur, je dis, comme le martelait Elie Wiesel, que la neutralité n’est pas une option, qu’elle est trop souvent le masque de la lâcheté. Il y a des circonstances, des moments, où la guerre est inévitable.
Apollinaire a écrit dans une correspondance : « C’est épatant d’être militaire, et je crois que c’est le vrai métier pour un poète. » Est-ce le vrai métier pour un philosophe ?
Non. Je le fais, je l’ai fait souvent, mais je n’aime pas cela. En même temps, si on prend la politique au sérieux, c’est-à-dire l’affrontement contre le pire, l’affrontement du moindre mal contre le pire, on ne peut pas en faire l’économie. Quand une guerre vous est déclarée, il faut la livrer. Et il faut en témoigner. C’est ce que j’ai fait dans ce film. Je l’ai fait car personne ne l’avait fait. Toutes les images de Peshmerga sont inédites.
Comment on évite l’esthétisation, la fascination, la romantisation ? Comment faire un film qui ne soit pas un parti pris kitsch ?
Ce film, c’est du cinéma parce que c’est du mouvement. Mais ce n’est pas de l’art, parce que ce n’est pas de l’esthétique. Ce film ne tombe jamais – et j’y tiens – dans les pièges de l’esthétisation. En revanche, il montre le rythme de la guerre. Le rythme des corps et des esprits pris dans ce tourbillon horrible. Mais sans complaisance, sans esthétisation.
On vous a beaucoup reproché d’absolutiser le Bien que représenteraient les peshmergas kurdes face au mal absolu que serait Daech. Assumez-vous de définir le bon et le mauvais côté ?
Bien sûr que je refuse tout manichéisme naïf. Je n’ai jamais magnifié les peshmergas. En revanche, que Daech incarne le pire, ça oui, j’en suis convaincu. Mais les peshmergas n’incarnent pas le bien pour autant, plutôt la résistance au pire, ce qui n’est pas la même chose. Je montre les Kurdes dans leur fragilité, dans leurs hésitations, dans cet entre-deux entre les instants de grandeur et l’ordinaire de la survie qui est le propre des peuples en guerre. Ce n’est pas un peuple d’anges, mais il est capable d’héroïsme.
Je me permets une question sur la situation actuelle, sur les attentats terribles qui touchent les Israéliens, sur l’absence de réaction de la communauté internationale, sur l’horizon de la paix qui semble s’éloigner encore. Quels sont vos espoirs, vos propositions ?
La seule issue à cette tragédie dont les Israéliens sont les premières victimes, est une initiative de paix de type nouveau, que j’appelle « la paix sèche ». Pas une interminable négociation. Pas la recherche d’un interlocuteur introuvable. Pas l’attente d’un partenaire qui se dérobe toujours. Pas non plus une paix unilatérale comme avait pu l’être le retrait de la bande de Gaza. Non, ce que j’appelle la « paix sèche » supposerait l’assentiment des pays de la région, un règlement global. Je propose une paix sans pathos. Ce n’est pas la peine d’aimer pour faire la paix. Il faut désenchanter, dépassionner cette affaire. Moi, sioniste, ami inconditionnel d’Israël, je m’y essaie. Le seul affect que je garde en moi, c’est l’amour du peuple juif, là-dessus je suis intransigeant.
Vous choisiriez donc l’amour du peuple plutôt que l’amour de la terre ?
Bien sûr. Je suis du parti de Gershom Scholem qui reprochait à Hannah Arendt son défaut d’amour du peuple juif. Je suis de l’école de Franz Rosenzweig, des maîtres modernes et anciens du judaïsme. Les hommes sont plus importants que la terre. Comme pour les prophètes. Comme pour Moïse comparant son peuple à du sable. Les hommes, dans leur singularité de peuple-sable, sont plus importants que la terre dans sa compacité substantielle.
Nous vivons actuellement en politique intérieure israélienne, une situation assez inédite puisque des voix de généraux de Tsahal se lèvent pour dénoncer, qui une ambiance délétère voire fascisante, qui le populisme du gouvernement. Qu’en pensez-vous ?
« Fascisant », je ne suis certainement pas d’accord. Mais, à cette réserve près, j’ai tendance à dire que s’il y a un grand pays démocratique au monde où on devrait écouter les généraux, c’est Israël. Pas toujours. Mais souvent. Pour moi qui pense que l’armée israélienne n’a pas renoncé à l’idéal de la pureté des armes, les généraux israéliens sont dépositaires d’une part de la conscience du pays.
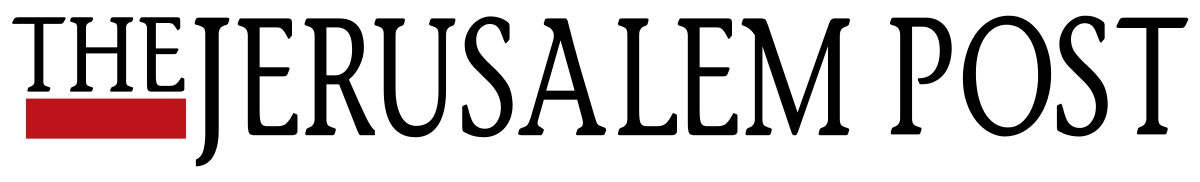
Réseaux sociaux officiels