14 novembre
Pardon à ceux que Coluche arrive encore à faire rire. Et pardon à ceux qui, surtout, seraient tentés de voir dans ce rire je ne sais quel argument valant excuse ou indulgence. Mais la manière dont il s’est conduit vis-à-vis de Christine Clerc, hier, dans les studios d’Europe 1, m’a semblé, moi, inexcusable. Et quitte à paraître un peu solennel, je tiens à dire ici, qu’un homme capable de traiter ainsi une journaliste, de la molester, de l’insulter est, qu’on le veuille ou non, un lâche doublé d’un salaud. Le fait que la journaliste en question soit au Figaro Magazine ne justifie, bien entendu, rien. Et qu’elle soit femme, en revanche, ne fait qu’ajouter à l’affaire ce zeste de haine sexuelle qui lui donne tout son parfum. Chacun sait cela, je crois. Chacun sent bien que Coluche vient d’accomplir là un geste qui, s’ajoutant à tout ce qu’il débite, à longueur d’antenne et de journée, sur le compte des Juifs, des Arabes, des handicapés, et j’en passe, ne le grandira pas. La question, la seule question qui, dans ce cas, continue de se poser, c’est : comment ne sont-ils pas plus nombreux, les commentateurs qui, dans la presse, acceptent ce matin de prendre la mesure de la saloperie ?
18 novembre
Arrivée hier soir à Stockholm avec — outre Marek Halter — toute la délégation de S.O.S. Racisme venue recevoir en grande pompe le « Prix de la Liberté ». Cérémonies donc… Discours et colloques en tous genres… Polémiques amicales avec un Breyten Breytenbach qui, comme ses amis sud-africains, ne démord pas de l’idée que le racisme est le produit d’un « certain type de société »… Et puis Stockholm surtout, oui la troublante, l’embarrassante Stockholm avec ses grandes avenues vides, ses étranges toits vert-de-gris, sa lumière pauvre, presque blafarde, qui commence de s’éteindre dès les premières heures de l’après-midi. Ville sans couleurs… Ville sans saveurs… Ville sans odeurs ni humeurs… La seule ville que je connaisse où l’on puisse marcher des heures, des nuits et des jours entiers, sans jamais rencontrer de : ces zones d’ombre et de mystère qui font le charme des autres villes… Souvenir de ce beau texte de Gracq disant, de Stockholm justement — à moins, je ne sais plus, que ce ne soit d’Oslo ou de Copenhague — que c’est la seule ville de la planète qui n’ait, à la lettre, pas de bas-fonds.
20 novembre
Deux jours de théâtre donc. Deux jours de comédie. Deux jours voulus, organisés, j’allais presque dire programmés pour qu’il ne s’y passe strictement rien. Et toute une mise en scène, toute une orchestration destinées à mettre en spectacle cette grande illusion genevoise. N’est-il pas important, dira-t-on, que le Sommet lui-même ait eu lieu ? Et ne faut-il pas se réjouir qu’à défaut de s’être entendus sur des « résultats tangibles et concrets », les deux grands aient pu se voir, se tâter, parler au moins, et dialoguer ? Eh bien, au risque de choquer, je crois précisément que non. Et à ceux qui en douteraient, j’ai envie de conseiller d’aller demander ce qu’ils en pensent aux Polonais, aux Afghans ou à ceux qui, en Russie même, crèvent sous la botte communiste.
Pour ceux-là, en effet, le message est clair. Et ce qu’on leur a très clairement dit c’est, en substance, que le monde ne va pas si mal ; qu’il tourne à peu près rond ; qu’il n’a pas de défaut majeur sur quoi les grands ne puissent transiger ; ce qu’on leur a dit c’est que toutes ces larmes, toutes ces souffrances, toutes ces détresses qui sont leur lot et qu’ils vivent comme un cauchemar font, elles aussi, tout bien pesé, partie de l’ordre, de l’équilibre, de l’harmonie de la planète ; et le résultat c’est alors, très normalement et logiquement, qu’à tous ces gueux qui voulaient des armes, qui attendaient des aides ou des paroles, on a discrètement fait injonction, sinon de se soumettre, du moins d’apprendre à se taire, à ne plus espérer ni réclamer. C’est cela, au fond, la Détente. C’est cette machine à banaliser le Mal et à éterniser le malheur. C’est la mirobolante mais diabolique méthode qui, au plus absurde, au plus insensé, au plus scandaleux des malheurs permet de donner, soudain, l’accablante figure d’un destin.
21 novembre
Pierre Bérégovoy à « L’Heure de Vérité ». Voilà un ministre des Finances en exercice qui, fort d’une série de succès à faire pâlir d’envie quelques-uns de ses prédécesseurs, reconnaît néanmoins les « erreurs commises » ; confesse qu’il n’y a pas de « recette magique » pour sortir le pays de la crise ; évoque ses « déceptions » ou ses « désillusions » sur le même ton que ses victoires ; trouve le ton juste enfin, sans grandiloquence ni complaisance, pour refuser que le thème de l’immigration devienne le « thème central » du débat politique de demain ; bref, voilà un ministre des Finances qui, loin des vantardises et des rodomontades qui sont souvent la loi du genre, nous a donné, deux heures durant, une grande leçon de mesure, de modestie, d’humilité — c’est-à-dire, au fond, de démocratie.
Pierre Mendès France, dont il se réclame, n’aurait pas désavoué la performance. Et il y avait dans le style de l’émission, dans le parler vrai du personnage, dans ce va-et-vient constant entre un empirisme résolu et une intransigeance extrême sur les principes, quelque chose qui, de fait, n’était pas sans rappeler la petite musique du mendésisme. Qui m’eût dit, il y a quinze ans, lorsque je le croisais, un mercredi sur deux, dans le comité d’experts qui entourait François Mitterrand que cet autodidacte sévère trouverait si naturellement l’accent d’un homme d’État ?
25 novembre
Lu dans la Vie de Mallarmé d’Henri Mondor, cette phrase écrite au lendemain des massacres de la Commune : « je n’admets pas que ces interruptions s’imposent à notre intime pensée ». La phrase est terrible, certes… Mais n’est-ce pas, à peu de chose près, ce que disait Joyce avec son fameux : « périsse la Pologne, pourvu que vive Finnegans Wake ? » Ce que sous-entendait Kafka avec la non moins fameuse invitation à faire, comme il disait « un bond hors du rang des meurtriers » ? Et n’est-ce pas l’inavouable pensée qui rôde dans la cervelle de tous les écrivains du monde lors même qu’ils se veulent, s’affirment, s’affichent « amis » du genre humain ? Moi-même, pourquoi le nier ? j’ai pu nourrir, parfois, des idées de cette espèce. Il a pu m’arriver de rêver d’un retrait, d’une sécession totale vis-à-vis des obligations civiles où je me sentais pris. Et cet après-midi encore, au théâtre de l’Athénée, en plein cœur de cette manifestation antifasciste que je me flattais pourtant d’avoir en partie fomentée, je ne pouvais, malgré mes efforts, m’ôter de la tête l’horrible petit murmure. Et si l’engagement des intellectuels n’était, après tout, qu’une manière de dîme qu’ils paient à la communauté pour prix de leur odieuse, monstrueuse singularité ?
26 novembre
Ainsi donc, Silvio Berlusconi est un voyou et un vautour. C’est un vampire assoiffé de sang qui ne serait venu chez nous que dans l’espoir d’assassiner notre cher cinéma national. Et nous n’aurions pas trop de tous nos artistes, de tous nos producteurs et de notre petit monde culturel et médiatique pour faire front contre l’intrus et tenter, à toute vitesse, de lui faire retraverser les Alpes. Qu’il y ait, dans tout ce remue-ménage, des accents de xénophobie ne gêne apparemment pas nos vertueux. Et je n’en vois aucun protester, notamment, contre l’ahurissant entretien, publié hier par Le Quotidien, et où Bertrand Tavernier accusait le « magnat italien » d’innonder notre marché de « techniciens étrangers » ; de mettre en péril « l’emploi et la survie de la profession » ; de « s’acharner » (sic) sur une vieille famille française, les Seydoux, dont il aurait déjà, au moment de l’aventure Gaumont Italie, « foutu en l’air » le premier fils ; sans parler de l’inexpiable crime qui consisterait selon lui, si l’on n’y mettait le holà, à introduire dans notre bonne terre gauloise le « droit anglo-saxon »… Pourquoi le droit anglo-saxon ? Mystère bien entendu ! C’est-à-dire, en réalité, délire ! Et l’on aurait presque envie, face à ce vent de panique, à cette débauche d’irrationalité et parfois, aussi, de franche bêtise, de rappeler tout simplement quelques vérités de bon sens… Celle-ci, par exemple : que le cinéma italien dont Berlusconi est censé être le « fossoyeur » a eu, hélas pour lui, bien d’autres raisons de mourir — à commencer, comme chacun sait, par les carences d’un État qui n’a eu ni la lucidité ni le courage du nôtre. Celle-ci encore : que le cinéma américain, de son côté, et contrairement aux analyses de nos oiseaux de malheur, n’a pas le moins du monde souffert de l’explosion des télévisions — Coppola, Kubrick ou Woody Allen ne sont pas encore, que l’on sache, les idiots décervelés que nous risquerions, nous, à les entendre, de devenir. Ou bien celle-ci : qu’il est aussi débile de reprocher à une télé commerciale d’être par définition « vulgaire », que d’accuser une télé publique d’être, par la force des choses, « totalitaire » — la vérité étant surtout, qu’on ne sait encore grand-chose ni de la grille ni des programmes ni du cahier des charges de la « Cinq ». Et quant à l’épineux problème, enfin, des plages de publicité qui vont nous saucissonner les chefs-d’œuvre de Tavernier, je ne saurais mieux faire, je crois, que de m’autoriser cette fois de la parole d’un vrai grand. C’est Truffant en effet qui, réfléchissant à la manière de repeupler les salles obscures, déclarait carrément, quelques mois avant sa mort, dans une interview à Paris-Match : « En France, on a commencé à tuer le cinéma le jour où l’on a décidé que les films diffusés par la télévision ne seraient jamais interrompus par des spots publicitaires ».
27 novembre
Déjeuner, à huit jours de distance, avec un « cacique » socialiste et un « présidentiable » de l’opposition qui me parlent tous les deux, dans des termes presque identiques, de l’« inquiétude » que leur inspire « l’inexorable déclin du P.C.F. ». Explication courte — et qui vient aussitôt à l’esprit : l’un regrette l’Union de la gauche et l’autre le bon temps où c’étaient les communistes qui assuraient, chaque année ou presque, les victoires électorales de la droite. Explication plus complexe — mais que je crois plus féconde : ils savent l’un comme l’autre que le P.C. est la pierre d’angle du système politique français ; que c’est autour de lui que s’ordonnent ses paysages, ses stratégies, ses débats ; que c’est par rapport à lui, et par rapport à lui seulement, que la partie, vaille que vaille, continue symboliquement d’être jouée : ils savent l’un et l’autre, si l’on préfère, que si le vieil astre déclinant venait à s’éteindre tout à fait, c’est toute la galaxie qui, d’un coup, entrerait dans la pénombre. Programme commun à la classe politique tout entière : sauver coûte que coûte un parti qui la fait persévérer dans son être. Impératif catégorique auquel j’ai bien peur qu’elle s’oblige dans les mois ou années à venir : que ce parti conserve le plus longtemps possible crédit et respectabilité. Pour quelqu’un qui, comme moi, pense qu’il n’y a rien de plus semblable à l’effet Marchais que l’effet Le Pen, l’idée n’a, bien entendu, rien de particulièrement réjouissant.
28 novembre
Mais non, L’Année du Dragon de Michael Cimino n’est pas un film « raciste ». Que les personnages chinois soient, pour la plupart, négatifs et sombres, je veux bien en effet l’admettre. Mais n’en va-t-il pas de même pour l’ensemble des personnages du film ? Y en a-t-il un seul qui nous soit présenté comme un héros positif traditionnel ? Et le capitaine de police, notamment, qu’incarne Mickey Rourke n’apparaît-il pas clairement comme un semi-maniaque, détraqué par la guerre du Viêtnam et portant sur ses épaules toutes les plus noires folies de l’Amérique reaganienne ? L’Année du Dragon est un voyage au bout de ces folies. C’est une plongée dans ces bas-fonds. C’est une enquête hallucinée, mais minutieuse, du côté de cette nuit primordiale qui pourrait bien être, à en croire Cimino et quelques autres, la vérité de l’espèce. Et quand je dis « quelques autres », je songe à tous ceux qui, avant lui ou mieux que lui, ont clamé que le grand Art ne pouvait avoir d’autre objet que cette exploration patiente, féroce parfois, du fond d’apocalypse où se déploie notre aventure. Si Cimino est « suspect » il l’est, autrement dit, et toutes proportions gardées, au même titre que Kafka, Faulkner, Joyce ou le premier Céline. Il l’est à la manière de tous ces écrivains qui n’ont jamais eu d’autre ambition que d’aborder, d’affronter, de traiter l’énigmatique question du Mal. S’il est « coupable » c’est au sens où Georges Bataille disait de la littérature qu’elle est toujours, fatalement, et par définition, coupable.
29 novembre
Je n’ai pas de goût particulier pour les oraisons funèbres. Et je ne voudrais pas prendre l’habitude de terminer chacun de ces bloc-notes par un hommage à un disparu. Mais comment ne pas dire un mot, à l’heure de remettre ces lignes à l’imprimerie, de l’immense historien qu’était Fernand Braudel ? Puisqu’il semble être de bon ton, ces jours-ci, de cracher sur la « pensée 68 » et nos « années structurales », je ne suis pas fâché de rappeler que c’est à des hommes tels que lui que je dois de savoir lire, penser, peut-être écrire.
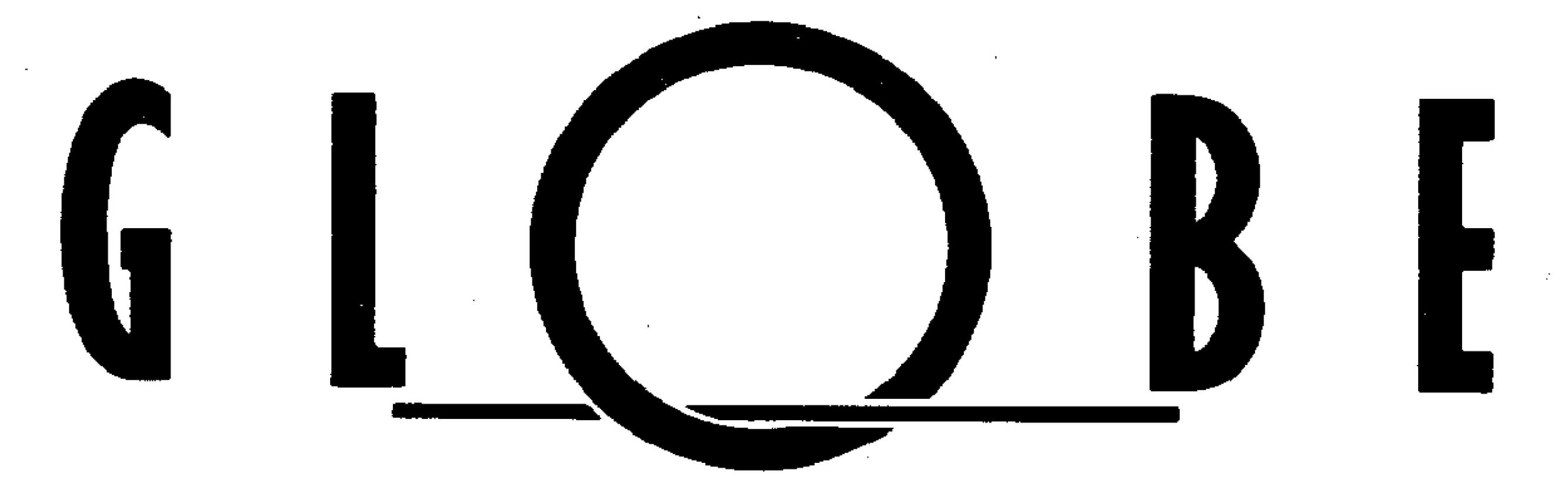
Réseaux sociaux officiels