Punir la faute des pères sur les fils jusqu’à la troisième, quatrième génération. Jamais la litanie biblique ne m’avait tant obsédé qu’au cours de ce périple allemand. Et je l’ai eue au bord des lèvres tout au long de ces cinq conférences données à Hambourg, Fribourg, Munich, Francfort et Berlin sur la littérature et Le Diable en tête. D’où vient, alors, que je n’y croie pas ? D’où vient que je n’y arrive pas ? D’où vient, pour être précis, que contrairement à un Jankélévitch qui ne cessait de répéter qu’il n’avait plus, depuis la guerre, parlé allemand, rencontré un Allemand, pensé ou philosophé en allemand, je ne parvienne pas, moi, à tenir pour coresponsable du nazisme le new-waver en pantalon de skaï et cravate-ficelle croisé sur Schillerstrasse ? C’est que le problème est plus complexe. Qu’il n’a peut-être rien à voir avec ces histoires de « générations ». Et que c’est dans la structure même d’une culture, d’une ville ou d’une société qu’il faudrait, en toute rigueur, penser à en chercher les clefs. Cas de Berlin, bien sûr. Cas de cette demi-ville, coupée en son milieu, rongée de l’intérieur. Cas de cette ville fantôme, étrangement moribonde ou survivante, que l’on dirait occupée à gérer je ne sais quelle malédiction. Berlin, ville vide. Berlin, ville ruine. Berlin et ses décombres, ses terrains vagues, ses cabarets désaffectés ou ses quartiers désertifiés. Berlin est une ville gaie en même temps. Mais il flotte sur cette gaieté elle-même un étrange parfum de mort, d’apocalypse en suspension. Relire la Bible à Berlin. Relire toutes ces histoires de « raisins verts » et de « dents gâtées ». Et les relire pour leur faire dire qu’au-delà des hommes et de leurs passions, il y a un temps du crime, une temporalité du forfait qui modèlent jusqu’à l’espace, jusqu’à la géographie des choses.
Le roman, donc, à Berlin. Son rôle. Sa place. Sa très récente naissance. Sa très possible disparition. Et pourquoi moi, philosophe, j’ai choisi, un beau matin, d’écrire à mon tour un roman. Bizarre comme cette question revient. Absurde comme, d’un bout du monde à l’autre, de Pékin à New York, de Sydney à Milan ou à Tokyo, elle m’est identiquement posée. Ici, pourtant, à Berlin, elle trouve un autre sens. Elle prend un autre poids. Et tout se passe comme si elle se dotait, soudain, d’une extrême et inhabituelle gravité. Réponse grave, alors. Réponse par Musil. Réponse par Hermann Broch. Réponse par l’infinie puissance d’une forme que j’ai toujours crue, personnellement, plus apte que la forme philosophique à traiter de la question du Mal. Si je me suis, moi, mis à mon tour à cette épreuve, c’est que j’étais, au sens strict — et certes provisoirement — las de ma voix de philosophe.
Retour à Paris où Paul Giannoli m’apprend que le gentil Geldof a décidé de nous intenter, au Journal du Dimanche et à moi-même, un procès en diffamation. Qu’ai-je dit, au juste, de si terrible ? Que Geldof est sympathique. Qu’il est parfaitement méritant. Qu’il a contribué comme personne à mobiliser la générosité en faveur du tiers monde affamé. Mais qu’un grain d’irresponsabilité, allié à une solide niaiserie morale et politique, l’a involontairement rendu complice des déportations de masse en Éthiopie. Ce que j’ai dit, je le maintiens. Je le confirme plus que jamais. Et à ceux qui en douteraient, je recommanderais une fois de plus la fort instructive lecture du livre de Glucksmann et Wolton. Tout y est. Toutes les pièces du dossier. Tous les éléments d’information. Avec, en toile de fond, le portrait comico-tragique d’un « prince de l’opinion » qui, après avoir bravé Thatcher, tenu tête à Mitterrand, fait le fier et l’insolent sur tous les écrans de télé occidentaux, n’a su que se coucher, tout à coup, devant le redoutable Mengistu.
Paris toujours, avec ce grand colloque sur l’« ordre moral », organisé par Globe et nos amis de S.O.S. Racisme. Heureuse initiative, bien sûr. Interventions de qualité. Systématisation bien venue de tous ces signes épars (code de la nationalité, par exemple, prisons privées, prisons pour drogués…) qui, pris isolément, ne veulent peut-être rien dire mais qui, mis bout à bout, articulés les uns aux autres, finissent par composer un air du temps nauséabond. Pourquoi ce malaise alors ? Pourquoi cette impression de demi-échec ? Pourquoi ce sentiment — qui ne nous a, je crois, pas quittés de la journée — qu’il y avait dans tout ça quelque chose d’absurde, de faux, presque de vain ? Le principe même du débat, sans doute. Le fait qu’il ait pu et dû avoir lieu. Le fait, si l’on préfère, que nous en soyons encore, en cette fin du XXe siècle, à penser notre présent, et peut-être notre avenir, dans les termes où le pensaient les contemporains de Mac Mahon ou de la construction du Sacré-Cœur. Oui, c’est ça : ce qui était absurde, ce qui était désespérant, c’était de se retrouver là tout à coup, à cet étiage de la réflexion, à ce degré zéro de la polémique — tous unis contre des fantômes ; tous tonnant contre des spectres ; et tous renouant avec des arguments que nous pensions n’avoir jamais plus à ressortir de nos anciens arsenaux. Échec donc. Régression.
Ainsi de cette affaire de « Révolution française » dont les médias sont pleins. Ce qui me choque, là, ce n’est pas le débat lui-même. Et ce n’est certainement pas, en tout cas — comme le répètent, de- ci de-là, les sots — de voir les Français continuer, presque deux siècles après, de se disputer avec vigueur autour de leur Histoire. Non, ce qui me choque c’est le tour que prennent les choses. C’est le niveau de la discussion. Et c’est la fantastique régression, là aussi, à laquelle nous assistons. Quoi ? Nous n’aurions le choix, vraiment, qu’entre terroristes et muscadins ? « Révolutionnaires » et « contre-révolutionnaires » ? Nous n’aurions le choix qu’entre la sacralisation sans nuance et la diabolisation sans réserve ! Si tel était le cas — et même si, à tout prendre, je préfère Gallo à Chaunu — ce serait une entière génération d’historiens qui se trouverait invalidée ; ce serait tout l’effort entrepris autour, notamment, de l’École des Annales, qui se trouverait réduit à rien ; si tel était le cas, et si nous devions nous retrouver dans l’obligation de choisir entre Allard et Gaxotte, Soboul et Bainville, c’est l’intelligence qui aurait perdu, c’est la bêtise politique qui triompherait. Relire d’urgence François Furet. Relire son double refus de la double simplification. Relire, dans La Machine à Terreur de Dispot, les principes d’une « critique » de la Révolution, capable d’opérer les tris, les démarcations indispensables. Et capable, du coup, de rendre enfin à l’Histoire réelle sa nécessaire complexité.
Ainsi des prisons privées. Je suis contre, bien entendu. Et je pense, moi aussi, que le droit de punir fait intégralement partie de ce « bloc de souveraineté » que l’on ne saurait, sans risque grave, retirer à la compétence d’un État. Ce qui me choque le plus, cependant, c’est là aussi le ton du débat. Son lamentable niveau. C’est que nous en soyons aujourd’hui, fin 1986, à arbitrer encore une discussion aussi débile. Ce qui me choque, ce qui m’épouvante, c’est de voir à quelle vitesse peuvent être balayées des décennies et des décennies de réflexion sur le principe même de la prison, sa place dans la société, les disciplines qu’elle fomente, les discours auxquels elle s’adosse. Il y a dix ans, l’intelligentsia française discutait le Surveiller et punir de Foucault. Les mêmes, aujourd’hui, en train de disputer des vertus comparées de Bouygues et des syndicats de matons pour la juste détermination d’un prix de journée pénitentiaire.
Lu, pour un article dans un journal japonais, le Michel Foucault tel que je l’imagine de Maurice Blanchot. Cette page notamment, très belle, où l’auteur de Thomas l’obscur évoque la singulière répugnance qu’avait Foucault pour la « notion de profondeur ». Superficialité ? Frivolité ? Cynisme, peut-être, ou scepticisme ? Non, bien sûr. Mais le goût d’un discours de surface, sans arrière-monde ni mirages, sans transcendance ni trompe-l’œil — « non pas étranger, comme on l’a cru, à la recherche de la vérité, mais laissant voir après bien d’autres les périls de cette recherche ainsi que ses relations ambiguës avec les divers dispositifs du pouvoir ». Ne pas oublier — et ce n’est pas sans rapports avec ce que je disais l’autre semaine en Allemagne — qu’il est le seul philosophe à avoir obstinément tenu à ce que ses livres fussent aussi des « fictions » ; ne jamais oublier la singulière insistance de ce maître-archéologue à présenter ses traités comme des contes sans moralité. Michel Foucault, fabuliste. Les risques et périls de la « volonté de vérité » c’est aussi le thème d’Hamlet tel que l’a ressuscité Mesguich en son théâtre Gérard-Philipe. Folie de la vérité. Horreur de la vérité. Paralysie, inévitable, de celui qui, seul à savoir une vérité (la vérité, en l’occurrence, du fratricide commis à la tête du royaume de Danemark), prétend consacrer sa vie au soin de la manifester. Malheur, du coup. Promesse de catastrophe.
Renonciation au salut. Et amer constat, à l’inverse, que seuls ont droit à la vie, au bonheur, à la force, ceux qui prennent leur parti du mensonge, du simulacre. Hamlet n’est pas une pièce lyrique. Ce n’est pas une pièce romantique. C’est une pièce grinçante au contraire, parfois drôle, toujours cruelle. Et c’est le mérite de Mesguich, me semble-t-il, que d’avoir su enjamber deux siècles de commentaires goethéens ou coleridgiens pour lui restituer sa tonalité originaire. Lire Shakespeare à la lumière du Talmud évoquant les effets foudroyants du « crime de vérité ». Le lire au voisinage d’Hölderlin imputant à Empédocle le crime d’avoir apporté aux hommes la vérité. Éloge de l’illusion.
Nuls. Nous sommes décidément nuls. Et qu’il n’y ait eu qu’une vague exposition, une ou deux humbles célébrations, pour commémorer le centenaire de la naissance de Robert Mallet-Stevens est un des vrais scandales du mois. Voilà un homme qui a révolutionné l’architecture. Voilà quelqu’un qui, avant Le Corbusier, a réussi à tordre le cou aux mièvreries « art déco » du « Modern Style ». Voilà un géant, un génie, qui invente avant tout le monde l’usage intensif du béton, les grands volumes géométriques, les vastes panneaux de verre à la place de la fenêtre traditionnelle, ou la subtile articulation des formes orthogonales ou cylindriques sans quoi la modernité ne serait sûrement pas ce qu’elle est. Et pas un vrai hommage dans la presse, pas un vrai film à la télé, pas le dixième de ce que l’on fait d’habitude, quand il s’agit de littérature, d’idéologie ou de politique, pour la plus modeste commémoration. Jacques Martinez n’a pas tort lorsqu’il déplore que l’architecture n’ait pas la place qu’elle mérite dans le paysage culturel contemporain. Trouver le temps, très vite, d’aller revoir la caserne des pompiers de la rue Mesnil, le château Mézy de Paul Poiret ou même, pourquoi pas, le toujours sublime casino de Saint-Jean-de-Luz.
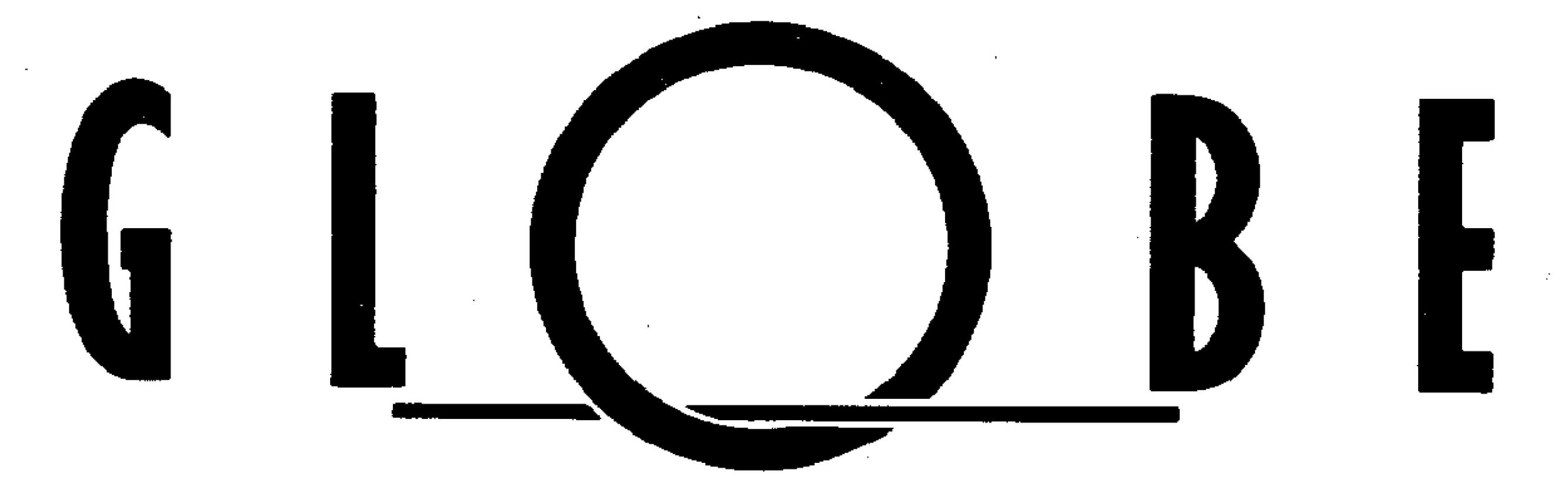
Réseaux sociaux officiels