Imaginons un instant que Raymond Barre l’ait emporté. Oui, imaginons une seule seconde qu’il ait obtenu de Chirac et de Giscard la « déclaration solennelle » qu’il souhaitait et aux termes de laquelle les trois leaders auraient promis « qu’en aucun cas le président de la République ne pourrait compter sur le concours d’aucun d’entre eux ». En clair, cela voulait dire que trois responsables éminents de la classe politique française se seraient publiquement engagés : primo à refuser de former le gouvernement dont une majorité éventuelle leur aurait confié le mandat ; secundo à saborder, sans quartiers ni réserves, celui que, fort de leur défaillance, le président de la République aurait bien été forcé de constituer ; tertio, et par conséquent, à faire servir tout leur crédit, toute leur puissance, tous les votes et tous les vœux cristallisés autour de leur image non pas à renforcer mais à empêcher de fonctionner les institutions de leur pays. Les amis du député de Lyon auront beau dire : dans l’histoire de ce pays, le raisonnement est à peu près sans précédent ; et c’est la première fois, à ma connaissance, qu’un leader de cette importance prend si calmement, si froidement, si ouvertement le risque de saboter le principe de démocratie.
Car c’est bien d’une question de principe qu’il s’agit dans cette affaire. Que tel ou tel responsable se méfie de la cohabitation c’est son droit le plus strict, après tout. Et je comprends fort bien que l’on préfère, dans l’idéal, un choix électoral clair, débouchant sur une majorité et un gouvernement tout aussi clairs. Reste que le corps électoral n’est pas là, malheureusement, pour flatter les préférences des politiques ; qu’il lui arrive de faire des choix qui, même s’ils apparaissent obscurs, confus, voire équivoques, n’en n’ont pas moins leur sens, leur logique, leur cohérence ; et lorsque cela arrive, lorsque de tels choix se formulent, lorsqu’un pays décide par exemple de désigner coup sur coup, à quelques années de distance, un président de la République de gauche et une Assemblée nationale de droite, le rôle d’un démocrate n’est pas de gronder, de bouder, de s’indigner ou de vitupérer (pourquoi pas, tant qu’on y est, et pour parler comme Brecht, ne pas dissoudre carrément un peuple si insolent ?) mais de décoder le message, de reconstituer sa cohérence — et puis de le traiter ensuite, vaille que vaille, modestement. La démocratie, en d’autres termes, n’est pas le règne du pur, mais de l’impur. Elle a pour élément non pas le simple mais le mixte. Non pas le transparent ou l’homogène, mais le composé, le contradictoire, le compromis, l’hétérogène. Et si elle a une vertu, si elle mérite d’être honorée, si les sociétés contemporaines continuent d’en avoir si évidemment besoin, ce n’est pas pour gérer, bien sûr, les unanimités radieuses dont elles se dotent trois fois par siècle — mais pour aménager ces majorités confuses, terriblement fragiles et précaires qui sont, nous le savons, leur lot le plus constant. C’est cela que Raymond Barre n’a pas compris. Et s’il y a un reproche à lui faire c’est de n’avoir pas assez réfléchi, en fin de compte, à la nature fondamentalement « cohabitationniste » de l’idée démocratique en tant que telle.
Mon problème à moi, dans tout ça — et le problème, me semble-t-il, de la plupart des écrivains — c’est de répondre ou non à la formidable pression qui, à chaque échéance électorale, nous invite à prendre parti. Car un intellectuel a-t-il, justement, à prendre parti ? Doit-il rallier ces solutions toutes faites que lui proposent les appareils ? S’il sert à quelque chose lui aussi, s’il a un mérite ou une vertu, n’est-ce pas à la condition de rester irréductiblement fidèle à une parole capable d’excéder, de transgresser les clivages institués ? Et n’ai-je pas cent fois dit, moi-même, que la pire des choses qui pourrait lui arriver serait de renoncer à défendre son parti, ses couleurs, ses nuances pour se lier, pieds et poings, à la logique d’un collectif ! J’ai dit cela, en effet. Je suis prêt à le redire. Sauf qu’aujourd’hui — et politiquement parlant — je suis tout aussi persuadé que le moins mauvais des gouvernements restera, dans les temps à venir, le gouvernement formé, voulu, animé par François Mitterrand. Puisse le peuple français, au soir du 16 mars prochain, lui en donner alors le loisir et les moyens !
En même temps, les écrivains parlent trop… Beaucoup trop… Et je pense, en disant ça, à ce type de parole que la modernité a inventé et qu’elle appelle une « interview ». Car qu’est-ce, au juste, qu’une interview ? C’est une parole « libre », dit-on. C’est une parole « improvisée ». C’est une parole dont tout le jeu tient à son caractère brut, familier, non élaboré. Et chacun s’accorde à dire que les « meilleures » interviews sont celles où l’on perçoit encore l’écho de ces ratés, de ces lapsus, de ces balbutiements obscurs et supposés originaires où les imbéciles croient voir la vérité d’une pensée. Alors, de deux choses l’une. Ou bien on reconnaît cette parole pour ce qu’elle est : une ébauche, une esquisse, une vague parole au rabais qui, dans le corpus d’une œuvre, ne saurait, sans malentendu, prétendre au statut de la vraie parole — et, dans ce cas, tout va très bien. Ou bien (et c’est de plus en plus souvent la règle) on la traite comme une parole pleine, égale à l’autre en dignité et susceptible de lui être rapportée, comparée, voire opposée : et les écrivains prennent alors ce risque, sans précédent dans leur histoire, de voir toute une partie de leur œuvre énoncée à la diable, dans une forme grossière et illettrée qu’ils ne toléreraient pas, c’est évident, dans le plus humble de leurs livres ; ils prennent le risque, surtout, de la voir stockée, cette mauvaise œuvre, au même titre que la bonne, dans une Archive qui, jusqu’à la fin des temps, ne fera plus la différence. Ça n’a l’air de rien, sans doute. Et il y a des dangers qui, j’en conviens, sont autrement plus menaçants. N’empêche que cette tendance, si elle devait se confirmer, aurait sur la littérature, sur l’appréhension que l’on en a, sur sa définition même, des conséquences vertigineuses. Imagine-t-on Montaigne ou Chateaubriand jeter aux quatre vents, dans les feuilles les plus obscures ou les plus improbables conversations, des pages et des pages de texte qu’ils n’auraient ni relues ni contrôlées, mais dont le volume côtoierait — puis, très vite, écraserait — celui des Essais ou des Mémoires ? Personnellement, à ma mesure modeste, j’ai depuis longtemps résolu le problème en ne donnant jamais d’interview, donc, que je ne sois assuré, non seulement de « relire » et de « contrôler » mais, à la lettre, de réécrire.
J’ai longtemps cru que les grands romans étaient ceux dont les héros continuent de vous hanter après qu’on a fermé le livre. J’ai cru, à cause de Malraux ensuite, que c’étaient ceux dont les figures, les mythes et les légendes devenaient comme une nouvelle échelle où mesurer le sens, la valeur de notre vie. Plus tard encore, lorsque j’ai découvert Broch et Musil, j’ai pensé — et écrit — que les plus grands d’entre les grands étaient ceux qui, pardessus le marché, nourrissaient l’ambition, quasi métaphysique, de « rivaliser avec l’univers ». Or voilà qu’aujourd’hui, exposant à un public d’étudiants étrangers mon « paysage littéraire personnel », je m’aperçois que j’ai irrésistiblement tendance à privilégier, tout à coup, des critères purement formels — comme si je ne savais plus juger les écrivains qu’en fonction de leur plus ou moins grand talent à contrôler, maîtriser, bref composer leur prose. Flaubert par exemple, et non Stendhal… Roussel, et non Breton… Joyce ou Faulkner plutôt, finalement, que Dos Passos… Et chaque fois, à chacune des alternatives qu’on jouait à me soumettre, non pas le plus « épique » ou le plus « métaphysique » mais le plus habile, simplement, à réduire dans son phrasé cette part de flottement, de tremblement léger, de laisser-aller ou d’insouciance qui fait, de l’avis général, tout l’infini charme du genre — mais où je n’arrive plus à distinguer, moi, que la marque de sa trivialité. Une littérature sans charme, alors ? Sans grâce ni faveur ? Non, bien sûr. Mais une littérature qui, à la grâce ou au charme, préfère ce que Baudelaire, dans un texte sur Flaubert, choisissait d’appeler une esthétique du « sang-froid ».
Prenez quelqu’un comme Nourissier. Nous ne sommes, lui et moi, pas de la même famille. Et nous n’en finirions pas d’énumérer tout ce qui peut distinguer nos sensibilités, nos goûts, nos histoires. Si je le lis pourtant, c’est à cause de cette écriture nette, sèche et presque laconique qui semble ne rien devoir au désordre de l’émotion. C’est à cause de cette « froideur ostensible » qu’il dit avoir apprise chez Radiguet et qui casse la tentation de l’emphase, de l’effusion ou du lyrisme qui poisse si souvent le roman français contemporain. Si je le lis, autrement dit — et si j’aime, outre sa Fête des pères, la très belle préface qu’il a donnée à L’eau grise, son tout premier texte publié — c’est qu’il y a très très peu de romanciers qui illustrent avec autant d’éclat ce rêve d’une littérature sans contingence, effaçant, tant que faire se peut, tout ce qui, dans sa musique, pourrait ressembler à un tremblé, une bavure, une incertitude ou un remords. François Nourissier, en ce sens, n’est pas un romancier « français ». Ce n’est pas, même s’il le croit, le simple héritier de Chardonne ou Montherlant. Ce n’est surtout pas ce spécialiste de l’intériorité et de l’aimable roman bourgeois que l’on nous présente de-ci de-là. Si j’avais, d’un mot, à le définir, je crois que je dirais : le romancier le moins enthousiaste que l’on puisse lire en ce moment — à condition d’entendre par « enthousiasme », cet indécent « élan » qui faisait dire à Valéry qu’il convenait de tenir le roman « en grand mépris »…
Enthousiasme contre sang-froid : ce sont deux éthiques qui s’affrontent là, autant que deux esthétiques ; et c’est tout l’honneur du roman qui, peut- être, se joue dans leur débat.
Un mot encore — puisque je me sens, ce mois- ci, d’humeur plutôt « littéraire » — sur le singulier hommage rendu un peu partout à la figure d’Ernst von Salomon. Que Roger Stéphane reprenne, plutôt finement, les thèmes de son Portrait de l’Aventurier, n’a bien entendu rien de choquant. Mais qu’un journal comme Libération (4 février) lui emboîte si naïvement le pas et, sans l’ombre d’une nuance ni d’une distance critique, nous chante sur une pleine page le dithyrambe d’un écrivain nazi, voilà qui, en revanche, mérite qu’on s’interroge. Car enfin peut- on, pour qualifier un intellectuel qui fit ses premières armes politiques aux côtés de Martin Bormann et du docteur Goebbels, se contenter de parler d’un « nationaliste courageux, insolent et romantique » ? Peut-on, à propos de son appartenance à la nébuleuse de mouvements para-nazis qui peuplaient les années vingt, se contenter de dire qu’il fut « de toutes les épopées de l’Allemagne vaincue » ? Du jeune intellectuel antisémite qui s’apprête à être mêlé au meurtre de Rathenau, a-t-on le droit d’écrire, sans rire, qu’il « lance — je cite — son panache, sa vitalité et son insolence dans ce que Benoist-Méchin a appelé l’ère des coups d’Etat » ? Et ne frise-t-on pas l’intolérable enfin quand, évoquant le séjour « dans les prisons allemandes » d’un homme qui s’amusait, pour passer le temps, à marquer d’une croix gammée, sur le mur de sa cellule, la date du putsch d’Hitler — ne frise- t-on pas l’intolérable, dis-je, quand, emporté par son lyrisme, l’auteur de l’article nous raconte (je cite toujours) comment son héros entreprend « à l’abri des vilenies du monde, dans la nuit de son cachot, la rédaction de son premier livre, funèbre, exalté et glorieux » ? Cette page de Libération n’a, en soi, pas d’importance ; et je la mets bien volontiers au compte de ces dérapages incontrôlés dont il n’y a pas de journal, fût-il insoupçonnable, qui ne soit parfois victime. Si je m’y attarde, pourtant, c’est qu’elle me semble exemplaire d’un état d’esprit de plus en plus étrange où, sous couvert de « dandysme », d’« esthétisme », on craint de moins en moins de nous refiler l’infâme vieille camelote. A propos : avez-vous lu La Ville ? avez-vous lu Les Réprouvés ? et êtes-vous si sûrs que ça, vraiment, que la littérature de von Salomon mérite tout ce tintouin ?
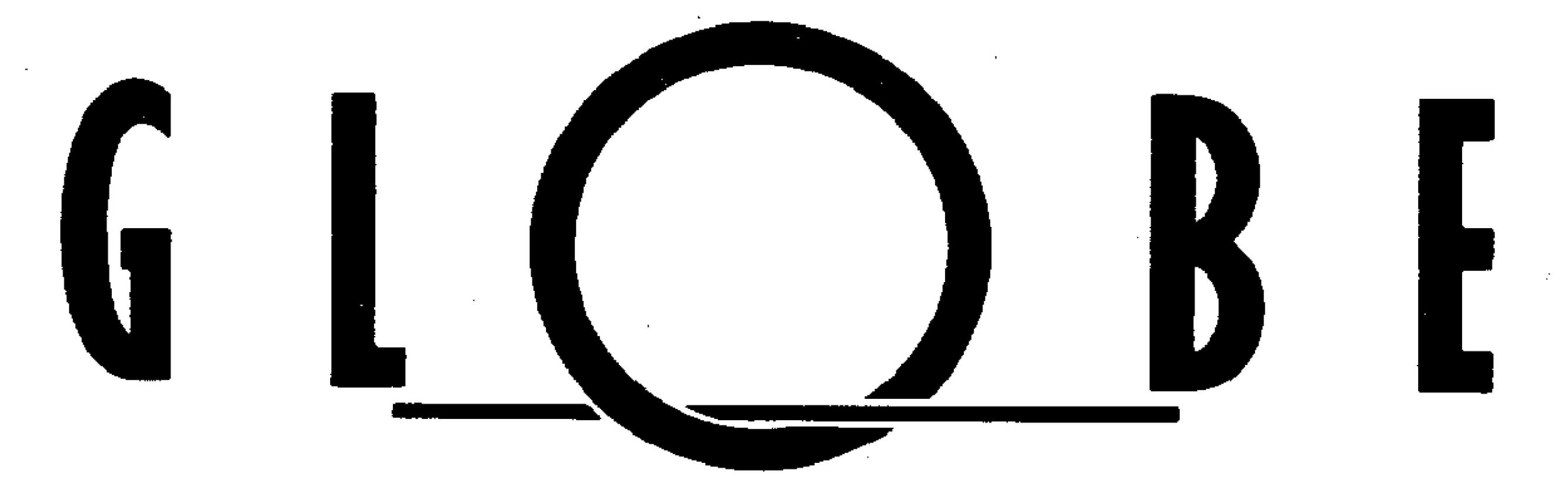
Réseaux sociaux officiels