Pourquoi ce coup de froid, soudain, sur le front de la cohabitation ? Et faut-il, comme mon cher Paul Guilbert, ce matin, dans Le Quotidien, y voir la versatilité d’une opinion prête à plébisciter un système tant qu’il semble aller de pair avec l’ordre, la paix sociale et la bonne gestion des petites affaires — et prompte à le désavouer aussi sec, dès lors qu’il apparaît synonyme de grèves, de crises et de revers ? Ma conviction, moi, c’est que les Français n’ont jamais plébiscité la cohabitation. Qu’ils ne l’ont jamais tout à fait, ni véritablement, désirée. Ou, plus exactement, que ce qu’on a pu prendre pour un désir n’était que l’infini plaisir qu’ils prenaient à ce spectacle politique nouveau, jamais vu de mémoire de républicain, qu’était la coexistence, pacifique, d’un président de gauche et d’un Premier ministre de droite. Ainsi, en 1974, de notre évidente jubilation à voir, je dis bien voir, l’installation du giscardisme, la déconfiture du gaullisme. Ainsi, en 1981, de notre non moins évidente jouissance à regarder, je dis bien regarder, les socialistes gouverner. Ainsi de ce spectacle, de tous ces spectacles successifs auxquels se réduit en fait, et de plus en plus souvent, la chose politique en France. On peut le déplorer, bien sûr. Mais, sur le fond, on n’y peut rien. On ne peut rien au mouvement qui fait que l’on s’intéresse aux affaires de la cité dans le même esprit, finalement, qu’au tiercé ou au Mundial. Ce spectacle-ci, lui, en tout cas, a fait long feu. L’intrigue n’est plus crédible. Les péripéties n’amusent plus. Et ses principaux acteurs feraient bien de s’en aviser, s’ils ne veulent pas laisser la place à ceux qui — suprême habileté ou providentielle naïveté ? — ont su s’en tenir à l’écart et se réserver pour le suivant.
Je sais que le sujet est délicat. Et je ne suis pas sûr que la « littérature » soit vraiment de mise face à un fléau d’une telle ampleur. Mais enfin comment — ne fût-ce qu’en quelques mots — ne pas rapporter cette affaire de Sida à ce que nous savons de l’histoire de nos sexualités ? Comment ne pas songer qu’elle arrive au moment précis où, pour la première fois sans doute dans l’histoire de l’humanité moderne, nous vivions notre désir dans l’innocence, la transparence et, disions-nous, la « liberté » ? Et comment ne pas penser, alors, qu’il y a dans cette épidémie nouvelle, dans le parfum de mort et de malheur qu’elle fait flotter autour des corps, comme un terrible désaveu du joli rêve libérateur ? Je n’irais pas jusqu’à dire, rassurez-vous, que le Sida soit le doigt de Dieu pointé sur nos péchés. Mais il ne me semble pas absurde de soutenir qu’il est comme un obscur rappel de cette dimension de maléfice, voire de crime, qui s’est attachée de tout temps à l’idée même de sexualité — et dont nous avions, étourdiment, cru pouvoir faire l’économie. Relire Bataille à ce propos. Relire les lettres de Flaubert à Louise Colet. Relire l’horreur de la chair façon Faulkner ou Dos Passes. Et puis, par-delà tout ça, relire ce que, depuis Augustin, la grande tradition chrétienne nous conte des rapports du Sexe et de la Chute. L’amour, oui, est toujours coupable.
Mais qu’est-ce qu’ils ont tous à grogner contre les sondages ? A redouter leur autorité ? A douter de leur fiabilité ? Bon, c’est vrai qu’il y en a parfois beaucoup. Et qu’il y a une fâcheuse tendance, chez certains de nos hommes politiques, à gouverner l’œil rivé sur leur cote de popularité ou le baromètre des opinions. Mais, en même temps, quelle merveille ! Quel fabuleux indicateur ! Quel irremplaçable moyen pour vous, pour nous, pour les citoyens en général, de donner leur avis, de s’exprimer ! Je ne crois pas que l’on ait rien inventé de mieux pour permettre à tout un chacun d’intervenir à tout moment, sur tout sujet, dans tout débat. Et je ne crois pas qu’on ait rien trouvé de mieux, surtout, pour permettre aux électeurs de se déterminer — non plus sur des partis, des appartenances toutes faites ou des clivages institués — mais sur des vraies idées, des vrais problèmes, des vrais enjeux. Mérite, donc, du système… Vertus de sa prolifération… Donnez-nous notre I.F.O.P., notre S.O.F.R.E.S, notre B.V.A. quotidienne… Si la dictature de l’opinion est bien, comme le disait Tocqueville, la forme la plus dévoyée de l’idéal républicain — sa libre expression est, à l’inverse, la plus sophistiquée de ses versions. Le sondage, ou la démocratie permanente. La sondomanie, stade suprême de la démocratie.
Question de Patrick Poivre d’Arvor sut TF1, l’autre après-midi, à propos de ces chanteurs, acteurs et autres bateleurs qui sont en train, me disait-il, de « supplanter les intellos ». Sans doute l’« intello » que je suis moi-même n’est-il pas le mieux placé pour répondre à cette interpellation. Et tant pis pour moi, après tout, tant pis pour l’ensemble de la cléricature, si elle n’est pas fichue de tenir son rang face à ces « directeurs de conscience » d’un nouveau type. N’empêche — et peut-être aurais-je dû le dire avec davantage de fermeté — que le phénomène, s’il se confirmait, serait bien évidemment catastrophique. Et qu’il y aurait là, dans cette disqualification des intellectuels traditionnels et dans le promotion, conjointe, de personnages sympathiques, charismatiques, parfois même courageux ou lucides, mais dont l’exercice de la Pensée n’a jamais été, que l’on sache, l’activité la plus ordinaire, un désastre incontestable. Penser, en effet, ce n’est pas rien. C’est quelque chose de spécifique. C’est une activité qui a ses lois, ses règles, ses procédures. C’est une activité qui, enfin, n’a probablement de sens qu’à épeler, gérer, prendre son parti de l’intraitable complexité des choses. Et aussi généreuse ou vertueuse que soit telle ou telle vedette du show-business je ne crois tout bonnement pas que son métier soit de gérer ce type-là de complexité. Qu’un Renaud parle, tant mieux. Qu’un Geldof s’engage, bravo. Qu’un autre élève le ton et couvre de sa voix les petits murmures de complaisance, je suis — j’ai toujours été — le premier à m’en réjouir. Mais que les uns ou les autres s’arrogent (ou pis : que les intellectuels eux-mêmes, dans je ne sais quel accès de masochisme jubilatoire, leur attribuent) le fabuleux pouvoir de poser les questions, de les articuler, d’en éprouver les impasses ou d’en indiquer les solutions, voilà qui ouvrirait la voie à un intolérable processus de banalisation, de vulgarisation, de simplification. Au mieux, ce serait le commencement d’une crétinisation généralisée. Au pire, l’antichambre d’une barbarie douce, souriante, presque invisible. Avec, dans les deux cas, le risque d’un rétrécissement sans précédent de cet « espace public de débat » qui est, nous le savons, le cadre et la condition même de l’éploiement démocratique. Gare, disait Hannah Arendt, à la dictature du stéréotype, de la trivialité, du lieu commun. Gare, avertissait Heidegger dans un passage célèbre de Sein and Zeit, au « pouvoir accablant du bavardage irrésistiblement engendré par le domaine public ». Et vive les « intellos », alors, s’il est vrai que leur rôle n’est pas de simplifier le monde, mais au contraire de le compliquer — et de résister, de ce fait, à ce qui pourrait bien devenir notre nouvelle langue de bois.
Est-elle si étonnante que cela, la vague de répression qui s’abat sur la Chine de M. Deng ? J’étais à Pékin, moi-même, il y a un peu plus d’un an. Invité à parler littérature et philosophie devant des auditoires universitaires, j’ai pu le faire, c’est vrai, dans un climat de liberté assez exceptionnel. Et partout, toujours, dans toutes les circonstances où j’ai eu à me trouver, j’ai pu apprécier directement l’incontestable vent de renouveau qui soufflait sur le pays. Reste qu’il fallait être bien naïf pour ne pas distinguer en même temps, par-delà les discours, les slogans, la débauche de publicité sur les murs de Tien An Men, par-delà l’apologie du profit, la vente de blue jeans au marché noir ou la troublante découverte, dans les couches les plus avancées de l’intelligentsia et du régime, de Sartre, de l’art abstrait ou du travail de Saint Laurent — il fallait être bien naïf, donc, pour ne pas s’aviser en même temps de l’immensité des forces qui contrariaient le mouvement et le vouaient à se renverser. On pouvait le dire à la façon de Lu Xun dénonçant tout ce vieux fonds ritualiste et dogmatique, héritier de l’ancien monde, qui est « comme une muraille de Chine dans la tête de chaque Chinois ». On pouvait le dire comme Élie Faure démontrant il y a presque un siècle — mais la leçon, ça saute aux yeux, valait pour aujourd’hui — comment la société chinoise est structurellement, organiquement, métaphysiquement rebelle à l’« impératif de modernité ». Ou on pouvait, plus simplement, se rappeler qu’il n’y a pas d’exemple d’une « libéralisation » menée, dans un régime et un pays socialiste, sous la bannière d’un Parti inentamé dans son privilège. Dans tous les cas, c’était clair. C’était quasi joué. Et je n’ai, au demeurant, pas rencontré un intellectuel, un écrivain ou un savant qui ne m’ait dit sa conviction que cette soudaine invitation qui leur était faite de parler, créer ou même écrire librement était un piège épouvantable. Parmi eux, cet astrophysicien de dimension internationale dont j’apprends aujourd’hui la chute. Parmi eux, ce romancier, menacé lui aussi, avec qui j’avais passé une longue soirée à discuter de Marguerite Duras, Albert Cohen et Valéry Larbaud. Sans parler des autres, de tous les autres dont, à l’heure où j’écris ces lignes, je suis, hélas, sans nouvelles.
Je ne vais pas, en quelques lignes, « démolir » Julian Schnabel. Mais devant l’avalanche de louanges et d’hommages que lui rend la presse française, j’ai tout de même envie de dire que son travail n’est pas très loin d’incarner, à mes yeux, tout ce qu’il peut y avoir de plus détestable dans la peinture contemporaine. Expressionnisme mal digéré… Relents de « bad painting »… Abus de la citation… Priorité de la performance, du « coup », sur la qualité même de l’œuvre… Ce qui manque sûrement le plus à ce peintre par ailleurs sympathique et talentueux, c’est cette espèce de rigueur, de souveraineté absolue du goût, qui font les très grands artistes. Baudelaire, dans son Salon de 46 : si Michel-Ange était si grand, c’est que son art était « précis comme une science ».
Rénovateurs au bureau politique… Contestataires au comité central… Déclarations incendiaires d’untel… Rupture spectaculaire de tel autre, qui passait pour un fidèle de X, mais était un allié de Y… La presse est pleine, ce matin, de titres racoleurs sur la nouvelle crise qui, à l’entendre, déchirerait le parti de Georges Marchais. Et moi, face à tout ça, face à ces débauches d’informations, face à ces trésors d’intelligence et de dialectique employés à nous faire croire que le cadavre se porte bien, qu’il bouge, mais oui qu’il bouge encore, et que la meilleure preuve en est qu’il est en train de se diviser — j’ai d’abord envie de rire. Comme si rien ne changeait, décidément, au soleil de la classe politique ; et qu’en vertu d’un involontaire mais très réel comique de répétition, son programme commun devait, malgré les années, rester le même : encore, toujours et d’abord sauver le P.C.
Relu des textes de Hermann Broch sur l’« enfer de l’art pour l’art », de « dégoût de la littérature pure » et l’obligation, à ses yeux, de « mettre toute esthétique sous la domination de l’éthique ». Formules à l’emporte-pièce. Appels terroristes à épouser l’« esprit de l’époque ». Déclarations un peu folles sur Néron devenant le modèle même du « littérateur esthétisant ». Et lecture douteuse de Kafka qui, « sentant l’ultime insuffisance de toute approche par le moyen de l’art », aurait décidé, nous raconte toujours Hermann Broch, d’« abandonner le royaume des lettres et de demander que son œuvre fût détruite ». Le problème, néanmoins, est là, posé dans sa radicalité extrême et auquel je ne sache pas qu’un écrivain digne de ce nom ait jamais pu se dérober : jusqu’à quel point suis-je, moi qui écris, non point seulement le témoin mais l’obligé du monde.
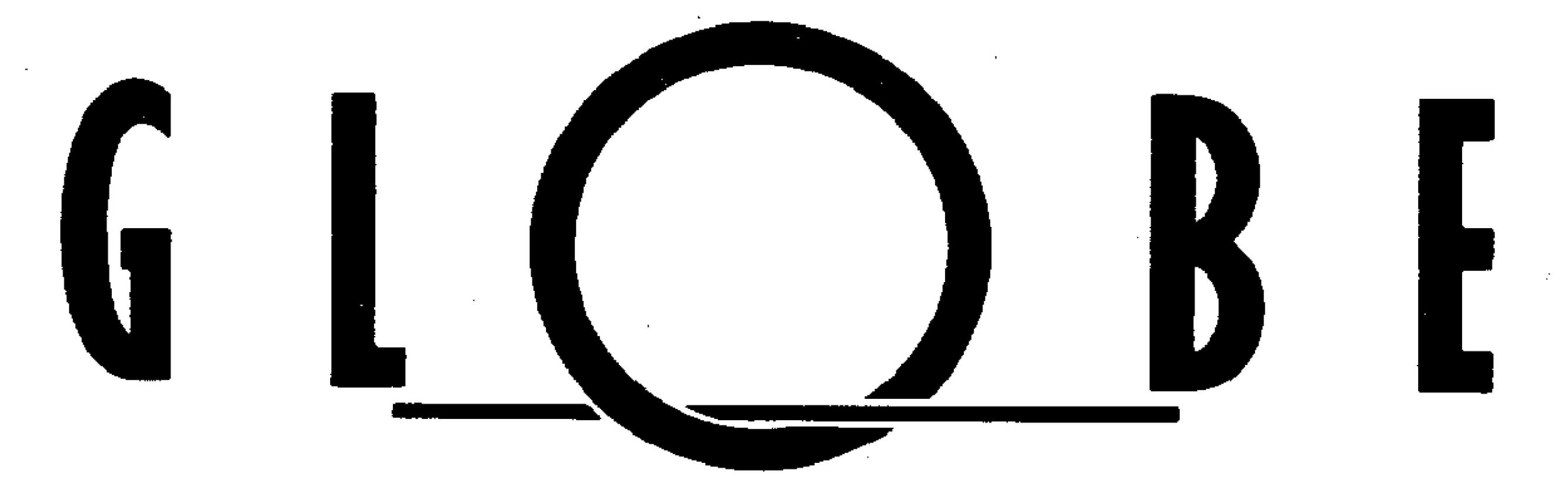
Réseaux sociaux officiels