Oui, bien sûr, je persiste. Et quitte à choquer davantage encore, je répète au sujet de la cinquième chaîne : primo, que tout ce qui peut aider à la libération de nos ondes, à l’élargissement de notre espace audiovisuel, que tout ce qui peut remédier à notre effroyable provincialisme culturel mérite d’être soutenu ; secundo, que tout ce qui va dans le sens de notre xénophobie rampante, que tout ce qui confirme ou renforce nos réflexes poujadistes traditionnels, que tout ce qui peut alimenter nos tentations archaïques les plus frileuses mérite d’être combattu ; tertio, et par conséquent, qu’on peut déplorer le contexte où l’affaire s’est nouée, qu’on peut condamner telle ou telle clause de la concession octroyée, qu’on peut regretter que le choix ne se soit pas porté sur telle autre équipe, tel autre projet (et j’avais moi-même, autant le dire, de toutes autres inclinations…) — l’antiberlusconisme primaire que l’on a vu se déchaîner ces dernières semaines n’en reste pas moins, lui, totalement inacceptable. Vive Berlusconi, alors ? Et carte blanche à celui qui, à entendre nos braillards, aurait tué le cinéma italien ? J’attends de voir, simplement. Et je dis que la raison, la logique, la défense même de la culture passent aussi, pour le moment, par la fin de ce psychodrame.
François Châtelet donc après Lacan, Barthes, Foucault, Braudel, Clavel, Sartre, Aron, sans parler de Louis Althusser qui n’en finirait pas, à ce que l’on me dit, d’errer dans sa nuit intérieure… C’est peut-être une illusion. Mais j’ai le sentiment que jamais, dans l’histoire des idées, on n’avait vu semblable hécatombe. J’ai le sentiment que jamais, nulle part, aucune génération n’aura vu s’éteindre si vite toutes les étoiles qui composaient son ciel. Et cela fait un drôle d’effet, vraiment, de voir chuter un à un, comme sous une invisible mitraille, les plus hautes figures d’une époque dont je continue de penser, moi, contrairement à la rumeur, qu’elle aura été l’une des plus fortes et des plus effectivement fécondes de notre histoire intellectuelle… S’ajoute à ce malaise, en l’occurrence, l’impression qu’une fois de plus il aura fallu attendre qu’il meure pour voir reconnaître à un philosophe l’ensemble de ses mérites. L’impression que l’on n’avait jamais dit tant de bien de Châtelet, jamais chanté si haut la louange de son Platon ou de sa Naissance de l’histoire que depuis que l’intéressé n’est plus là pour l’entendre. Les grands écrivains, c’est bien connu, sont toujours les écrivains morts. Et face à ce spectacle, face à son absurdité, face à cette génuflexion collective devant le cadavre d’un homme que j’aimais, qui a guidé mes premiers pas de philosophe et dont on faisait, il faut bien le dire, moins de cas lorsqu’il vivait, j’ai peine à ne pas songer à cette si belle page où le jeune Malraux, songeant à sa gloire future, disait que le seul rêve digne d’un écrivain était d’être non pas, certes, mort — mais « comme mort ».
Il y a des « fondamentalistes », c’est vrai, dans les rangs de la résistance afghane. Il y a des gens qui ne partagent à peu près rien de l’idée que nous nous faisons de la démocratie, des droits de l’homme, de la liberté. Et je me souviens en avoir entendu moi-même plus d’un, il y a quelques années, dans les montagnes du Khunar ou les bases de Peshawar, peindre sous des couleurs bien inquiétantes la société selon leurs vœux ou me raconter très tranquillement, sans l’ombre d’un scrupule ou d’un remords, comment ils venaient de « tailler un gilet » — entendre : couper les jambes et les bras — à un prisonnier soviétique. Faut-il, cela dit, en tirer des conséquences quant au soutien que nous apportons à l’ensemble de la Résistance ? Et est-ce une raison, comme pourrait le laisser entendre le Matin d’aujourd’hui, de reconsidérer l’urgence, la nécessité ou la légitimité de notre engagement à ses côtés ? C’est ainsi que l’on raisonnait, je le sais bien, en ces temps où il fallait être tout pour ou tout contre, adhérer totalement ou pas du tout — et où l’on n’avait le choix, dans l’affaire vietnamienne par exemple, qu’entre ces deux attitudes extrêmes et extrêmement imbéciles : accepter le napalm américain sous prétexte qu’on refusait le communisme ou accepter le communisme, sous prétexte qu’on refusait le napalm. Aujourd’hui, grâce au ciel, les temps changent. Nous avons appris la complexité, la difficulté de l’Histoire réelle. Et c’est un des avantages de leurs désillusions récentes que d’avoir fait entendre à nos clercs qu’il était possible de s’engager sans se rallier, de militer sans adhérer, de défendre des hommes sans en faire des saints ou des héros, bref de prendre des partis sans se croire obligés, pour autant, d’en accepter en bloc l’entière vision du monde. C’est ainsi que, pour ma part, j’ai pu récemment prendre le parti des étudiants coréens en lutte contre leur État — tout en sachant fort bien ce que leur idéologie pouvait véhiculer de douteux. C’est ainsi que j’ai pu, il y a trois ou quatre ans, intituler un article « Nous sommes tous des catholiques polonais » — tout en demeurant conscient de l’inexpiable contentieux qui oppose le monde juif au catholicisme de la Vierge noire. Et c’est ainsi que, récemment encore, je n’ai pas attendu que la guerre du Proche-Orient s’éteigne, que l’antisémitisme disparaisse, pour lutter moi aussi, au coude à coude avec des hommes dont je me sentais parfois très loin, contre la vague raciste qui menaçait de déferler. Assez de révérences, autrement dit. Assez de vénérations. Assez, au sens strict, d’idolâtrie. C’est en aidant les résistants afghans sans endosser forcément tous leurs choix, c’est en restant intraitables sur nos devoirs sans rien céder de nos valeurs que nous sortirons peut-être enfin de notre âge totalitaire.
Un mot encore sur Le Matin. Parce que ce journal m’a été cher. Parce que j’y ai, douze mois durant, tenu un bloc-notes comme celui-ci. Et parce que je ne détesterais rien tant, avec ces quelques lignes sur l’Afghanistan, que de sembler joindre ma voix à l’odieuse petite clameur qui, depuis près d’un an maintenant, s’acharne à le déconsidérer. Car enfin quoi ? Suffit-il à un journal de choisir son camp pour devenir un non-journal ? Lui suffit-il de choisir son camp pour devenir pestiféré ? Et suffit-il à un homme, surtout, d’avoir passé quelques mois de sa vie dans un bureau de ministre pour que s’effacent d’un coup, des décennies de littérature et de journalisme authentique ? Je ne suis, pour ma part, pas « socialiste ». Et je me suis trouvé plus d’une fois en désaccord avec ce journal. N’empêche qu’aux analphabètes qui vont, de dîner en ville en cocktail, répétant leur sempiternel procès du nouveau Matin-godillot, j’ai tout de même envie de rappeler que le cas n’est, à tout prendre, pas plus choquant que celui de L’Express mendésiste il y a trente ans — et puis que, sur le fond, c’est-à-dire sur la forme journalistique elle-même, j’attends que l’on me démontre en quoi le journal de Max Gallo est plus mal informé, plus culturellement débranché ou plus politiquement archaïque que celui, mettons, de Serge July.
Ce que je pense du libéralisme, me demande un journaliste japonais ? Et comment un homme comme moi, « antimarxiste » en diable et « moderne » comme personne, n’est-il pas plus enthousiaste de cette vague néo-libérale qui, paraît-il, submerge Paris ? Mon problème, tenté-je de lui expliquer, ce n’est bien évidemment pas la « liberté » des libéraux. Ce n’est pas le juste souci qu’ils ont des intérêts de la « société civile ». Ce n’est même pas — encore que, sur ce point, je ne sois pas sans réticences — la méfiance de principe dont ils accablent un État naturellement porté, disent-ils, à l’abus de pouvoir, au despotisme. Non, mes réserves sont plus profondes. Elles tiennent à cet inébranlable optimisme qui sous-tend tout leur discours. Elles tiennent à cette image d’une société qui, pour peu qu’on en laisse librement jouer les lois, produit toute seule, ou presque, l’ordre qui lui convient. Elle tient, si l’on préfère, à cette sourde mais redoutable conviction qu’un ordre spontané vaut mieux qu’un ordre concerté, une structure « naturelle » qu’une structure instituée, un rapport « immédiat » entre les hommes, qu’un rapport médiatisé. Et leur pire erreur, en fin de compte, est de parier sur je ne sais quelle harmonie naturelle des désirs, des passions ou des intérêts. Le libéralisme, en d’autres termes, n’est pas une politique, mais une métaphysique. Son tort n’est pas de minimiser l’État, mais d’escamoter le Mal. Et je m’aperçois, tout en parlant, que je ne trouve rien de mieux à lui opposer qu’une série de livres dont la liste laisse, d’ailleurs, pantois mon Japonais : la Bible par exemple, les textes politiques de Freud ou les Écrits de Lacan — tous experts à décrire ou traiter l’inévitable dimension de maléfice qui trame un lien social.
A propos de « libéralisme » toujours, ce discret entrefilet sur la Suède qui, apparemment, songerait à réglementer sa littérature « pornographique ». La nouvelle, mine de rien, est importante. Elle est même, quand on y songe, spectaculaire, car la Suède a tout de même été le paradis de cette sexualité libérée, innocente, affranchie de tout interdit et déliée de toute contrainte que l’on nous promettait naguère. Et qu’elle en revienne à présent, qu’elle disqualifie ses propres rêves, qu’elle renonce à cette « permissivité » qui fit une part de sa légende — n’est-ce pas la preuve que là non plus ça ne marche pas ? Que là non plus l’harmonie spontanée des désirs, des passions, etc., n’était qu’une illusion ? N’est-ce pas la preuve que ce qui vaut de nos cités devrait valoir, à la limite, de nos corps et de nos sexes ? Lacan encore qui avait à peu près tout dit. Lacan, au Séminaire, tonnant que « le sexe n’existe pas, qu’il n’y a pas de rapports sexuels », que toutes ces histoires de libération, de désaliénation, de déculpabilisation d’un érotisme réprimé ne sont que de la « foutaise ». Lacan oui, ce Juif de Lacan, retrouvant les plus anciennes leçons bibliques pour nous dire qu’il n’y a pas de désir qui ne soit toujours, déjà et de toute éternité, marqué au sceau de la Loi — et que l’oublier ou le refuser c’est prendre le risque de la mort. Les morts, hélas, sont morts… Plus là pour témoigner…
Plus là pour conjurer leurs rêves… Leurs yeux vides simplement, leurs corps étrangement mortifiés qui, loin déjà dans ma mémoire, rappellent qu’on meurt aussi d’aimer…
Il y a eu Caton… Fabien… Commynes… D’autres sûrement… Et voilà que nous arrive un mystérieux Charles de France dont le non moins mystérieux La Gaule m’inquiète, rédigé dans le ton gaulliste le plus pur, ne tardera pas, soyons-en sûrs, à se trouver au centre des commentaires. Chirac ? Barre ? Mitterrand peut-être, à cause de la défense et illustration de la cohabitation que l’on y lit en filigrane ? Le plus étrange, avec les livres de ce genre, c’est que toutes les solutions sont possibles. C’est que toutes les hypothèses sont plausibles. C’est qu’on les dirait tout entiers construits pour demeurer ouverts à ce jeu infini des lectures. C’est, comme dit Olivier Orban, éditeur et complice de Charles de France, qu’ils reflètent l’aléa de la chose politique en même temps que sa nécessité. Cher Olivier ! Cher, très cher ami ! Que cette occasion me soit donnée de rendre hommage à celui que je tiens pour l’un des meilleurs, des plus talentueux éditeurs d’aujourd’hui. L’espèce se fait rare, n’est-ce pas ? Alors que, de sa survie, dépend un peu de l’honneur des lettres.
D’où vient que l’on puisse revoir cinq, six fois le même film sans que s’émousse le moins du monde le plaisir que l’on y prend ? La seule explication que je vois, c’est qu’il ne s’agit plus vraiment du même film. C’est qu’il se recompose, se réorganise, chaque fois différemment. C’est qu’il est comme un kaléidoscope dont les mille éclats brisés se combineraient en un ordre toujours neuf, toujours inattendu. Et je crois, à la limite, qu’une bonne part de ma jouissance vient de l’incertitude où je me trouve de la combinaison qui va sortir, de l’ordre ou du sens qui vont jaillir : il y a les scènes que je connais, les répliques dont je me souviens, les gestes ou les images que je pressens sans les attendre, et puis il y a tout ce que j’ai oublié, tout ce sur quoi le souvenir que je gardais du film avait en quelque sorte fait l’impasse et qui, lorsqu’il revient, me bouleverse davantage que si je ne l’avais jamais vu.
Dans le cas d’Autant en emporte le vent, cela dit, il y a peut-être autre chose… Une autre source à sa magie… Une autre explication à l’envoûtement qu’il exerce à nouveau sur moi. Et je me demande s’il ne faudrait pas la chercher, cette explication, du côté de ce formidable malentendu autour de quoi s’organise l’essentiel de son intrigue. Car enfin imaginez la Princesse de Clèves indifférente à Monsieur de Nemours. Imaginez Mathilde ou la Sanseverina insensibles aux charmes de Julien ou de Fabrice. Imaginez Coralie éprise du baron Nucingen ou la belle Emma énamourée de son Bovary de mari.
Impossible ? Oui, impossible. Sauf que c’est ce qui se passe dans le cas de Scarlett O’Hara. Et sauf que tout le livre, tout le film, sont bâtis autour de ce paradoxe qui veut qu’elle ne parvienne à aimer que le piteux Ashley et qu’elle reste désespérément rebelle à celui que le charme, le sort, le lecteur même et le spectateur lui destinent de plus en plus fièvreusement à mesure que se déroule l’histoire : le sublime Rhett Butler, sous le masque de Clark Gable. Autant en emporte le vent, ou le seul grand roman bâti, à ma connaissance, sur une érotique de la déception.
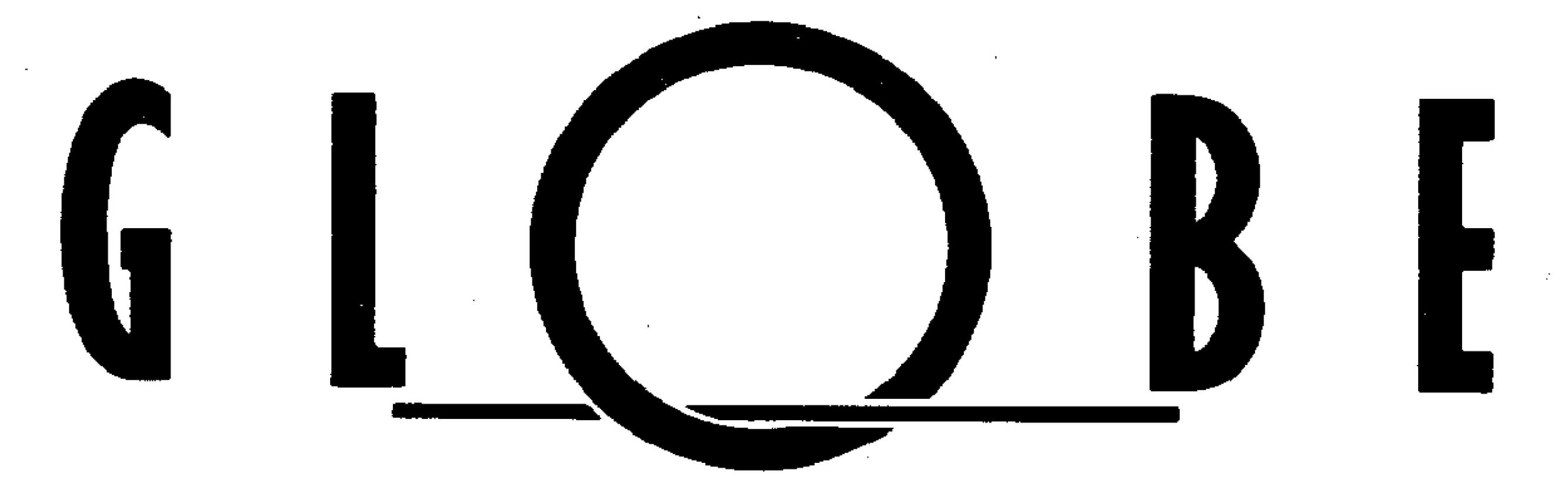
Réseaux sociaux officiels