Mais non, je ne retire rien. Je maintiens, à la virgule près, ce que j’écrivais l’autre semaine de la sotte idolâtrie de la jeunesse dont s’est accompagné le mouvement étudiant. Et je répète par conséquent, n’en déplaise aux démagogues, que ce culte, cette révérence, cette mise en avant de la « jeunesse » devenant, au fil des jours, une sorte de mythe suprême, suprêmement indiscuté et qui ne mériterait, tout à coup, qu’hommages et génuflexions, était le vrai point faible de ces semaines. Que les étudiants aient eu raison de se révolter allait, bien entendu, de soi. Et je ne crois pas leur avoir marchandé, du reste, ni ma sympathie ni mon soutien. Mais de là à entonner l’hymne bêtifiant aux valeurs, aux privilèges, à la ressource ou à la sainteté d’une classe d’âge supposée, en tant que telle, dépositaire de la vérité, il y avait un pas que, personnellement, je répugnais à franchir. Souvenir de Baudelaire moquant, en termes définitifs, le juvénisme de Musset. Souvenir de Blum et Zola s’inquiétant de voir un « prince de la jeunesse » porter haut l’étendard de la croisade contre Dreyfus. Souvenir de cette époque où les communistes comme les nazis — et qui sait si ce n’est pas leur véritable point commun ? — ouvraient des « camps de jeunesse » et fomentaient des sociétés qui devaient être, disaient-ils, comme une nouvelle « jeunesse du monde ». Pardon de me citer moi-même. Mais j’ai écrit, dans mon Idéologie française, sur les dangers de ce juvénisme. Et, sans aller jusqu’à prétendre que ce serait le cœur ou le nœud des fascismes, je ne suis pas loin de penser que c’est l’un des plus sûrs piliers de ce naturalisme politique où j’ai toujours cru voir l’origine des barbaries. Vive, donc, le mouvement étudiant ; mais à bas le lieu commun juvéniste. Vive le souffle d’insoumission qui va de Paris à Shanghai, de Rome à Alma-Ata ; mais à bas le vent de conformisme qui tend à rabattre tout ça sur les très vieilles lunes d’une soi-disant culture adolescente. Pauvreté de la « jeunesse ».
Ce qui me gêne dans ce musée d’Orsay, ce n’est pas le lieu. Ce n’est pas l’architecture. Ce n’est pas la mégalomanie douce, et d’ailleurs plutôt plaisante, de Gae Aulenti. Non, ce qui me gêne et, à la limite, me choque, ce serait plutôt la manière dont, sur le fond, ce musée a été conçu. Quel intérêt en effet de réconcilier, comme on dit, pompiers et impressionnistes ? Quel intérêt de juxtaposer Monet et William Bouguereau, Fantin-Latour et Carolus-Duran ? Quel intérêt, quel sens est-ce que ça peut bien avoir de nous rappeler ainsi, à chaque pas et à chaque instant, que le portrait de Mme Cézanne est contemporain de celui de Madeleine Brohan, ou tel chef-d’œuvre de Renoir des odalisques de Chassériau ? Un musée, d’habitude, ça sert à oublier justement tout ça. Ça sert à effacer ces rencontres de hasard, ces paysages de contingences. Ça n’a de sens, si l’on préfère, qu’à abstraire les grandes œuvres de cette nature, de cette matière, de cette histoire naturelle et matérielle qui est leur part la plus pauvre, la plus inessentielle. Et on sait bien, depuis Malraux, comment les plus grands musées sont ceux qui, suspendant en quelque sorte le face à face des formes et du monde, deviennent le lieu du dialogue, par-delà les lieux et les âges, des formes avec les formes. Là, donc, c’est le contraire. C’est exactement le contraire. De sorte qu’en ramenant les formes à leur temps, les toiles à leur contexte, telle œuvre d’Ingres à un Combat de coqs de Gérôme, telle Fernande de Picasso à L’Arche de Bourdelle ou le fameux Atelier de Courbet, refusé par le jury de l’Exposition de 1855, aux scènes d’orgies romaines de Thomas Couture célébrées au même moment, on réduit le génie de l’Art à son expression la plus plate. Erreur, au fond, sur l’idée même d’histoire de l’art. Erreur sur le rapport qu’elle entretient, cette histoire, avec l’Histoire en général. Et refus, apparemment, de cette loi qui veut que l’Art ait un temps à lui, irréductible au temps des choses. Vive le Musée, pensé comme absence au monde. Vive le bougé, le tremblé, l’imperceptible mais sublime tressaillement des œuvres qu’induit, d’habitude, cette absence — et que je ne retrouve pas à Orsay.
Donc, Sakharov est libre. Enfin, libre, façon de parler. Et c’est tout de même l’une des très grandes folies de l’époque que de voir la presse, la télé, l’opinion publique du monde entier et toutes les chancelleries de la planète crier « Alléluia » ! sous prétexte qu’un homme, après des années de martyre et de réclusion, se voit enfin autorisé à émigrer… jusqu’à Moscou ! Mais, bon, c’est ainsi. C’est la grande nouvelle du mois. Et tous ceux qui, comme moi, ont milité pour cet homme, dénoncé son exil à Gorki, tenté de relayer sa voix ou de l’empêcher de s’égarer, auraient mauvaise grâce, en ce jour, à ne pas crier victoire. Ne pas oublier le martyre, cependant. Ne pas oublier ce corps meurtri, cette santé délabrée. Ne pas oublier que, à Moscou même, un autre corps à corps s’annonce dont il n’est pas sûr d’être vainqueur. Et ne pas oublier surtout qu’au même moment, tout juste quelques jours avant que ne nous arrive l’écho de l’auguste clémence gorbatchévienne, un autre homme, Anatoli Martchenko, crevait tout doucement au fond d’une geôle de Tchistopol. Ceci est-il cause de cela ? La mort de celui-ci vaut-elle à celui-là son provisoire élargissement ? Et le Kremlin a-t-il voulu, aux termes d’une habile mais macabre comptabilité des douleurs, effacer le fâcheux effet qu’allait avoir le meurtre — car c’est le mot qui convient — de l’un des héros de la dissidence ? Sûr, en tout cas, que l’heure n’est pas à l’euphorie, aux imbéciles soulagements ou aux doctes dissertations sur le cours nouveau soviétique, la libéralisation du régime ou la modernisation sans précédent de ses systèmes de répression. Tant pis si je choque : mais je crois qu’il y a un malentendu de fond dans la façon que nous avons d’envisager ou de traiter cette question des droits de l’homme en U.R.S.S. Ma conviction, finalement, c’est que Gorbatchev pourrait libérer tout à fait Sakharov ; qu’il pourrait à la limite, donner dix ou vingt mille fois satisfaction à nos pressions et exigences — mais qu’il resterait encore, au cœur de son système, au nœud du lien social tel qu’il continuerait de le tramer, quelque chose d’irréductiblement pervers, dont on aurait tort de le tenir quitte. Les droits de l’homme, en d’autres termes, c’est un système. C’est l’index d’une société. C’est l’autre nom d’une communauté qui a ses lois et ses contraintes. Et qui est, à ce titre, contradictoire des appareils totalitaires.
J’ai toujours été fasciné par ces écrivains rares, délibérément laconiques et maigres, dont les livres ne semblent pouvoir nous arriver et rejoindre la lumière du jour qu’au terme d’une très longue course dans les souterrains de la création. Ils nous donnent, ces écrivains-là, un livre tous les dix ans. Un livre tous les vingt ans, parfois. Il leur arrive même, tout au long d’une vie, de ne nous donner qu’un livre, un seul, indéfiniment recommencé, interminablement remis sur le métier. Et il y a en général dans ces livres comme un surcroît de grâce et de mystère qui pourrait bien leur venir de ce séjour prolongé, tellement énigmatique ! dans ce que j’imagine être les limbes d’un désir plus obscur, plus exigeant que le banal désir d’écrire. Cas de Stendhal, sans doute. Cas de Choderlos de Laclos. Cas de Baudelaire ne produisant en fin de compte, mis a part Les Fleurs du mal ou les Poèmes en prose, qu’une douloureuse suite de fragments, ébauches, articles, plagiats et traductions. Cas de Mallarmé, encore, dilapidant son œuvre en une myriade de textes de circonstance sans écrire un traître mot, lui, de son livre fondamental. Yves Berger — mon ami Yves Berger — appartient manifestement à cette famille littéraire-là. Il est dans la lignée de ces écrivains retenus, contenus. Et cela n’est certainement pas étranger à l’inhabituel attrait qu’exercent sur moi, depuis vingt ans, ses rarissimes romans. Hier, Le Fou d’Amérique. Avant-hier, Le Sud. Aujourd’hui, après plus de dix ans, ces Matins du Nouveau Monde auxquels les mauvais esprits avaient fini par ne plus croire — mais dont nous étions quelques-uns à savoir qu’ils tiendraient la promesse des deux premiers. Le livre, donc, est là. Conforme à ce que j’en attendais. A la réserve près, tout de même, qu’il s’agit du chef-d’œuvre d’Yves.
Un mot sur ces Matins. Ce qui frappe le plus, il me semble, c’est le goût de la langue qu’on y devine ; c’est le plaisir du verbe qu’on y retrouve ; ce qui frappe, ce qui saute tout de suite aux yeux, c’est cette passion folle, presque charnelle, pour le poids, la densité, la corpulence ou le corps des mots. Berger, c’est évident, se damnerait pour un mot rare. Il crèverait pour une tournure, une nuance ou un point de style. Et il y a dans sa façon de rajeunir une expression inusitée, d’altérer insidieusement les usages traditionnels, il y a dans la manière qu’il peut avoir d’articuler les formules courantes selon des règles corrigées ou de modifier insensiblement le tissu même, ou le grain, de la langue dont il hérite, tout un jeu extraordinaire dont on avait perdu le sens. En fait-il trop, cette fois ? Et verra-t-on dans cette jouissance stylistique une excessive cérémonie, une affectation exagérée ? Autant reprocher à Saint-John Perse ses « aumaille », « vaigrage », « achaine », « brehaigne », « pavie » et « effarvate ». Autant retirer à nos meilleurs prosateurs ce fabuleux pouvoir qu’ils ont de décréter leur lexique, d’inventer leur grammaire, d’instituer les régularités muettes mais singulières qui les désigneront à chaque ligne. Oui, lire Les Matins du Nouveau Monde pour découvrir, au-delà de Fenimore Cooper et de La Case de l’oncle Tom, en deçà de la légende américaine, le dialecte d’un grand écrivain.
Croisé des tas de gens depuis trois jours qui, connaissant probablement mes liens d’amitié avec l’auteur, me rebattent les oreilles d’un article de Bothorel, publié dans Le Figaro, et où, au terme d’une analyse des récents mouvements étudiants, il aurait, m’affirme-t-on, carrément mis en question le sacrosaint principe de la « liberté de l’information ». L’ont-ils lu, cet article ? Non, ils ne l’ont pas lu. Et tous le citent, en fait, sur la foi d’une émission de télé qui, l’autre samedi, l’a épinglé. Vérifications faites, il n’y avait rien de ça, bien sûr, dans le papier. Mais une réflexion plutôt subtile et d’inspiration, disons, « macluhanienne » sur les pouvoirs et les principes, les pièges et les prestiges, les dérapages même ou les effets pervers dont les grands médias modernes peuvent, dans une société démocratique avancée, se rendre responsables. Rumeur, donc. Mensonge. Désinformation caractérisée, à l’échelle de Landerneau. Je ne suis pas — loin s’en faut ! — d’accord avec tout ce qu’écrit Bothorel. Mais si je m’attarde ainsi sur cette petite histoire, c’est qu’elle me semble exemplaire, après tout, des mœurs intellectuelles du moment. Ragots et non débats… Calomnies et non polémiques… Ouï-dire, en lieu et place du plus élémentaire souci d’information… Serions-nous en train de payer le prix de l’interminable — et pathétique — déstructuration de notre scène idéologique ?
Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Annaud est-il conforme ou non à son modèle littéraire ?
Cette question est mal posée. Admettons, une fois pour toutes, qu’un film n’est pas la traduction d’un livre ; qu’il n’en est ni l’« adaptation », ni la « transposition » ; mais que de façon bien plus subtile, il le recommence et le rejoue. Il y a de bons recommencements, certes, et il y en a de mauvais. Mais cela ne concerne qu’indirectement les écrivains. Car la langue est différente. Le registre n’a rien à voir. Les produits, au bout du compte, sont rigoureusement hétérogènes. Et, entre le film nouveau et le livre qui, naguère, portait son titre, le véritable rapport est un rapport d’homonymie. De là, la grande différence des véritables écrivains face aux passages éventuels de leurs livres à l’écran. De là la souveraine aisance avec laquelle un Fitzgerald passait d’un genre à l’autre, mais sans songer une seule seconde à les rabattre l’un sur l’autre. De là, encore, cet aveu de Romain Gary, dont le moins que l’on puisse dire est que le cinéma l’a honoré, qui me confia un jour n’avoir pu désirer, véritablement désirer, un film tiré de ses livres. Entre cinéma et littérature, malentendu comme d’habitude.
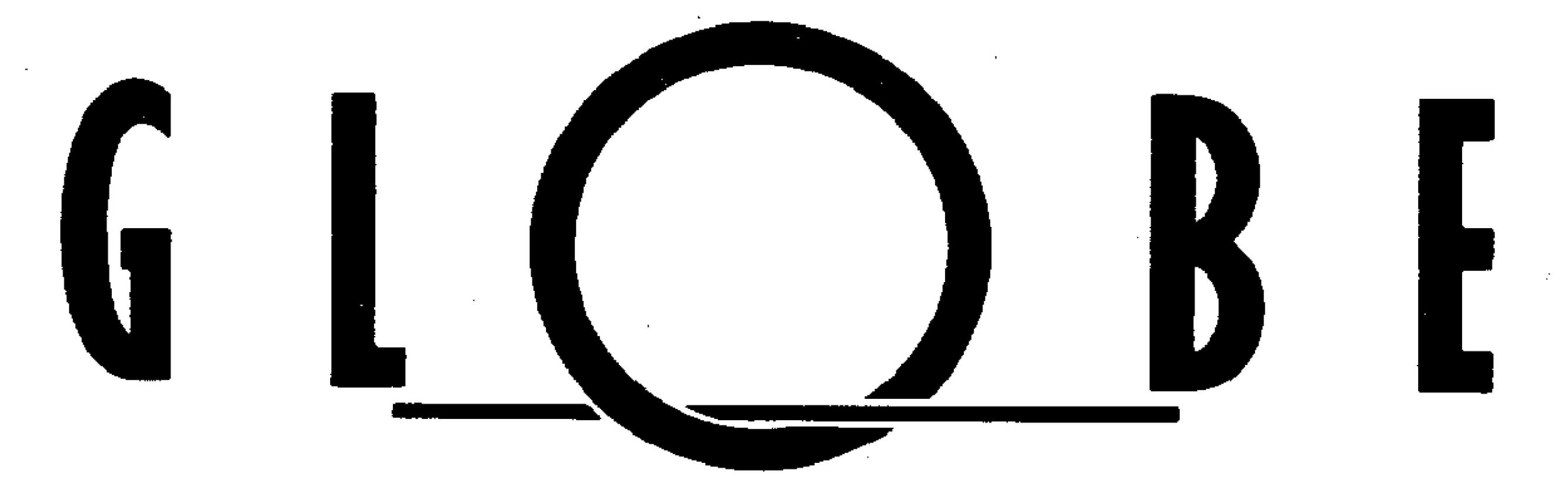
Réseaux sociaux officiels