Retour de Milan où le procès d’Armando Verdiglione, ce psychanalyste italien accusé d’avoir extorqué de l’argent à ses patients pour financer ses colloques, ses maisons d’édition ou ses revues, a finalement été ajourné. Je ne crois pas, pour ma part, à ces accusations. Je ne crois pas à cette rocambolesque histoire de psychanalyste-Raspoutine hypnotisant quasiment ses malades pour les contraindre à investir dans l’édition des œuvres de Borgès, Wiesel, Kundera, Marek Halter. Et ayant pris la peine — et le temps — d’entrer dans le détail du dossier, j’ai surtout l’impression d’une singulière machination où la haine, la bêtise, le règlement de comptes politique ou la rancune auraient eu plus que leur part. C’est ce que je comptais dire ce matin, donc. C’est ce que je redirai le mois prochain. En ajoutant, bien sûr, qu’Armando est un ami et que je m’honore d’avoir moi-même édité chez Grasset — avant Gallimard, après Bourgois — un certain nombre de ses livres. Horrible image en tout cas, et pour l’heure, de cet ami, de cet auteur, arrivant enchaîné (oui, je dis bien enchaîné, littéralement enchaîné, comme dans un procès du Moyen Age) à la barre du tribunal — avec, pour tout cortège, l’hystérie d’une classe politique et journalistique qui ne lui pardonne peut- être pas d’avoir été, depuis quinze ans, face au double et sinistre chantage du terrorisme et du communisme, l’un des intellectuels les plus authentiquement libres de l’Italie contemporaine.
M. Le Pen, donc, n’est pas fasciste. Il n’est pas antisémite. Et chacun sait — ou devrait savoir — que l’ex-tortionnaire reconverti dans l’édition de chants hitlériens est devenu, au fil des années, le plus respectable des démocrates. Question, alors, au démocrate : « que pense-t-il des deux petits articles dont Le Matin d’aujourd’hui se fait l’écho et que son propre journal consacrait, l’autre semaine, à cette fameuse “thèse” parrainée par l’université de Nantes et qui prétendait, paraît-il, nier l’existence des chambres à gaz ? » Ils disaient en substance, ces articles : primo, que c’est parce qu’elle a perdu la partie que l’Allemagne a été « accusée de crimes de guerre » ; secundo, qu’« il n’est pas du tout prouvé que la fameuse solution finale ait été l’extermination » ; tertio, que « les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des juifs forment un seul et même mensonge historique » ; quarto, que la plupart des « accusateurs », au premier rang desquels « l’ashkénaze de première classe Yvan Levai’ », sont, et ce n’est pas un hasard, « d’origine juive » ; enfin, et pour couronner le tout, que ce formidable mensonge n’a, et n’a toujours eu, pour but que d’« ouvrir la voie à une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l’État d’Israël et le sionisme ». On croit rêver, n’est-ce pas ? Eh bien non, on ne rêve pas ! On est en plein réel, au contraire ! Et vu les liens de M. Le Pen avec ledit journal, vu aussi que l’un des deux signataires de ces tissus d’insanités se trouve être un journaliste — François Brigneau — dont il faisait noblement l’éloge, il y a quelques semaines, à la télévision, je me permets d’insister : ou bien le leader du Front national désavoue sans équivoque des propos qui, quoi qu’il en ait, l’engagent, ou bien il ne dit mot — mais en couvrant, alors, un petit passage à l’acte néo-nazi dont il lui sera difficile, désormais, de se dépêtrer.
A propos de néo-nazis, il y en a un qui, en attendant, poursuit son bonhomme de chemin et qui, quand ces lignes paraîtront, aura été élu président de la République autrichienne. Ça vous étonne, vraiment ? Ça vous semble si bizarre, si extraordinaire que cela ? Je ne connais pas bien Vienne, c’est sûr. Mais je me souviens de ce qu’en disait Freud. Je me souviens de ce qu’en disait Broch. Je me souviens de ce qu’ils en écrivaient, tous, les vrais grands Viennois d’avant-guerre, tandis qu’ils fuyaient l’un après l’autre cette ville absurde, un peu spectrale — incontestable centre, disait Broch, du « vide européen des valeurs » et inévitable berceau, du coup, du nazisme triomphant. Non, ne jamais oublier Broch quand on pense à cette affaire Waldheim. Ne jamais oublier sa nausée face à une « gaieté viennoise » où il ne pouvait voir, disait-il encore, que « la gaieté des imbéciles ». Et bien garder présente à l’esprit, surtout, sa description d’une vie politique qui, déjà, lui semblait si effroyablement fantomatique. Vienne 86 — ou l’éternel retour des revenants.
Pas très étonnantes non plus — encore que dignes d’être notées — nos réactions d’Occidentaux à la catastrophe de Tchernobyl. On a eu très peur en effet. On a été très scandalisés. On a trouvé que les Soviétiques étaient de fieffés salauds d’empoisonneurs qui se moquaient comme d’une guigne de la santé de nos enfants. Et on s’est même risqué ici ou là, dans un joli mouvement de révolte, de résistance ou d’impatience, à interdire le passage de nos frontières aux laitages, aux salades, aux fruits et aux légumes éventuellement contaminés. Un absent, pourtant, dans tout ça. Un absent dont personne, pour le coup, ne semble s’être soucié, alors qu’il était tout de même — et c’est peu dire ! — le premier concerné par cette affaire. Je veux parler des Ukrainiens bien sûr qui, pendant qu’on se demandait, à Monaco, si on avait atteint le centième, le millième ou le millionième de la radioactivité susceptible de nous menacer, attendaient eux, bel et bien, les signes d’une mort annoncée. Cynisme ? Égoïsme ? Chacun pour soi, et chacun chez soi, à l’heure où la fin du monde semble revenir à l’ordre du jour ? Tout se passe en réalité comme s’il s’était fait une sorte de « blanc » dans nos têtes, nos langues, nos imaginaires — et comme si c’était Tchernobyl même, j’entends le vrai Tchernobyl, avec ses morts, ses agonisants et ses pauvres pompiers d’apocalypse travaillant, sous la menace des tanks, à éteindre le brasier, qui avait proprement disparu de notre représentation de la planète. Oui, éclipse de Tchernobyl… Évaporation de ses victimes… Dissolution pure et simple du noyau le plus dur, le plus véritablement radioactif, de la réalité… Encore un effort, chers amis des libertés, de la démocratie, des Droits de l’homme ou du combat antitotalitaire — et, dans vos planisphères de demain, l’U.R.S.S. aura remplacé la Terra Incognita des cartes médiévales : elle sera, pour de bon, devenue la zone du plus épais mystère en même temps que, fatalement, de la plus haute indifférence.
« Gorki c’est un peu Tchernobyl. Là-bas, c’est une chape de béton qu’ils coulent sous la centrale. Nous, c’est une chape de silence qui va de nouveau nous recouvrir… » Cette phrase d’Elena Bonner, comme toutes celles qui, de loin en loin, parviennent encore à nous instruire de la situation de Sakharov à Gorki, me plonge, je dois l’avouer, dans une infinie perplexité. Car enfin, à quoi cela rime-t-il ? Pourquoi cet acharnement inouï sur le corps d’un simple individu ? L’U.R.S.S. a-t-elle besoin, vraiment, de peser de tout son poids sur la tête d’un homme seul, isolé parmi les siens, qui a renoncé depuis longtemps à représenter, dans son pays, un quelconque mouvement de « masse » ou d’« opinion » ? Et n’y a-t-il pas quelque chose d’absurde, surtout, dans le spectacle de cet État concentrant toute sa violence sur un symbole aussi visible quand il serait si simple, après tout, de l’oublier, de le neutraliser, de l’enterrer éventuellement même sous les honneurs, les fleurs ou les faveurs ? La seule explication me dit Nicole Wisniak (dont on ne répétera jamais assez, soit dit en passant, qu’elle fait, une fois par an, l’un des plus beaux journaux du monde), c’est qu’on est en présence, là, d’un phénomène non pas absurde, mais irrationnel — et qui, comme souvent dans les pays totalitaires, ne ressortit plus tout à fait à l’entendement politique traditionnel. Retrouver la définition de l’« homme en trop » selon Soljénitsyne… Retrouver, chez Zinoviev, l’admirable portrait de ces « indépendants » qui ne représentent, aucune espèce de « groupe », de « classe » ou de « collectif», mais dont la répression aveugle, sans rime ni raison, est comme le ciment métaphysique de la « société ivanienne ».
Sur ma table, pour le moment, le non moins admirable portrait, dans La musique et les lettres de Mallarmé, de ces « êtres à côté » dont « on ne sait trop à leur éloge comment les désigner, gratuits, étrangers, peut-être vains » — mais dont l’impalpable « minorité » fait pourtant, allez savoir pourquoi, comme un invisible et paradoxal étai à la communauté qui les exclut. Il s’agit des poètes, bien sûr. Mais il me plaît de penser qu’il pourrait s’agir, aussi bien, de ceux que le discours politique — mais s’agit-il, encore, de politique ? — appelle les « dissidents ».
Comme Sartre est mauvais quand il parle de littérature ! Et comme il est décevant, ce Mallarmé précisément que republie ces jours-ci Gallimard ! Dans le genre, on avait déjà le Genet… On avait le Flaubert… On avait le Baudelaire surtout, avec l’odieux procès qu’il instruisait contre un poète accusé, selon les pages, de n’être pas assez socialiste, progressiste, féministe, utopiste, j’en passe — ah ! si seulement l’auteur des Fleurs du mal avait eu le bon goût de se ranger, aux côtés de Hugo, Sand et Michelet, dans la forte cohorte des amis du genre humain dont Sartre se voulait l’héritier… Avec ce Mallarmé, pourtant, je crois que tous les records sont battus. Et on pouvait difficilement aller plus loin sur les chemins du malentendu et du réductionnisme idéologique. Que penser d’un philosophe qui, aussi prestigieux soit-il, est capable de nous dire que la conception mallarméenne de l’amour « traduit dans le langage des beaux esprits cette misogynie d’époque que Bismarck incarnait par ailleurs » ? que penser quand il nous assène que les valeurs où l’auteur d’Igitur voyait le signe d’« une aristocratie de l’esprit », ne sont rien, en réalité, que la « sublimation des vertus bourgeoises » et des « illusions de la classe dirigeante » ? que conclure, oui, quand il est, ce philosophe, capable d’écrire, noir sur blanc, que « le naufrage du Coup de dés traduit parfaitement bien la terreur de la classe possédante qui prend conscience de son inévitable déclin » ? On savait, depuis L’Homme au magnétophone et la brouille avec Pontalis, que Sartre était irrévocablement fermé au discours de la psychanalyse. J’ai peur, à la lecture de ce petit ouvrage, du reste inachevé, qu’il ne faille admettre qu’il était tout aussi étranger au mystère, au secret, à l’essence de la littérature.
Le vrai problème, bien entendu, c’est celui du statut de ce type de textes et de la nécessité qu’il peut y avoir, à titre posthume ou non, de les rééditer. On connaît la position des critiques, des érudits, des scoliastes : tout publier, absolument tout, car il y va de la cohérence, de l’unité profonde d’une œuvre. Mais on connaît aussi celle de Kafka : « Brûler, oui tout brûler » ; celle de Proust : « Oublier, effacer les pages avortées » ; celle de Mallarmé encore, prenant la peine entre deux hoquets, dans l’intervalle des quelques heures qui séparent les deux crises qui vont le tuer, de rédiger de sa propre main une « recommandation quant à ses papiers », où il est expressément dit : « Brûlez par conséquent ; il n’y a pas là d’héritage littéraire, mes pauvres enfants » ; bref, on sait la sainte terreur qu’ils ont tous à la seule idée que leurs brouillons, leurs projets, leurs lapsus ou leurs œuvres tremblées puissent accéder un jour à la dignité de textes publiés. Qu’une première édition de ce Mallarmé ait été faite voici quelques années déjà, alors que Sartre vivait encore, dans une revue confidentielle, change assurément quelque peu les données du problème. Sur le fond, pourtant, je n’en démords pas : l’admirateur que je suis des Mots, des Carnets de la drôle de guerre ou de certaines Situations ne voit pas bien ce que la réédition aujourd’hui, dans une collection grand public, de ce laborieux exercice de style pouvait bien ajouter à la gloire de leur auteur. Dieu garde les écrivains des disciples et des héritiers !
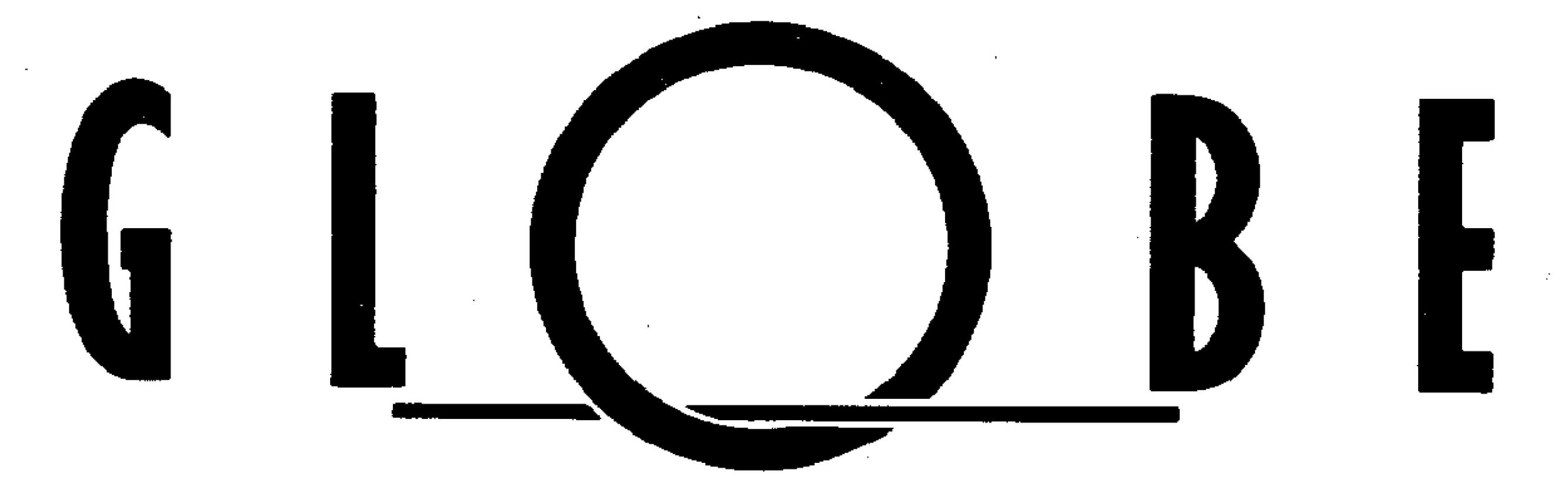
Réseaux sociaux officiels