Extraordinaire mécanique, une fois de plus, de la Rumeur. Il a suffi que les Soviétiques se taisent, il a suffi qu’ils retiennent l’information sur l’origine, la nature, l’ampleur de la catastrophe de Tchernobyl pour que la nouvelle coure, s’enfle, s’emballe et que les bruits les plus fantastiques — les plus contradictoires aussi — se répandent tout à coup à la vitesse d’une épidémie. Je ne nie pas, bien entendu, qu’il y ait eu, à la base de tout, l’épidémie nucléaire concrète. Et il n’est pas douteux que, cette fois, rumeur ou pas rumeur, l’humanité ait frôlé de près un véritable cataclysme. Ce que je dis, simplement, c’est que le secret, dans cette affaire, a joué, comme à l’accoutumée, son rôle accélérateur et que loin, comme le croyaient sans doute les stratèges du Kremlin, de raréfier les commentaires, il n’a fait qu’alimenter les fantasmes, les hantises, les exagérations ou les hallucinations — la fin du monde en Ukraine… un nouveau Moyen Age en Pologne… une flopée de cancers ou de maladies nouvelles en Suède… sans parler de ces experts qui, ne sachant strictement rien, multipliaient allègrement par mille le nombre des victimes. J’ajoute, soit dit en passant, que cette politique du secret avait déjà eu en amont, dans le déclenchement même de la catastrophe, sa part de responsabilité et qu’un accident de ce type n’était possible que dans un pays où le secret donc, l’arbitraire, le silence du pouvoir et sa toute-puissance autorisaient à construire, sans contrôle ni censure, des centrales bâclées, vieillies avant l’âge et dénuées, à tout le moins, des conditions de sécurité que l’on exigerait partout ailleurs. A la question cent fois posée : « Un accident de ce calibre avait-il autant de chances d’arriver dans un pays occidental », il ne faut pas craindre de répondre alors : « Non, probablement non — pour autant qu’un pays occidental est un pays où il faut compter avec une opinion publique qui, à la lettre, contraint l’État. » Et à ceux qui vont partout répétant que la catastrophe de Tchernobyl aura pour conséquence, en Europe, de rendre un peu de leur crédit perdu aux mouvements écologistes d’autrefois, il ne faut pas craindre de rétorquer non plus qu’il n’y a, à tout prendre, qu’un gagnant dans cette tragédie — et que ce gagnant c’est la démocratie. Le socialisme, au temps de Lénine, c’était « les Soviets plus l’électricité ». Le socialisme, sous Gorbatchev, c’est « les Soviets plus la radioactivité ». Où l’on voit que les affaires du totalitarisme, décidément, ne vont pas fort.
Lu le Danton de Buchner avec, dans la bouche d’un comparse, cet étrange portrait du héros révolutionnaire occupé, nous dit-on, à « rassembler morceau par morceau la Vénus Médicis auprès de toute les grisettes du Palais-Royal » et s’affligeant « de voir comment la nature morcelle la beauté et en disperse les fragments dans leurs corps »… Émotion, bien entendu, à découvrir là, au détour d’un texte inconnu, cette théorie du « harem invisible et dispersé » que j’attribuais dans Le Diable en tête, au personnage de Benjamin. Et fascination, à nouveau, pour cette idée d’un réseau, d’un système, d’une batterie de corps codés, dûment étiquetés et assignés, chacun, à une affectation sexuelle déterminée. Hors de toute vraisemblance et nonobstant, bien sûr, les commandements de la morale, connaissez-vous plus rigoureuse définition de ce que, pour aller vite, on appelle en général « libertinage » ?
Je vais peut-être choquer quelques-uns de mes amis. Mais je ne suis pas si sûr que ça, après tout, qu’elles n’aient que des mauvaises pensées en tête, les carmélites qui, depuis un an ou deux, prétendent s’installer à Auschwitz. Et je ne me sens pas le droit, en ce qui me concerne, de venir suspecter ou mettre en doute l’authenticité de l’esprit de pénitence, de réparation ou de repentir qui est, à les entendre, le vrai moteur de leur démarche. Est-ce à dire que je m’y rallie ? Grands Dieux non ! Mais ça veut certainement dire en revanche que le problème, une fois de plus, mérite d’être mieux posé. Si cette affaire de Carmel me choque, en effet, ce n’est pas à cause de la supposée duplicité des nonnes. Ce n’est pas à cause de l’indécrottable antisémitisme des Polonais dont elle est censée témoigner. Ce n’est même pas vraiment parce qu’en venant prier ainsi sur les cendres des juifs, les catholiques tenteraient, en fait, de s’approprier leurs morts et leur martyre. Non, la seule, la vraie question à mes yeux, est de savoir si, sur le fond, face à une tragédie aux dimensions de la Shoah, l’idée même de pénitence (aussi purs, sincères, qu’en soient le vœu et l’intention) conserve encore un sens. Je crois, personnellement, que non. Je crois qu’il y a des crimes dont aucune prière, aucun remords, aucune action de grâce ou de repentir, entameront jamais la trace. Je crois qu’il y a des blessures si terribles, si effroyablement inouïes et mémorables, qu’elles méritent de saigner jusqu’à la fin des temps humains. Et je ne suis pas loin de penser, à la limite, que s’il y a bien un point où nous divergeons métaphysiquement d’avec les catholiques, c’est sur cette croyance têtue en l’irrémissibilité d’un Mal qu’aucune espèce de rédemption ne viendra plus racheter, effacer ou transfigurer. Le désert donc, au lieu de la plus haute désolation… Le silence des hommes, là où pesa si lourd l’épouvantable silence de Dieu… L’absence de tout établissement humain, comme condition sine qua non du devoir de commémoration… C’est parce qu’il estime que dans la nuit d’Auschwitz, brillait encore un peu de la divine lumière que l’archevêque de Cracovie peut proposer en conscience d’en sanctifier le nom ; c’est parce qu’il me semble, moi, à l’inverse, qu’il n’y avait pas de lumière du tout, pas un soupçon d’humanité, d’espérance ou de conscience aux portes des chambres à gaz que toute cette affaire me scandalise. C’est toute ma conception de la mort autrement dit, toute ma conception du deuil et de la mémoire, qui font qu’Auschwitz doit demeurer, à mes yeux, ce qu’il est depuis quarante ans : le plus grand cimetière de la planète.
Un journal américain me reproche, ce matin, d’appartenir à cette race d’intellectuels négatifs, nihilistes et, au bout du compte, totalement stériles et destructeurs qui n’ont jamais su, insiste-t-il, que « dire non, indéfiniment non aux forces de la vie ». Sur le moment, l’article m’agace. Je lui trouve ce côté ostensiblement positif et matter of fact qu’on a souvent en Amérique, pour parler de nos écrivains. Et au mépris de mes sacro-saints principes — ne jamais répondre ! ne surtout jamais polémiquer ! — je songe même un court instant, à me fendre d’une réplique. Très vite, pourtant, je me calme. Et relisant l’article en question, je me demande s’il n’aurait pas, après tout, mis le doigt sans le savoir sur quelque chose d’assez juste et si ce ne serait pas notre honneur justement, à nous autres clercs d’Europe, que de cultiver ce négativisme total, viscéral, instinctif, qui nous tient en quelque sorte à distance des religions communautaires. Tous les écrivains que j’admire ressemblent, en tout ça, à ça. Tous ont passé leur temps, leur vie, et, bien évidemment leur œuvre à refuser ce qui, autour d’eux, était susceptible de faire souche, masse, bloc ou rassemblement. Et de Flaubert à Baudelaire, de Céline à Joyce ou Artaud, des grands Austro-Hongrois à Faulkner ou Dos Passos, je n’en connais pas un qui ne se serait férocement esclaffé si l’on s’était risqué à le rappeler à l’ordre d’une quelconque positivité. Souvenir, à ce propos, d’un texte de Malraux opposant à l’étrange frénésie « d’acquiescement » d’un Claudel, le contre-exemple de Sartre — l’homme qui ne savait que dire non, encore non, toujours non, fût- ce à lui-même, à son œuvre, à son public ou à son éventuelle postérité. J’aime ce Sartre, moi aussi. J’aime son style bougon, têtu et même un peu revêche. J’aime son air de vieux râleur, attardé en anarchisme et indocile, jusqu’au bout, à toute discipline. J’aime ce Sartre tête de mule, j’aime ce Sartre tête de brique — j’aime ce Sartre « aux idées de pierre », en guerre perpétuelle avec la pierre de ses idées. Au cœur de ce Sartre-là, cette conviction sourde, et « nihiliste » s’il en est : la plus terrible menace qui pèse sur un écrivain est celle de la pression, de la sommation, de l’agrégation à quoi le convie toujours, tôt ou tard, la bêtise positiviste.
D’accord avec Marguerite Duras pour dire le soulagement que m’a procuré, le mois dernier, le raid américain sur Tripoli. Ce n’était pas la bonne méthode ? Il y avait d’autres stratégies, plus finement appropriées à la guerre antiterroriste ? C’est possible. C’est même probable. N’empêche que c’est le mérite de Reagan, au moins, de l’avoir reconnue, cette guerre ; d’en avoir tiré les conséquences ; et d’avoir rompu, enfin, avec le règne de l’hypocrisie.
En face de ça, en France, les petites facilités de la coabdication.
L’ennui, avec cette avalanche de morts illustres qui n’arrêtent pas, depuis quelques mois, de nous dégringoler dessus, c’est le ton patelin et effroyablement cagot qu’on se croit obligé de prendre, chaque fois, pour rendre son dernier hommage au disparu. Eh quoi ! Otto Preminger, par exemple, n’avait-il donc que des amis ? Simone de Beauvoir était-elle vraiment cette vieille dame digne et distinguée dont on s’accorde partout à célébrer les pieux mérites ? Genet lui-même était-il ce bon garçon, honnête et laborieux forçat des lettres dont on nous fait le portrait — et que reste-t-il, dans les nécrologies académiques qui le submergent, du voyou, du rebelle, de l’asocial et de l’enragé dont je ne partageais (et c’est peu dire !) aucune des positions mais dont le déclassement était, qu’on le veuille ou non, indissociable de l’œuvre ? On me permettra, sur un cas au moins, d’enfreindre la règle non écrite. Il s’agit de Mircea Eliade, le moins connu de ces disparus, mais celui qui, à certains égards, me touche peut- être de plus près. J’aime bien l’écrivain, en effet. Je respecte l’érudit. Mais la louange est si forte, la dévotion si galopante et la confusion du coup, si évidemment menaçante que je ne résiste pas à la tentation de dire, mieux que mes réserves, mon hostilité résolue aux implications idéologiques de l’œuvre. Éliade, philosophe du sacré ? Oui, c’est ça. Mais un Sacré si vaste, si diffus et si universellement épandu qu’il pose plus de problèmes qu’il n’en résout ; qu’il brouille plus de pistes qu’il n’en ouvre ; et qu’il n’a peut-être rien fait d’autre, au fond, qu’alimenter les courants les plus douteux des hiérophanies contemporaines. Témoignage personnel — mais qui en concernera, je crois, plus d’un : lorsque, il y a dix ans, je commençai à travailler sur l’histoire des religions en général, et celle des monothéismes en particulier, c’est dans La Nostalgie des origines et Le Mythe de l’éternel retour qu’il me fallut bien reconnaître le plus rude obstacle à ma recherche. Le Sacré contre le Saint… L’ésotérisme contre la théologie… Les fameux retours aux sources contre le recours au Verbe et la Loi… On ne saurait poser, n’est-ce pas, contrariétés plus radicales ? Plaise au ciel qu’on ne vienne pas alors, à la faveur d’une célébration nécrologique un peu hâtive, aplatir tout ça, le réduire, le recouvrir — et nous refaire dans la foulée, le coup d’un « retour au spirituel » qui, présenté de cette façon, sans autre forme de procès, ne sera jamais, à nouveau, que l’autre visage d’une régression.
« Kurt Waldheim est un grand patriote. Si j’étais électeur en Autriche, je saurais pour qui voter. » Cette hère déclaration d’Helmut Kohl, chancelier de la République fédérale d’Allemagne, comment ne pas la rappeler pour terminer ? C’est elle qui, ce mois-ci, aura probablement battu tous les records de l’infamie. Allemagne-Autriche, même combat dans l’ordre de la honte : c’est ce que, en 1938, on appelait l’Anschluss.
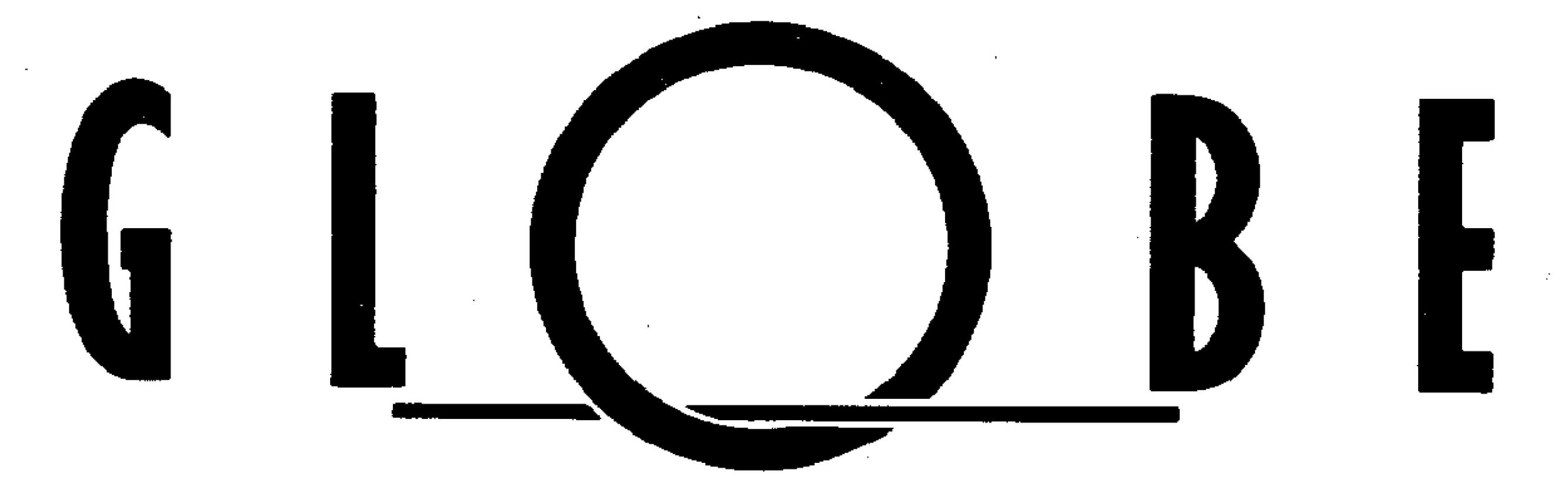
Réseaux sociaux officiels