Ainsi donc il aura suffi d’une pétition, d’un manifeste, d’un ministre de la Culture plébiscité par les créateurs, d’une couverture de Globe peut-être, d’une ou deux déclarations, pour que la nouvelle coure, s’enfle, s’inscrive fièvreusement sur les télescripteurs du monde entier et nous revienne ici, à Paris, avec l’étrange autorité d’une évidence indiscutée : les intellectuels de gauche sont de retour ; c’en est fini de leur silence, de leur absence, de leur bouderie ou de leurs caprices ; et les voici à nouveau, tout malentendu dissipé, en rangs serrés derrière une gauche qu’ils n’avaient que trop longtemps désavouée… Vrai ? Faux ? Caricatural en tout cas. Approximatif et un peu niais. Car s’il est exact que le vent tourne, qu’intelligentsia et gauche se rapprochent, s’il est exact, par exemple, que je consente moi-même aux socialistes en campagne un soutien dont je me gardais bien aux heures de leur triomphe, je ne vois pas que l’on puisse, pour autant, présenter les choses de cette façon ; et je crois même, pour tout dire — et au risque d’assumer, une fois de plus, le rôle ingrat du rabat-joie — qu’il y a, dans le climat présent, toute une part d’emphase et d’euphorie qu’il est urgent de tempérer.
Car enfin, et pour commencer, que s’est-il passé au juste ? Comment le rapprochement, puisque rapprochement il y a eu, s’est-il concrètement opéré ? Sont-ce vraiment les intellectuels qui, touchés par une grâce tardive, sont enfin rentrés au bercail de la gauche — ou ne serait-ce pas la gauche plutôt qui, à l’épreuve du pouvoir et de ses erreurs, aurait bougé, glissé, révisé ses préjugés pour, au fil d’une lente quoique sûre reconversion, se retrouver, au bout du compte, sur des positions plus acceptables aux clercs qui la boudaient ? Sur la question communiste par exemple c’est elle qui a bougé. Sur la question de l’U.R.S.S., des Droits de l’homme, c’est elle, évidemment aussi. Au chapitre de l’idéologie ce ne sont pas les clercs, que je sache, qui sont revenus au marxisme — mais elle encore qui a cessé de s’y référer. Et il n’est pas jusqu’à ce fameux terrain culturel enfin — lieu par excellence du « ralliement » dont on nous rebat les oreilles — où la même remise à jour ne se soit sourdement opérée : ce n’est pas moi, mais Lang, qui a changé depuis le temps où je lui reprochais un anti-américanisme primaire et des éloges d’une introuvable « latinité » — et si je désarme aujourd’hui, si nous désarmons tous, si nous sommes si nombreux, désormais, à saluer son talent et à nous féliciter de son action, c’est bien parce que le Lang d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier et qu’il a, littéralement, fini par changer de discours… Je maintiens, en d’autres termes, ce que je disais au lendemain du 10 mai, à savoir que ce ne sont pas les intellectuels qui, alors, « retardaient » sur l’événement mais l’événement qui, au contraire, retardait sur ce que les intellectuels pensaient, disaient, écrivaient depuis des années ; et j’ajoute simplement que ce qui a changé depuis, ce qui s’est vraiment passé, ce n’est pas cette reddition des clercs que tout le monde tient pour acquise et qui serait en train de les ramener, humbles et repentants, dans le giron de la sainte famille — mais la reddition de la famille plutôt, son incroyable repentir et la spectaculaire reconversion qui fait que peu à peu, sans tambours ni trompettes, elle s’aligne sur les positions même au nom desquelles, il y a cinq ans, nous nous devions de la censurer.
Alors, bien sûr, elle ne le dit pas. Elle s’obstine même à ne pas le dire. Et c’est un étrange spectacle, en vérité, que de voir cette gauche socialiste qui a plus évolué en cinq qu’en cinquante ans, faire comme si de rien n’était — comme s’il ne s’était rien passé et qu’elle était là simplement, arrondie en son histoire, telle qu’en elle-même le pouvoir ne l’aurait, grâce au ciel, pas entamée… Pourquoi ? Je l’ignore. Mais ce que je sais, en revanche, c’est qu’il y a dans cette attitude, dans ce déni du « passage » et des erreurs qu’il a sanctionnées, quelque chose non seulement d’absurde mais d’éminemment dangereux. Le propre d’une erreur, en effet, c’est qu’elle n’est pas vraiment liquidée tant qu’elle n’est pas tout à fait assumée. C’est qu’elle n’est pas irréversiblement dépassée, tant qu’elle n’est pas verbalisée. Et il y a tout lieu de craindre alors, qu’en hésitant à dresser le procès-verbal, en refusant de nous donner les explications qui s’imposeraient, en laissant s’installer, entre ses démons et elle, un silence bien plus pesant, quand on y songe, que celui dont elle nous faisait naguère si bruyamment reproche — il y a tout lieu de craindre, oui, que la gauche ne coure ainsi un risque dont elle ne soupçonne pas toujours l’ampleur, la gravité : voir revenir demain, avec une violence extrême, le refoulé que, de manière bien étourdie, elle croirait avoir étouffé… On comprendra que, là encore, je m’efforce de résister à l’euphorie régnante. On comprendra que le soutien que j’apporte aux socialistes d’aujourd’hui ne vaut en aucune manière, à mes yeux, quitus à leurs égarements d’hier. On admettra surtout, j’espère, que le rôle d’un intellectuel, face à une amnésie de ce calibre, ne peut pas être de se taire — mais de dire, plutôt, ce qui est tu ; de rappeler ce qui est oublié ; de remémorer pour son compte propre, mais peut-être aussi pour celui de la gauche, cette part de son histoire qu’elle a si périlleusement occultée. Dimanche, à l’heure de voter, je penserai, bien entendu, aux réformes de Badinter. Je penserai au travail de Jack Lang. J’aurai en tête cette « ligne Bérégovoy » dont j’ai fait ici même l’éloge. Mais je n’oublierai pas pour autant, qu’on me pardonne, certain congrès de Valence. Je n’oublierai pas Fiterman, le populisme de Mauroy, le maurrassisme de Chevènement. Je n’oublierai pas les bermudas de Castro, les lapsus crypto-totalitaires de tel ou tel, ou ce dictateur nicaraguayen aux tribunes du 14 juillet. Si je ne veux rien oublier de tout cela c’est qu’il s’agit, je le répète, de l’ineffaçable part de nuit qui borde « la lumière » socialiste et constitue, pour demain comme pour hier, sa plus inquiétante limite.
Autant dire que je suis troublé quand j’entends les socialistes d’aujourd’hui, à mesure que la campagne avance, durcir la ligne, hausser le ton, nous expliquer que, de notre soutien, dépend rien moins que le salut de la France démocratique et transformer leurs adversaires, du coup, en un vague ramassis de fascistes probablement doublés de factieux. François Mitterrand, chez Mourousi, a tenté, me semble-t-il, de donner un coup d’arrêt à cette tendance. Il a fermement déclaré qu’il y a, dans les rangs de l’opposition, des personnalités de cœur et de talent. Mais rien n’y a fait. Les petits chefs ont continué. Et c’est un autre singulier spectacle que de les voir, eux qui ont tant daubé, jadis, sur le fameux « moi ou le chaos », aller partout répétant, celui-ci : « moi ou le désert » ; celui-là : « moi ou le fascisme » ; celui-là encore : « moi ou une régression dont vous n’avez pas même l’idée… » Propos de campagne, dira-t-on… Oui, sans doute, propos de campagne. Et l’autre bord, c’est vrai, n’a pas été non plus en reste sur ce registre de l’invective. Reste qu’un intellectuel n’a pas à enchérir, me semble-t-il, dans ces concours d’indignité. Et si, dans une campagne donc, il a un rôle à assumer c’est, autant qu’il est en son pouvoir, de faire échec aux tombereaux de bêtise que l’on déverse jour après jour dans le gueuloir électoral. Je voterai socialiste, je le répète. Je le ferai avec fermeté, détermination. Mais je ne pense pas que, de ce vote, dépende la survie de ce pays. Je ne pense pas que, s’il échoue, la France rechutera dans les ténèbres. Je me refuse à croire et par conséquent à dire, que, l’actuelle opposition n’étant composée que de benêts et de salauds, elle nous imposerait, en cas de victoire, un ordre social irrespirable. Démagogie que tout cela. Mauvaise foi. Imposture. C’est parce que je refusais cette imposture que j’ai, le mois dernier, signé le Manifeste que lançait Globe et qui était tout sauf une plate-forme électorale.
Car que disait-il, ce Manifeste ? je sais qu’il s’est trouvé un certain nombre de commentateurs pour y voir, Dieu sait pourquoi, un texte de haine et d’exclusion. Et j’ai moi-même eu, le jour de sa parution, un long débat avec mon ami Paul Guilbert qui lui reprochait, en substance, de soupçonner globalement la droite de nous préparer Le Pen, les tribunaux d’exception, le retour de la peine de mort et la mort des libertés… Ce texte en réalité, et pour peu qu’on le lût vraiment, était bien plus mesuré que ça. Il était surtout beaucoup plus fin. Et c’était un texte qui, loin de porter l’anathème sur la « droite » en tant que telle, la mettait en garde contre des tentations qui, en effet, la menaçaient mais dont il lui appartenait, pensions-nous, de conjurer le péril. N’y avait-il pas, dans l’idée même de dresser le catalogue des dix mesures à ne pas franchir sous peine de ruiner, effectivement, notre culture démocratique, une présomption non pas de crime, mais au contraire d’innocence ? Marquer les bornes au-delà desquelles le retour de la droite serait inacceptable, n’était-ce pas marquer ipso facto, dans le même geste et la même démarche, les bornes en deçà desquelles il serait au contraire acceptable ? Il n’y a pas une mais deux droites, disaient les signataires. Il y en a une qui glisse au fascisme, il y en a une autre au triomphe de laquelle on se résignait, ma foi, sans peine. Et tout le texte était écrit pour, face aux éternels et irresponsables tenants du « bonnet blanc, blanc bonnet », rappeler qu’entre ces deux droites il y a une différence, non de degré mais de nature. Le contraire du sectarisme, autrement dit. Le contraire du stalinisme. Le contraire de la facilité, de l’imbécillité partisanes.
Mieux, tout le texte était écrit pour faire en sorte que la différence soit de nature, pas de degré. Et si je l’ai signé c’est qu’il me semblait, par son existence même, par le seul fait qu’il soit lancé et à l’opposition adressé, contribuer à opérer le démarquage entre ces deux droites. Il y a, suggérait le manifeste, un débat dans l’opposition sur la question de la peine de mort. Il y a un débat sur Badinter, la Cour de Sûreté de l’État, les juridictions d’exception. Il y a de vraies discussions sur la culture, les immigrés, l’avenir de l’audiovisuel ou le statut du Front national. Bref, elle est traversée, cette opposition, par un certain nombre d’affrontements dont elle ne fait, du reste, pas mystère mais dont l’issue est incertaine. Et toute la tâche des clercs, fûssent-ils de gauche et à la gauche ralliés, doit être d’œuvrer aussi, avec les moyens qui sont les leurs, à l’arbitrage de ces conflits. Cela ne fait pas l’affaire, c’est sûr, des apparatchiks socialistes pour qui les problèmes de la droite doivent rester les problèmes de la droite — sans que les intellectuels de l’autre bord aident à leur solution. Cela ne fait pas l’affaire, c’est sûr non plus, des apparatchiks d’opposition pour qui les intellectuels auraient avantage à balayer devant leur porte — sans venir semer le trouble à l’intérieur des rangs adverses. Mais cela fait celle, en revanche, de tous les hommes et les femmes libres pour qui le premier parti de France ne devrait être ni le P.S. ni le R.P.R. — mais le parti de l’intelligence, de la démocratie, de la culture. Et c’est ainsi, par exemple, que je tiens pour une vraie victoire de ce « Manifeste du 17 mars » d’avoir permis à un certain nombre de gaullistes de dire qu’ils préféraient Daniel Buren au faux Louis XVI, la vraie modernité au poujadisme environnant — je considère comme une vraie victoire, non pas de Globe mais de l’esprit public, d’avoir vu ces gaullistes se démarquer de leurs appareils en tirant soudain des limbes, pour s’en réclamer et s’y draper, cette grande tradition culturelle pompidolienne que nui, apparemment, ne semblait se soucier de commémorer. Ce type de victoire me semble, sur le fond, aussi important et riche de promesses que la victoire politique qui sortira, ou ne sortira pas, des urnes de dimanche soir.
Peut-être certains s’étonneront-ils de me voir tenir pareil langage à la veille d’une échéance où il s’agira justement, disent-ils, de formuler des choix clairs, nets, sans bavures. Et je les entends déjà, éternels adjudants, gronder que cela fait beaucoup de réserves, de prudences, de pudeurs et de circonlocutions quand la gravité de l’heure exigerait plutôt, des hommes de mon espèce, élan et enthousiasme… Eh bien, oui. Mettons que l’« élan », décidément, ne soit pas trop mon fort. Mettons que l’« exaltation » ne figure plus que marginalement au catalogue des valeurs politiques dont j’aime à me servir. Et mettons que cet « enthousiasme » dont j’instruisais, le mois dernier, le procès en littérature, ne me paraisse nulle part plus pernicieux qu’ici, dans ces affaires de vote et de gouvernement. Un choix clair, vraiment ? Sans bavure ni ambiguïté ? C’est toujours « à son détriment », disait je crois Bernis, qu’on « sort de l’ambiguïté ». Ce qui, traduit en politique, implique qu’ils sont toujours, les « choix clairs », signes de trouble et de malheur ; et que c’est le luxe des époques heureuses au contraire, le privilège des démocraties, que de faire droit, dans la Cité, à la part la plus incertaine de nous-mêmes. Puissions-nous, le 17 mars, persévérer dans l’indécision !
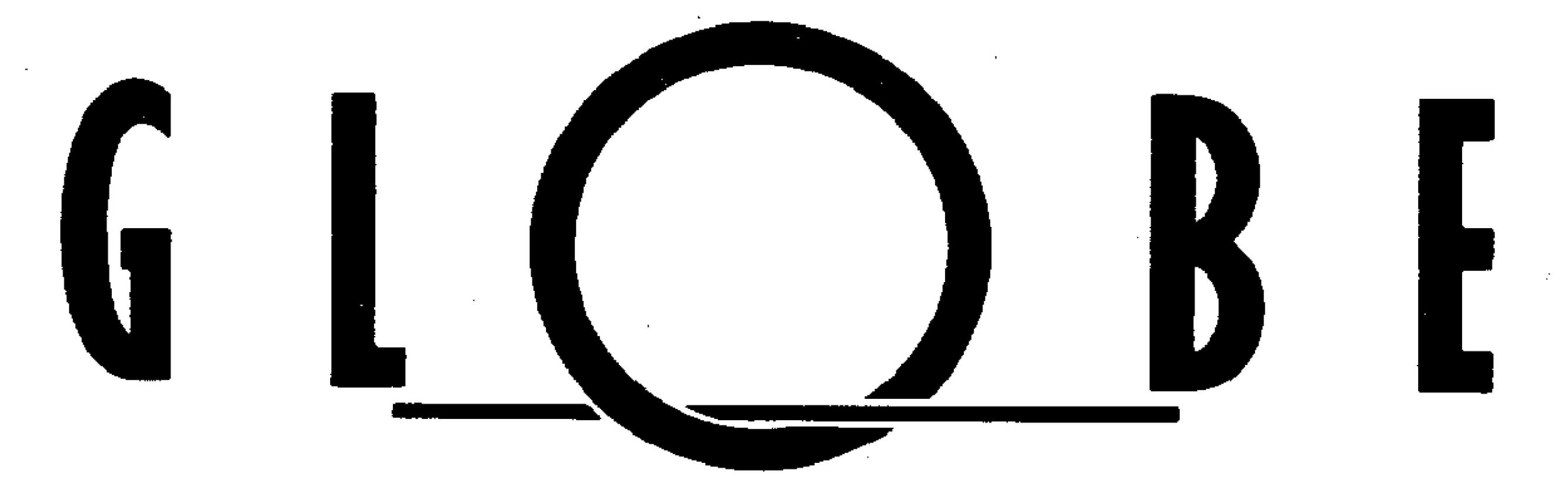
Réseaux sociaux officiels