Élie Wiesel, prix Nobel. Cela faisait un certain temps que, chaque année, à la même époque, ses amis se demandaient laquelle des deux académies — la Paix ? la Littérature ? — finirait par le couronner. Et il s’en trouvera sûrement certains pour, aujourd’hui encore, une fois passées la surprise, l’émotion et, bien entendu, la joie, regretter que cet écrivain n’ait pas reçu, après tout, la consécration d’écrivain qu’il méritait. Personnellement, ce n’est pas mon cas. Et je suis de ceux qui, au contraire, ne sont pas loin de croire que ce prix de la Paix sera d’un poids symbolique encore plus considérable. C’est la première fois en effet qu’un écrivain se voit, en tant qu’écrivain justement, auréolé de cette distinction. C’est la première fois qu’un homme de mots, parce qu’il est un homme de mots, se voit reconnaître le mérite d’avoir contribué à la lutte contre la guerre. Et c’est la première fois, surtout, qu’une académie Nobel nous dit — car c’est le sens profond de son vote — que la mémoire est, en soi, l’une des plus formidables armes dont nous disposions face à l’horreur. J’ajoute qu’un prix de littérature n’aurait couronné « que » l’œuvre. Alors qu’un prix de la Paix, au-delà de l’œuvre, consacre l’homme ; au-delà de l’homme, le combat auquel il s’est voué ; au-delà même de ce combat, les principes, les valeurs, bref la tradition qui l’a fondé et à laquelle Wiesel, depuis qu’il agit et écrit, reste irrémissiblement fidèle. Je dédie ce prix, a-t-il annoncé, à tous ceux qui, comme moi, ont réchappé des camps de concentration nazis. Il aurait pu dire aussi bien : je le dédie à tous ceux qui, avant moi, ont illustré cette haute tradition humaniste et cosmopolite, qui est l’honneur de mon peuple et dont je me veux l’héritier. Prix Nobel du Verbe. Prix Nobel de la Mémoire. Mais aussi — et c’est peut-être l’essentiel — prix Nobel au Judaïsme.
Publication dans L’Espresso de Rome des carnets intimes — et secrets — du philosophe, mathématicien et logicien autrichien Ludwig Wittgenstein. L’auteur du Tractatus logico-philosophicus n’était pas précisément du genre à souhaiter que fussent rendus publics des carnets de cette nature. Et il y a quelque chose de terriblement choquant à voir ainsi étalées, au mépris de la volonté de l’auteur, ces menues méditations sur l’amour, la mort, la mère, la non-existence de Dieu ou la masturbation. Les responsables de l’opération plaident, j’imagine, l’érudition. Le souci de la vérité. Ils plaident, ou plaideront, la nécessité de faire toute la lumière sur l’un des êtres les plus énigmatiques de notre scène intellectuelle. Et je les entends d’ici clamer que le plus austère des philosophes avait une vie lui aussi, des affects, des faiblesses — dont le dévoilement ne peut qu’aider à l’indispensable démystification des mystères de la pensée. Au risque de choquer je crois, moi, que cette démarche est sotte ; absurde ; contraire à tout ce que nous savons du travail philosophique ; je crois que l’idée même de vouloir rendre un philosophe plus « proche », plus « humain », sinon plus « familier » est une des idées les plus ineptes qui soient ; et je suis convaincu, pour tout dire, qu’une telle démarche, loin de dissiper les ombres qui obscurcissent une théorie, loin de contribuer à je ne sais quelle intelligence de la vérité d’un texte, ne fait que le rendre, ce texte, plus opaque et inintelligible encore. Il y a des philosophes qui n’ont pas d’histoire. Pas de biographie. Il y a des philosophes dont l’œuvre n’a d’autre objet que de réduire, de faire taire le murmure même de l’existence. Ludwig Wittgenstein est de ceux-là. Et si ce numéro de L’Espresso me scandalise c’est qu’au-delà des problèmes de « droit moral », au-delà de la « vie privée » dont il profane étourdiment le secret, au-delà de l’homme et de l’outrage qui lui est fait, il est symptomatique d’un véritable outrage à la pensée.
Je n’ai rien contre Roland Dumas. Et ses adversaires politiques seraient mal venus, c’est évident, de jouer les offusqués après son élection surprise à la très convoitée présidence de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée. Reste que l’élection a eu lieu. Qu’un ancien ministre socialiste, réputé proche de François Mitterrand, a triomphé grâce à l’apport des voix du Front national. Et reste que cet homme, loin, comme aurait fait un Mendès France, de trouver problématique de devoir sa bonne fortune à une alliance contre nature avec des politiciens totalitaires, semble n’y trouver rien à redire. Certains parleront d’un retour des combinaisons de la République d’antan. J’y vois surtout, moi, un pas de plus — mais décisif — sur le chemin de cette banalisation de l’extrême droite dont je ne cesse, depuis des mois, de dénoncer le danger. Hier c’étaient les caciques de la droite qui négociaient leurs strapontins régionaux avec les représentants de Le Pen. Aujourd’hui c’est un cacique de la gauche qui trouve tout naturel de voir les mêmes représentants de Le Pen voler au secours d’un combat qui, sans eux, était perdu. A quand des élections législatives ou, pourquoi pas ? présidentielles où, de gauche à droite, et de droite à gauche, il reviendra aux imbéciles et aux fascistes de définir les règles du jeu, puis d’arbitrer son déroulement ?
Je n’aime pas les villages. J’aime encore moins la campagne. Et, au contact de ce qu’il est convenu d’appeler la « Nature », j’ai toujours ressenti (je parle pour mon compte, bien sûr ; pas pour celui des gens qui ont choisi d’y demeurer) je ne sais quelle torpeur, lourdeur — je ne sais quel affaissement de l’âme et de l’esprit dont le moins que l’on puisse dire est qu’il ne favorise guère l’étude ni la réflexion. Saint-Paul, pourtant, ce n’est pas la campagne. Ce n’est pas un village. Ça n’a plus grand chose à voir avec ce bucolisme épais qui, partout ailleurs, me met mal à l’aise. Et de me retrouver ici, au plein d’un automne si glorieux, me met dans un état d’euphorie que je n’avais pas connu depuis longtemps. Charme de la Colombe d’Or. Fraîcheur des ruelles enfin désertes. Cette lumière tendre, fragile, qui décline ostensiblement sitôt midi sonné. Le petit cimetière, à l’extrême bout des remparts, avec ses fleurs, ses herbes folles, ses buissons de ronces ou ses tombes. Et puis en contre-bas, au pied du chemin de ronde qui ceinture le bourg, ce paysage épierré, désolé, quasi lunaire parfois, qui descend jusque dans la vallée et ne fait qu’ajouter à l’artificialité du lieu. Méditation. Travail. Lectures surtout. A commencer par tous ces livres en souffrance que je prends enfin le temps de lire — sans but, gratuitement. Hemingway. L’arrêt de mort de Blanchot. L’Art abstrait de Dora Vallier. Normance. La Correspondance de Cézanne. Une grande biographie de Fitzgerald. L’Histoire des Girondins de Lamartine. La Figure de Fraser de Jacques Attali. Royaume farfelu. Le Testament de Gombrowicz. Et puis, dix fois lu, mais relu d’une traite, en une nuit, ce merveilleux Belle du Seigneur dont le Figaro littéraire de Rouart m’a demandé le compte rendu et où je retrouve — écho à ce que j’écrivais l’autre soir sur Wittgenstein — le miracle d’une œuvre finie, presque figée, dont on a le sentiment que rien, aucun remords, aucune correction, aucune espèce d’émoi ou d’incident extérieurs au texte, n’entameront plus la cohérence. Livre sans tremblé. Œuvre sans rature. Littérature pure, qui met son point d’honneur à ne plus souffrir la moindre « incertitude ». Albert Cohen a effacé ses traces. Il a gommé tout ce qui, d’une manière ou d’une autre, pouvait rattacher son livre à lui ou à sa vie. Première fois, à ma connaissance, que la Pléiade publie un volume amputé, par la force des choses, de ses sacro-saintes « notes et variantes ».
Si une idée vous semble fausse, un débat mal venu, un concept mal formé ou inexactement articulé, il ne faut plus polémiquer. Ne plus opposer de contre concept. Ne surtout pas essayer de poser autrement le problème. Non. La meilleure méthode, la plus sûre, celle qui paraît avoir, en tout cas, la préférence des petits maîtres d’aujourd’hui est d’esquiver toute discussion en accolant à l’idée, au débat, au concept malformé, etc., la simple et infâmante étiquette de « parisianisme ». Ainsi de l’affaire éthiopienne. Un intellectuel fait-il, dans l’Evénement, le récit de ce qu’il a vu entre Harrar et l’Érythrée ? Un autre — Gilles Hertzog —, instruit-il le procès des déportations sans précédent qu’opère le régime de Mengistu ? D’autres encore — Glucksmann et Wolton — publient-ils un livre lumineux, accablant pour ce régime et qui contraindrait, si on le lisait, à réévaluer de fond en comble nos idéologies « humanitaires » ? Peu importe la réévaluation. Peu importent les centaines de milliers de cadavres qui en sont l’enjeu. Au diable, même, les millions d’hommes et de femmes dont le destin est un peu entre nos mains. Les tenants du statu quo, en fait, se gardent bien de répondre, objecter ou argumenter — et préfèrent bredouiller ce monotone : « parisianisme ! parisianisme ! » qui semble devoir, à leurs yeux, clore toute espèce de discussion. Imaginons en 1938 la querelle Gide-Barbusse sur les camps de concentration staliniens, qualifiée de « parisianiste » ; le duel Malraux-Drieu sur le fascisme et l’antifascisme, disqualifié pour le même motif ; imaginons, dans les années cinquante, à l’heure de la guerre d’Algérie et des porteurs de valises du F.L.N., toutes les brûlantes questions qui agitent alors les clercs rayées du même trait de plume. Cet anti-parisianisme, quand on y regarde d’un peu près, n’est probablement pas sans rapport avec le vieil anti-intellectualisme. Même bêtise. Même langue de bois. Et puis, en arrière-fond, mêmes relents d’infâmie.
« Ce n’est pas l’art qui doit imiter la nature, c’est la nature qui imite l’art. » Cette phrase d’Oscar Wilde que je cite depuis vingt ans sans bien savoir d’où elle provient, la voici enfin, littérale, dans ce Déclin du mensonge que les éditions Complexe ont la bonne idée de rééditer. Antiréalisme, là, pour le coup. Antinaturalisme. Horreur de cette « adoration du fait » qui perd la littérature. Et conviction, surtout, qu’il n’y a pas de grande culture sans un recours constant, raisonné, méthodique, aux puissances du Faux. Oui, relire Oscar Wilde, le meilleur antidote à cette autre imbécillité qui affecte parfois l’art moderne.
J’ignore, à l’heure où j’écris ces lignes, ce que valent les informations qui nous arrivent sur les cent un Maliens arrêtés, enchaînés, puis embarqués de force à destination de Bamako. Mais si elles s’avéraient exactes, cela constituerait, bien sûr, un incroyable précédent dans l’histoire de la Ve République ; et la police de M. Pasqua aurait franchi une étape de plus — et quelle étape ! — dans l’escalade de la violence contre nos populations immigrées. Image des galériens d’antan. Image de ces troupeaux d’hommes, transportés à fond de cale dans les vaisseaux de l’âge colonial. Pour ma part, en tout cas, je ne suis pas allé, à Addis-Abeba, dénoncer les Antonov chargés de bétail humain pour accepter ici, à Paris, l’idée de ce Mercure bourré jusqu’à la gueule d’étrangers indésirés. Suite, donc, au mois prochain.
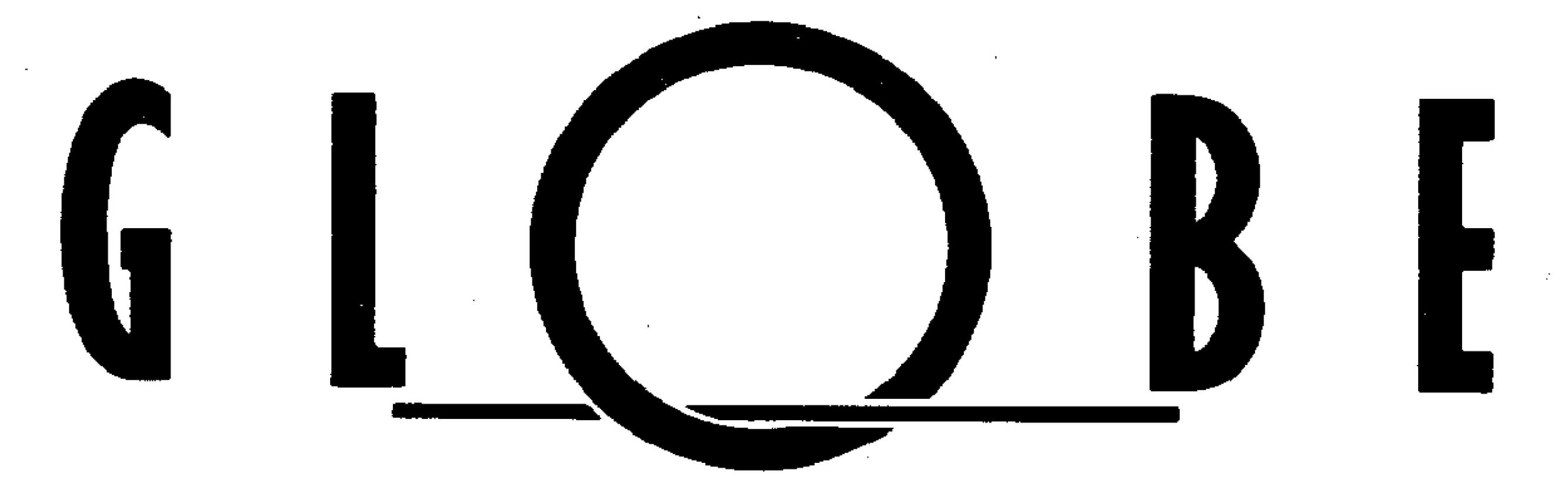
Réseaux sociaux officiels