Eh bien voilà. C’est reparti. Et j’ai envie de dire des terroristes ce que je disais l’année dernière, à peu près à la même époque, des fascistes du Front national. A savoir que leur première victoire c’est qu’on en parle ; qu’on ne parle que de cela ; qu’ils occupent toute la surface imprimée de nos journaux, de nos magazines ; et que moi-même — alors que j’avais tant de choses à dire, tant de sujets à traiter, alors qu’il y avait le Mélo de Resnais, Belle du Seigneur dans la Pléiade, des tas de romans de qualité, mon propre voyage en Éthiopie, le livre de mon ami Rufin, alors que l’actualité, la vraie, celle de la culture et de l’esprit, était si riche en thèmes qui n’auraient pas déparé cette seconde rentrée de Globe — j’en sois, comme tout le monde, réduit à ne penser qu’à ça. Konopnicki, l’autre jour, à déjeuner, aura, comme souvent, eu le mot juste : le premier résultat des bombes, c’est la baisse de fréquentation des salles de cinéma ; et leur première victime — après, bien entendu, les morts et les blessés — c’est Le Rayon vert d’Eric Rohmer, éclipsé par les explosions. Le terrorisme contre la civilisation.
Est-ce que cela veut dire qu’il faille, face au terrorisme, adopter une attitude de réserve, voire de silence ou de censure ? Et suis-je en train de donner raison à ceux qui, de-ci de-là, trouvent par exemple que la télé, en épelant trois fois par jour, telle une litanie, le nom de nos otages au Liban, fait le jeu des poseurs de bombe ? La question peut se poser, sans doute. Elle s’est même très concrètement posée, il y a quelques années, en Italie, à l’époque où, de plus en plus clairement, il apparaissait que les Brigades rouges vivaient pour, par, et à travers les grands médias. C’était le temps où l’on voyait des organisations revendiquer des meurtres imaginaires ; s’attribuer des actions dont le « mérite » revenait à d’autres : séquestrer un journaliste, enlever un enfant, en échange non plus de quelques milliards de lires, mais de quelques minutes d’antenne ; c’était le temps où on les devinait engagés dans un invraisemblable combat dont l’enjeu n’était rien moins que le contrôle de cette richesse neuve, décisive, stratégique : l’espace médiatique ; et c’était le temps où les journaux de leur côté, mettant au- dessus de tout la sacro-sainte chasse au scoop, se battaient comme des chiens pour avoir le privilège de publier le fameux « communiqué numéro 10 » par lequel les ravisseurs d’Aldo Moro adressaient un message codé à leur « colonne romaine »… La France, cela dit, n’en est pas là. Elle est loin d’en être là. Et arguer de cette dérive possible, mais lointaine, pour demander à nos journaux de se plier à je ne sais quel devoir de réserve ou de silence, serait une autre façon, peut-être plus insidieuse encore, d’entrer dans la logique des poseurs de bombe. Quel triomphe, en effet, pour des gens qui n’ont d’autre objectif, au fond, que de contraindre les démocraties à renoncer à leurs principes ! Oui, quel triomphe ce serait, quelle sinistre victoire, si nous nous obligions à museler notre presse, à censurer nos couvertures de magazine ou à ne plus évoquer qu’entre les lignes, comme dans un vulgaire pays totalitaire, les informations vraiment brûlantes qui concernent tout un chacun !
Bon. Que dire alors ? Que dire qui, cent fois, n’ait été dit — et qui permette de voir un peu clair dans l’atroce imbroglio où nous nous trouvons pris ? Eh bien ceci, par exemple, qui, peut-être, surprendra, mais qu’il faudrait prendre à la lettre : le terrorisme n’existe pas. Comment cela, le terrorisme n’existe pas ? Eh bien non : le terrorisme, en France, n’existe pas ; il n’a ni l’autonomie ni la spécificité qu’on croit ; il n’y a pas, si l’on préfère, d’authentique « mouvance » terroriste dans ce pays avec tout ce que cela peut supposer de réseaux, de structures, d’infrastructures ou de complicités ; il n’y a rien, si l’on préfère encore, qui ressemble à ces usines et universités italiennes des seventies, à demi gagnées à la terreur et où — je puis en témoigner ! — il fallait aller plaider, débattre, démontrer : combien de soirées, combien de journées, combien de meetings passés à expliquer à des assemblées d’« autonomes » que les terroristes n’étaient pas des « camarades » mais des « fascistes »… Rien de tel, donc, en France. Rien — ou presque — de ces indulgences. Rien de cette microsociologie qui fait qu’un terrorisme est vraiment un terrorisme et qu’il est, dans une société, comme un poisson dans l’eau. En sorte que ce qui existe, ce qui nous menace vraiment, le vrai nom qu’il faut donner à l’horreur parisienne des dernières semaines, c’est, beaucoup plus simplement, la guerre. Il y a la guerre conventionnelle. Il y a la guerre d’usure. Il y a la guerre nucléaire. Il y a la guerre bactériologique. Bref, il y a mille sortes de guerres — avec, aujourd’hui, et même si ce n’est pas complètement une nouveauté, cette autre forme de guerre qu’est la guerre par les bombes. Que la France tarde à le reconnaître, qu’elle hésite à en tirer les conséquences, qu’elle ne sache pas trop bien, surtout, quelle stratégie adopter pour y faire face et qu’elle soit bien mal armée, la pauvre, avec ses services secrets discrédités et son service action ridiculisé, pour y riposter comme il convient, ne prouve hélas rien contre cette guerre, mais beaucoup de choses contre cette France. Ceci, notamment, que la France, comme d’habitude, est en retard d’une guerre.
Fort bien, dira-t-on. Mais est-ce que chacun ne s’accorde pas là-dessus, justement ? Est-ce qu’ils n’ont pas tous dit, de la droite à la gauche et de la gauche à la droite, que nous étions en guerre, qu’il fallait entrer en résistance, etc., etc. ? Oui, sans doute. Sauf que, lorsqu’il s’est agi de passer aux actes et de prendre des mesures concrètes, ils ont tous apparemment trouvé normal qu’on arrête quelques arabes ; qu’on en expulse quelques autres ; qu’on tabasse un ou deux « suspects » dans les commissariats parisiens ; bref, qu’on la mène, cette guerre, avec des méthodes de petite police aussi ridicules que choquantes. Que M. Pasqua me pardonne. Mais si j’étais lui, j’éviterais de me passer les nerfs sur les restaurateurs libanais ou les immigrés marocains. Et je rappellerais en revanche à l’ordre mon collègue des Relations extérieures qui, l’autre semaine, à la veille des attentats, pérorait encore que « non, voyons — un chef d’orchestre clandestin ? Une coordination des terroristes ? Vous n’y pensez pas… l’hypothèse est ridicule… ». A la guerre comme à la guerre, messieurs les ministres ! Si vous y croyez vraiment, à cette guerre, si vous pensez vraiment que c’est dans ces termes-là qu’il faut poser le problème, alors, de grâce, soyez cohérents ; intéressez-vous par exemple de plus près aux cas de MM. Kadhafi, Khomeiny ou Hafez El Assad ; demandez-vous comment il se fait qu’au sommet des non-alignés d’Harrar ils étaient les seuls chefs d’Etat à avoir refusé de se rallier à la motion antiterroriste ; et évitons, du coup, de nous égarer sur de fausses pistes, sur des combats douteux — évitons, en d’autres termes, tout ce qui pourrait donner à penser qu’il y a entre les bombes et la communauté immigrée une identité ou une symbiose.
Importante, cette idée de ne pas tout mélanger et de ne pas traiter comme un problème de police ce qui ressortit donc (nous en sommes tous d’accord) à la géopolitique ou à la guerre. Car enfin, que croit-on qui se passe quand on laisse jouer la confusion ? quand on laisse fonctionner les amalgames ? quand on donne à penser — cela a été dit — que « la communauté chiite » tout entière serait impliquée dans les attentats ? Les choses étant ce qu’elles sont, et la xénophobie ambiante étant ce que nous savons, cela donne forcément à penser que, de proche en proche, c’est la communauté musulmane, puis arabe, puis étrangère qui se trouve plus ou moins compromise ; cela fait peser une suspicion terrible et qui ne demandera, le jour venu, qu’à prendre une forme plus explosive, sur toute une part, non négligeable, de la communauté nationale ; et le résultat c’est qu’en dressant ainsi les gens les uns contre les autres, en creusant entre eux de tels fossés de méfiance et de culpabilité a priori, on prend un risque qui, avec le temps, pourrait se révéler plus grave encore que celui du terrorisme : le risque de la guerre civile. La France a connu cela à une époque récente de son histoire. Elle a connu ces heures où l’on passe peu à peu, presque insensiblement, des mesures à l’État d’exception. Puissions-nous ne jamais revoir cela ! Puissions-nous ne jamais revoir ces temps de grand malheur où, sur fond de bombes et de ratonnades, Paris était au bord du déchirement ! C’était le vœu de mes amis de S.O.S. Racisme quand, au plus haut de la vague d’attentats, ils ont lancé leur double appel — à la plus extrême fermeté dans la conduite de la guerre antiterroriste d’une part, et à la plus extrême vigilance dans le maniement des thèmes, des fantasmes sécuritaires d’autre part. N’en déplaise aux fanatiques de l’union sacrée à tous crins et à tout prix, c’est leur honneur d’avoir, du coup, résisté une fois de plus aux forces de haine et de guerre.
L’union sacrée… Il ne faudrait pas beaucoup me pousser pour me faire avouer qu’elle ne me dit rien qui vaille elle non plus — et qu’il y a même quelque chose qui me trouble dans ces appels partout répétés, dans la classe politique mais aussi dans la presse, à ne parler plus que d’une seule voix dès lors que le terrorisme nous menace. Que nous soyons tous derrière Jacques Chirac dans la lutte qu’il entend mener, me semble aller en effet de soi ; et je serais le dernier à le chicaner sur les mesures d’urgence qu’il croit ou croira bon de nous proposer. Mais que cette solidarité minimale, j’allais presque dire technique, devienne prétexte à une extinction de tout débat, à une interruption de toute réflexion, qu’elle soit l’occasion d’une sorte de stérilisation des idées ou de mise en veilleuse des intelligences, cela ne me paraît, en revanche, ni justifié ni souhaitable. Devons-nous tous avoir la même lecture du phénomène ? Sommes-nous tenus à la même doctrine sur sa genèse, ses développements ? Devrions-nous nous accorder sur les moyens de traiter les problèmes du Proche-Orient ? Ici même, en France, toute forme de réserve ou d’objection à l’endroit d’un gouvernement dont la politique ne se résout pas, que l’on sache, à la guerre contre les bombes, serait-elle devenue sacrilège ? Et puis — pour dire le fond de ma pensée — l’union sacrée dont on nous bassine implique-t-elle que nous avalions sans protester ce qui devrait rester à mes yeux (après les attentats, bien sûr) l’événement majeur, quoique étrangement peu commenté, de ces derniers jours : à savoir la réception de Jean-Marie Le Pen à l’hôtel Matignon, au même titre que n’importe quel chef de parti ?
Encore six mois de terrorisme — avec, dans l’opinion, six mois de ce régime — et, pour la première fois dans l’Histoire, la France n’aurait plus d’opposition ; donc plus de libre débat ; donc plus de démocratie.
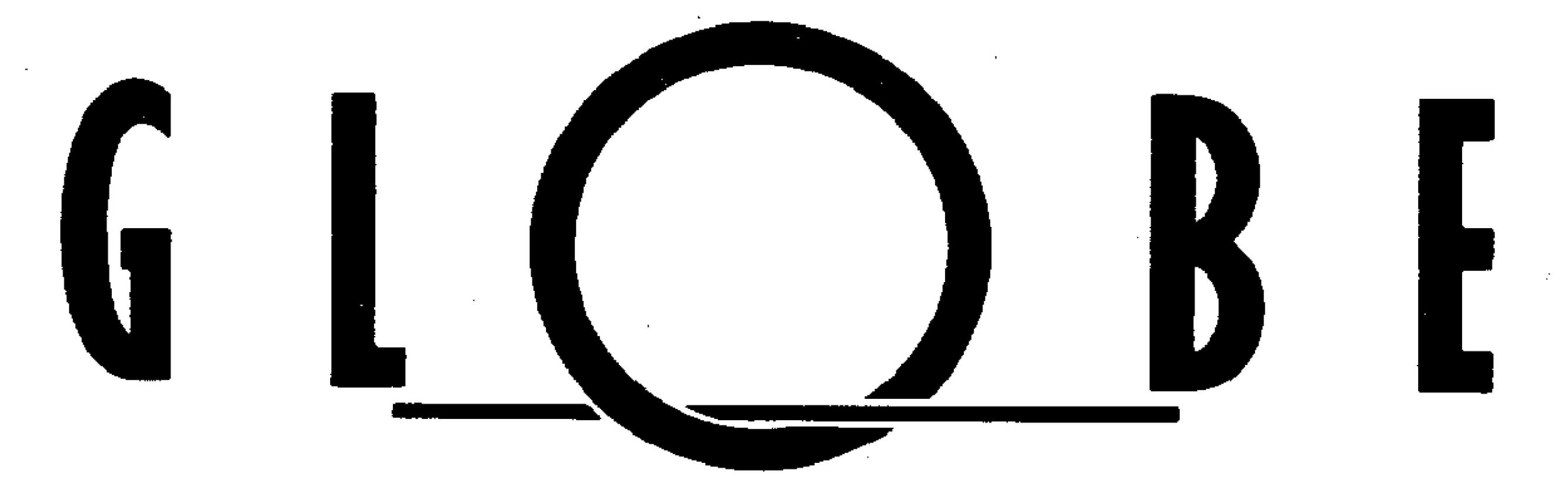
Réseaux sociaux officiels