2 octobre
Conversation avec Georges-Marc Benamou qui me convainc — sans trop de mal ! — d’inaugurer dans son journal une sorte de bloc-notes qui devrait ressembler, selon lui, au « Talk of the town » du New Yorker. De la politique, autrement dit… Mais aussi de l’esthétique… Des impressions au jour le jour… Des réflexions sur des lieux, objets, livres ou spectacles de rencontre… Bref une déambulation, flâneuse et grave à la fois, au travers d’un « paysage moderne » dont l’exploration sera — c’est toujours Benamou qui parle — le souci le plus insistant de Globe… L’idée m’amuse, bien sûr. Elle flatte ce qu’il y a en moi de goût pour la variation, la fugue ou l’éclectisme. Et elle tombe on ne peut mieux, à un moment où je me soucie de plus en plus, moi, de ce lien discret, secret parfois, mais tenace, qui noue les uns aux autres nos choix idéologiques et puis les formes, les lignes, les couleurs et les choses où nous nous reconnaissons le plus volontiers…
Baudelaire, comme d’habitude, avait tout dit là-dessus. Il avait, une fois de plus, tout compris. Et le mieux, pour me faire entendre, est peut-être de rappeler ce texte, lu il y a longtemps, où il expliquait en substance — je cite de mémoire — que c’est pour la même raison de fond qu’il aimait Delacroix, haïssait le progressisme, se défiait d’Ancelle ou de George Sand et désirait Jeanne Duval.
4 octobre
Lu dans L’Express de ce matin une notule où l’on s’étonne de la « complaisance » avec laquelle (sic) j’aurais préfacé les Carnets de prison de Toni Negri, ce « mauvais maître » italien accusé, dans son pays, d’être l’inspirateur d’un brigadisme que l’on voyait, hier encore, faire de la bombe et du P 38 ses arguments ultimes. Sur quel ton faut-il donc dire les choses ? Et faudra-t-il bientôt les crier pour être certain d’être entendu ? J’ai clairement dit en effet, dans la préface incriminée, ce qui me séparait de l’homme. J’ai non moins clairement expliqué qu’il n’y avait pas un thème, une analyse, un parti-pris qui, dans son livre, nous fussent véritablement communs. Et je suis même allé jusqu’à rappeler — craignant les interprétations perverses — que l’auteur faisait indubitablement partie de cette catégorie d’intellectuels où j’ai toujours reconnu mes adversaires irréductibles. Restait le symptôme, cependant. Restait le témoignage. Restait ce visage qui, disais-je, s’obstine à nous regarder avec l’inquiétante étrangeté des miroirs. Et reste le cas d’un homme qui, dans mes dispositifs imaginaires, ne pouvait pas ne pas prendre place aux côtés de tous ces êtres noirs, marqués et comme élus à rebours dont j’ai tendance à croire que leur affinité avec le Mal en fait des figures limites et paradoxalement exemplaires. Toni Negri, en d’autres termes, est un enfant du siècle. C’est un raté, un hoquet, un lapsus de son époque. Et s’il m’intéresse tant, s’il me passionne et si j’ai pris le risque, donc, de cette préface, ce n’est pas par complaisance, mais par souci de connaissance ; c’est, si l’on préfère, parce que nul n’a incarné mieux que lui les tentations de cette génération étrange, aux destinées imprévisibles et dont je n’ai peut-être rien fait d’autre, depuis dix ans, de livre en livre, que d’essayer de reconstituer l’histoire.
16 octobre
Complaisance pour complaisance, on devrait s’intéresser un peu plus, il me semble, à celle dont a bénéficié hier soir, sur Antenne 2, un certain Jean-Marie Le Pen. Que les règles de la démocratie obligent à donner son temps d’antenne à un homme de cette espèce, je veux bien à la rigueur l’admettre. Mais fallait-il cette faiblesse ? Fallait-il cette déférence ? Fallait-il traiter de manière aussi convenue, convenable et, donc, respectable et respectueuse, un homme dont chacun sait qu’il est un authentique fasciste, doublé probablement d’un assassin ?
J’entends, ici et là, que c’est en lui posant des « vraies » questions, en l’interrogeant sur des problèmes « techniques » et « complexes », en le sommant de donner son avis sur les grands sujets canoniques de la grande politique classique, bref en le contraignant à abattre enfin son jeu et à décliner son éventuel programme de société, que l’on finira par le confondre et par dégonfler l’odieuse baudruche. Eh bien je ne crois pas. Je crois même très exactement l’inverse. Et il faut être bien aveugle pour ne pas comprendre que c’est en procédant ainsi, en multipliant ces questions « sérieuses », en faisant semblant de croire qu’il puisse avoir un avis autorisé sur les problèmes « techniques », « complexes », etc. qui sont le lot des chefs de parti traditionnels, il faut être aveugle, oui, pour ne pas comprendre que c’est en le traitant ainsi qu’on lui confère la légitimité dont il a si cruellement besoin.
Une seule attitude juste, face à Le Pen : l’exclure par tous les moyens possibles du cercle de famille de la politique consacrée. Un seul impératif : tracer autour de lui le cordon idéologique et éthique qui, seul, le tiendra hors du jeu. Une seule question, un seul type de question à lui poser : encore, toujours, sans relâche ni rémission, la question de ce racisme dont il est, avant toutes choses, le héraut. Force est de constater que nous étions, hier, loin du compte et que, pour le téléspectateur moyen, un homme qui a son mot à dire sur l’économie, la science, la monnaie, la crise des chantiers navals, la situation des paysans et des commerçants, les rapports Est/Ouest ou la guerre des étoiles est, au sens propre, un homme politique banalisé.
18 octobre
J’insiste sur ce cas Le Pen. Le fond de l’affaire, bien sûr, c’est le tabou qui a sauté. C’est le verrou qui a lâché. C’est cette vieille boue, retenue depuis des années, qui remonte tout à coup, suinte dans les consciences. Et face à ce suintement, face à cette crue et aux risques de délitement de l’ordre démocratique qu’entraîne le phénomène, je crois qu’il ne faut plus craindre d’appeler les choses par leur nom — et d’en appeler, littéralement, à une restauration de l’Interdit.
Misère, à cet égard, de ce « libéralisme » idéologique à tous crins qui nous revient des années soixante. Misère de ce « relativisme », sans règles ni rivages, qui veut que les idées, toutes les idées sans exception, se valent et s’équilibrent. Misère de ces « sondages » dont la télévision, l’autre soir, nous livrait « en direct » les résultats et où se dévoilait, sans fard ni honte aucune, le visage d’une certaine France, arrondie en son infamie. Oui, par le libre jeu du libre débat politique, nous avons appris ce soir-là que la France est un pays où, 30, 40, 50 p. 100, je ne sais plus, de Français peuvent, en toute impunité et liberté, se déclarer « séduits » par une propagande néo-fasciste affichée. Et l’évidence est là, du coup, dont il faudra bien finir par tirer toutes les leçons : notre système médiatique — ainsi que, du reste, notre système et notre classe politiques — ont probablement échoué à endiguer l’effet Le Pen.
21 octobre
Bernard Privat, pour moi, était plus qu’un éditeur. Plus qu’un écrivain. Plus qu’un ami même, un complice ou le délicieux compagnon dépeint, la semaine passée, dans toutes ses nécrologies. Et je ne saurais mieux dire ma peine, je crois, qu’en disant qu’est partie avec lui l’une des très rares personnes qui ont, depuis quinze ans, vraiment pesé sur mon destin. Je ne suis pas seul dans ce cas, sans doute. Et nous étions quelques- uns, j’en jurerais, à ressentir le même désarroi, l’autre jour, à Cliousclat, dans le petit cimetière blanc où nous nous trouvions rassemblés. Ai-je changé ? Vieilli ? Ou est-ce l’ombre de Bernard qui, déjà… ? Pour la première fois, en tout cas, cette idée d’un deuil vécu en commun ne m’a étrangement pas choqué. Et moi qui ai toujours eu si peur, si profondément horreur des rites, des prescriptions et des cérémonies de funérailles, j’ai presque aimé, tout à coup, ce moment de recueillement, ce partage de douleur et de chagrin. A la toute fin, lorsque l’heure est arrivée de passer un par un, pour lui rendre un dernier hommage, devant la tombe ouverte où reposait déjà le corps, je me suis surpris, moi l’impie, le mécréant, à m’arrêter à mon tour, à hésiter un instant — et puis à regretter de ne pouvoir me signer aussi.
23 octobre
New York. Dîner avec Martin Peretz, le directeur de New Republic, qui me presse de lui donner un texte sur le drame de l’Achille Lauro. La conversation, à mesure que les heures passent, s’attarde à des sujets plus frivoles. Et nous en arrivons à parler de ce qui est à ses yeux l’énigme majeure de la vie culturelle française : l’idée, l’existence même d’une « rentrée littéraire ».
« Non, lui dis-je, vous avez tort… L’idée n’est pas si absurde… Elle n’est pas si dérisoire non plus… Et il y a quelque chose d’essentiel dans cette fièvre qui, chaque automne, emporte les éditeurs, les journalistes, les intellectuels parisiens… Brigue, dites- vous ? Intrigue ? Embrouilles même, ou magouilles ? Je ne suis pas loin de penser qu’il y a dans tout cela, dans tous ces codes, ces rituels, ces nœuds d’intérêts croisés et savamment orchestrés, quelque chose qui, ne vous en déplaise, appartient de plein droit à la mythologie littéraire — quelque chose qui, plus exactement, relève de ce pouvoir qu’ont les livres de tracer autour d’eux d’impalpables communautés où les hommes se réassemblent en un ordre différent… Vive, en ce sens, l’esprit de chapelle ! Vive l’esprit de clan ! Vive ce que d’aucuns, à Paris, appellent l’esprit de coterie ! Ces coteries, elles sont l’autre nom de ce que Leiris et Bataille nommaient, avant la guerre, des « sociétés secrètes ». Et à ceux qui me demanderaient où se trouve en cette saison-ci, ma « société secrète » à moi, je répondrais en citant deux ou trois livres. Ils sont l’enjeu, c’est vrai, de mes brigues et intrigues du moment. Mais ce sont ceux, surtout, dont je me sens le plus fondamentalement contemporain. Le roman de Jacques Henric par exemple — ou celui de René Swennen qui saisit comme nul autre la naissance et la nature du sentiment de modernité.
26 octobre
Décidément, ce bloc-notes commence bien mal. Et c’est vrai qu’au lieu de ces fantaisies, impressions et subtiles variations dont j’aurais aimé l’émailler, il a fâcheusement tendance à tourner à la monomanie. Ce matin, en effet, c’est le Figaro Magazine qui monte au créneau. C’est lui qui, fort d’une prétendue « enquête » qui frise la désinformation, nous offre le plus ahurissant dossier sur l’immigration qu’ait jamais publié à ce jour un organe de presse libéral. Et je vois mal comment ne pas réagir à nouveau devant cet étalage de fantasmes, de mensonges ou de délires. Le plus grave, d’ailleurs, ce n’est même pas l’article. Ce n’est même pas le ton. Ce n’est pas non plus le fait que l’on ait requis en l’occurrence un demi-solde des lettres, promu « spécialiste en humanité et en sciences démographiques ». Non, le plus grave c’est la façon dont la presse, dans son ensemble, réagit à l’événement. C’est l’extraordinaire docilité avec laquelle elle accepte les termes du problème que pose ce numéro du magazine. Et c’est le fait qu’il n’y ait, à l’exception de Libération, pas un commentateur pour refuser de réfléchir en termes de quotas, de taux d’entrée ou de retour, de seuils de tolérance ou au contraire d’explosion. Imaginons, dans les années 30, une presse antifasciste s’interrogeant sur le « taux de fécondité » des femmes juives d’Europe de l’Est… Imaginons-la en train d’expliquer que non, il n’y a pas le feu, ces redoutables pondeuses étrangères finiront par se calmer… Imaginons des discussions byzantines où l’on n’aurait le choix qu’entre la position de ceux qui verraient déjà la culture, la religion, les rites juifs triompher — et celle des « humanistes » pour qui la douce France saura bien acclimater les monstres, apprivoiser la menace… C’est à peu près, toutes proportions gardées, ce qui se passe aujourd’hui dans la plupart des tribunes où l’on débat de l’immigration et du racisme. Et il est difficile, après cela, de ne pas se dire que, dans l’ordre du discours au moins, le fascisme est d’ores et déjà passé.
29 octobre
Paris tout gris, soudain. Paris très froid, presque lugubre. Et, dans ce square du XIIIe arrondissement où je passe par hasard, cette haute sculpture d’acier rouillé que j’avais vue déjà, l’an dernier, dans les jardins des Tuileries. Elle s’appelle Clara Clara. L’auteur s’appelle Richard Serra. Et grâces soient rendues à ceux par qui ce monument de l’art américain moderne a pu rester ici. Ça n’a l’air de rien, une sculpture. Ça ne change rien, apparemment, à ce climat de régression dans lequel nous nous complaisons. A mes yeux, pourtant, c’est décisif — et c’est avec des riens de ce style que je compte passer l’hiver qui s’annonce.
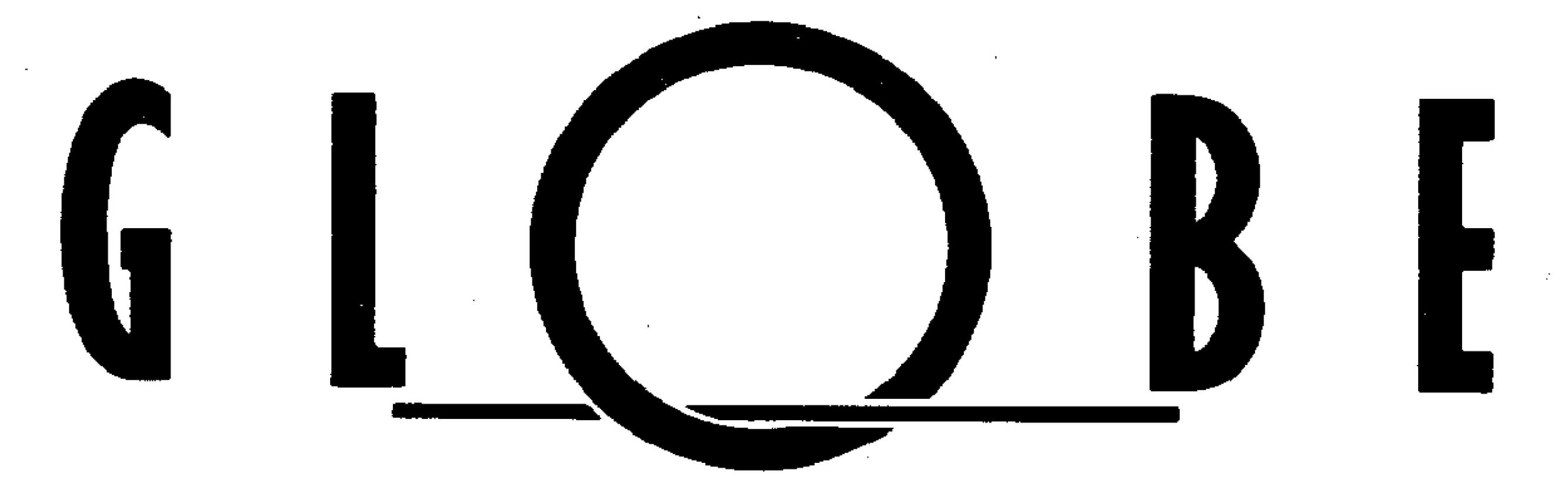
Réseaux sociaux officiels