Propos recueillis par Philippe Tretiack
Tocqueville, aux États-Unis, c’est comme Rushmore. Comme Naissance d’une nation de Griffith. Comme les grands westerns de Ford et de Hawks. Comme le Bill of Rights. C’est, au minimum, un miroir où ce peuple contemple, depuis presque deux siècles, l’image anticipée de ses vertus, de ses vices, des heureuses ou fâcheuses tentations qui le guettent, de sa naissance providentielle, de son destin. Et c’est, dans les Collèges d’Austin et à la télévision, sur les lèvres de George W. Bush et sur celles de ses adversaires, au cœur de l’Amérique cultivée comme au bout de cet Interstate 94 où je trouve un policier qui renonce à me verbaliser quand il apprend que je m’intéresse à l’auteur de De la démocratie en Amérique, son idole – c’est, partout, une référence, un leitmotiv, un lieu commun, un manuel, un bréviaire, un monument de papier et de mots et, au bout du compte, un élément à part entière de ce qui constitue le pays. Tocqueville ? Un mythe fondateur de l’Amérique. La Constitution américaine ? Tocqueville. Pendant que nous en étions, nous, en France, à ruminer notre marxisme (ou notre maurrassisme), les Américains, eux, nous empruntaient Tocqueville, l’adoptaient, en faisaient l’un de leurs mythes d’origine et de fondation. Voilà pour Tocqueville.
Début des années 60. Avoir quinze ans dans cette France qui, pas encore tout à fait réveillée de son cauchemar vichyste, entre dans sa saison gaulliste d’Etat. La liberté, en ce temps-là, a trois visages. Ou trois voix. Celle d’une poignée d’écrivains – au premier rang desquels Hemingway – qui jazzent, comme dit l’autre, la langue française. Des cinéastes – Ford, Hawks – dont on ne se lasse pas de voir et revoir les chefs-d’œuvre dans les cinémas du Quartier latin. Et puis une guitare, celle de Presley, ou d’Eddie Cochrane, ou de Gene Vincent – qui est, en 1964, l’arche perdue de ma première aventure américaine.
Est-ce le trafic qui fait la route ou la route qui fait le trafic, demande, dans le Ulysse de Joyce, Leopold Bloom à Dedalus ? Eh bien, autre version du même paradoxe dont je fais, dans American Vertigo, le principe de la décision de ne voyager que par la route : est-ce l’Amérique qui a fait le western ou le western qui a fait l’Amérique ? lequel, du désert réel de l’Arizona et de celui que filme John Ford dans Rio Grande, a inspiré et modelé l’autre ? est-ce le réel, ou l’art, qui fait le mythe ?
Pourquoi Rushmore à Rushmore ? Je veux dire : pourquoi ici, au cœur de ces Black Hills qui sont, depuis des siècles, des terres sacrées pour les Indiens ? Il y avait tant de lieux possibles… Il y avait, dans les Rocheuses, tant de sites magnifiques où l’on aurait pu sculpter les mêmes visages de granit. Pourquoi, alors, ce choix ? Pourquoi, pour cet hommage à ce qui, à l’époque, était clairement une Amérique blanche, le choix de ce lieu vécu comme une terrible provocation ? C’est la première question. La seconde : ce nom, Rushmore ; ce nom, oui, du mont Rushmore dont je découvre qu’il est celui de Charles E. Rushmore, un avocat qui, en pleine ruée vers l’or, à l’époque où l’on cherchait tous les moyens militaires et légaux d’exproprier les derniers Indiens, sillonnait les Black Hills pour le compte des grandes compagnies et découvre ce sommet innommé. Et puis la troisième enfin, la pire, la plus douloureuse : l’architecte lui-même ; ce fameux Gutzon de la Motte Borglum à qui l’on doit la conception, puis l’essentiel de la construction, des quatre visages de pierre et dont je découvre qu’il fut un membre éminent du Ku Klux Klan et que son premier projet – après quoi il se rabattit là, sur Rushmore – fut, en Géorgie, à la demande du Klan, un mémorial confédéré à la gloire de trois héros sudistes de la guerre de Sécession. Envers et vérité du mythe.
Sur Marilyn, c’est bien simple : un livre à lire, un seul – celui de Joyce Carol Oates. Il y a Mailer et Oates. Il y a les notes éparses de Mailer et le portrait craché (vérité et fiction mêlées) de Blonde de Joyce Carol Oates. La folie de la mère… Les clichés de la célébrité… La femme-enfant projetée, du jour au lendemain, sur les toboggans de la gloire qui exalte et qui tue… Happy birthday Mister President… Comme une pute, oui, traitée comme une pauvre petite pute par les messieurs du Klan Kennedy… Guerre des mythes. Sur l’Olympe américain – qui n’a, pour le coup, plus rien à voir avec Rushmore – la guerre des demi-dieux.
McDonald’s ? Bon. Si vous tenez à McDonald’s. Mais l’autre Amérique, alors. La folle. La mauvaise. La qui fait des corps obèses. La qui explose ses propres limites et qui, du coup, s’étend, prolifère et multiplie, telles de mauvaises cellules, ses inventions les moins heureuses. L’Amérique pleine d’ubris. L’Amérique ivre d’elle-même. La qui, parce qu’elle a perdu le sens de sa propre limite, ne sait plus ni où elle est ni comment se tenir. D’où ces machines à nourrir, toujours les mêmes, à l’infini. D’où ces temples de la malbouffe semés, partout, sur les routes de légende américaines.
Plus personne, aux États-Unis, ne croit à la légende Kennedy. Plus personne n’est dupe de la légende pieuse du grand président exemplaire. Tout le monde, si l’on préfère, a fini par savoir que le jeune héros bronzé, respirant l’optimisme et la santé, était un immense malade, drogué à la testostérone et dont la joie de vivre était un leurre. Or, malgré cela, malgré cette face cachée qui n’est plus cachée pour à peu près personne, il suffit d’une image de lui dans sa gloire, il suffit d’une de ses photos de jeune prince souriant et charmant, American tabloïd, from Washington to the moon, opulence, bonheur, nouvelle frontière, insouciance, il suffit d’une image de Jackie en robe d’Oleg Cassini au temps de leur grand mensonge médiatisé, puis d’une autre, le jour du drame, tailleur rose taché de sang, pour qu’un trouble vous gagne, et gagne surtout les Américains. Alors, qu’est-ce qu’un mensonge qui marche ainsi ? Qu’est-ce qu’une légende à laquelle on ne croit pas et qui, pourtant, fonctionne ? Eh bien voilà. Un mythe. C’est très exactement ce que les spécialistes de l’Histoire ancienne appelle un mythe quand ils demandent, avec une ingénuité feinte, si les Grecs « croyaient ou non à leurs mythes ». Et c’est ce qui fait des Kennedy les frères en destin d’Œdipe, Achille, Thésée, Narcisse ou Prométhée – les Grecs des Américains.
Mailer ? Le patron. Oui, au sens où Paulhan disait de Braque qu’il était le « patron » de la peinture de son époque, Mailer est, non seulement le maître des lettres américaines, non seulement le plus grand de leurs écrivains vivants, mais, à la lettre, le modèle, l’étalon et presque l’inventeur de toute une part de l’Amérique contemporaine. Parfois, je me dis que Gilmore et Marilyn, Oswald et Mohammed Ali, John Kennedy à Hyannis Port, Castro lui-même, n’ont existé que pour que Mailer en fasse des personnages de ses romans. Parfois, en l’écoutant, j’ai eu le sentiment que l’Amérique elle-même – celle, en tout cas, dont j’ai la nostalgie et dont le petit homme de la Maison-Blanche organise la démolition – est comme sortie d’un songe de Norman Mailer.
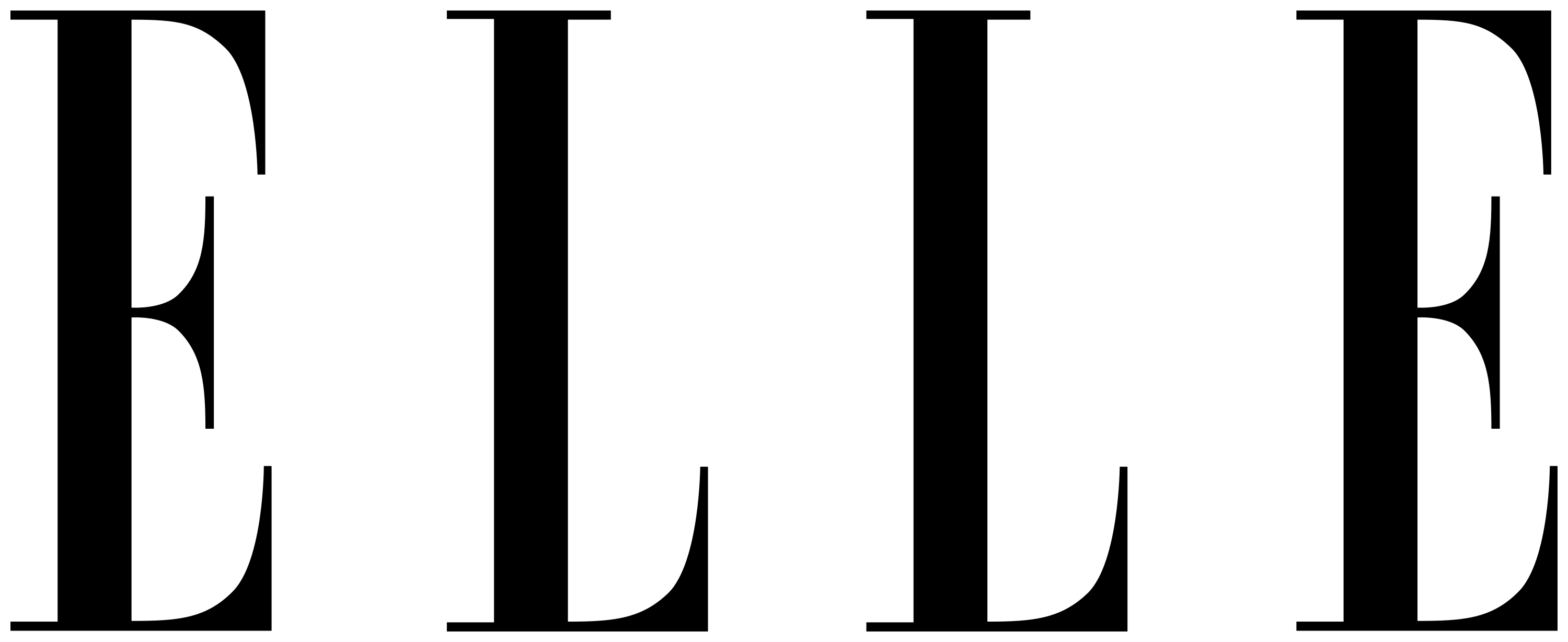
Réseaux sociaux officiels