RÉGIS DEBRAY : Quelle était, en publiant ce livre, en réalisant ce film, ton idée de manœuvre, comme on dit chez les militaires ?
BERNARD-HENRI LÉVY : L’envie de mener une enquête généalogique. Un intellectuel est, me semble- t-il, quelqu’un qui, à certains moments de sa vie, éprouve le besoin de savoir qui il est, d’où il vient, quels sont les lignages contradictoires qui convergent vers lui, etc. Eh bien, ce livre, c’est un peu ça ; c’est une sorte de déclinaison d’identité ; on y trouve, comme il se doit, de grands aînés, des cousins maudits, des bâtards et des affinités inavouables ; bref, une histoire de famille. Le sous-titre du livre est explicite : « une histoire subjective des intellectuels ! »
R.D. : Le subjectif, n’est-ce pas, c’est un peu l’originalité du projet ; une histoire des intellectuels, ça s’est beaucoup vu, une histoire subjective, c’est la première fois que ça s’avoue. L’intérêt du bouquin, c’est sa mise en scène médiatique. Bon, on sait que Bernard est un égocentrique et que, en promenant son miroir tel Stendhal au-dessus de la route des intellectuels, il ne peut pas s’empêcher de se regarder dans la glace. Ça ne me gêne pas dans le principe. Même si au début j’ai été irrité par l’emploi systématique du « moi, je » : « Aron m’a dit que », « je » rencontrais Foucault, Clavel, Althusser, etc. Ce livre en tout cas n’est pas une histoire des intellectuels, c’est l’histoire de Bernard-Henri Lévy dans ses rapports avec les intellectuels ou ceux qu’il appelle tels. C’est une réussite, d’abord d’un point de vue technique, parce que c’est bien rythmé, vivant, parfois émouvant ; et par ailleurs, c’est écrit sur un ton particulier : celui de l’exposition de l’exposant si j’ose dire. Il croise fort bien une tradition universitaire qui est la mienne, car je suis un scolaire, et une tradition égotiste, plus littéraire qui est la sienne.
B.-H.L. : « La tradition égotiste qui est la sienne »… Ça, c’est assez énorme ! Comme si l’égotisme était ma spécialité.
GILLES HERTZOG : Il est vrai que vous vous êtes souvent mis, vous aussi, dans le tableau !
B.-H.L. : Moi, je me souviens d’un livre qui s’appelle Les Masques… C’était une exposition de soi. Fort émouvante d’ailleurs…
R.D. : Pourquoi ne peux-tu énoncer, même une banalité, que sur un ton prophétique, la faisant précéder de « moi, je crois que » ? Pourquoi ne pas énoncer, soit la banalité, soit le paradoxe comme étant un énoncé objectif dont la valeur est indépendante du sujet d’énonciation ? Chez toi, c’est devenu un tic d’écriture et ce qu’il y a d’intéressant, d’ailleurs, c’est que, comme tu l’assumes, on finit par te le pardonner. Le Pouvoir intellectuel en France, c’est un des essais les plus chiants qu’on ait faits depuis vingt ans sur la question, je ne l’ai pas écrit sous la forme d’une confession. Il m’arrive par ailleurs d’écrire des confessions d’un exhibitionnisme douloureux, mais alors elles ne se posent pas comme une histoire de notre temps, ou comme une synthèse de la généalogie de l’intellectuel. Autrement dit, contrairement à Bernard, je ne croise pas les genres. Mais, c’est autant une autocritique qu’une critique, n’est-ce pas ?
B.-H.L. : En effet je croise les genres. Il se trouve que j’ai horreur de l’exposition ou de l’exhibition en littérature. Et il me semble, justement, que cette façon de croiser les genres, de parler de soi en parlant des autres, c’est une façon de limiter l’exhibition au strict minimum. Je vois bien ce que peut donner une stricte séparation des genres : d’un côté les traités de médiologie, de l’autre un livre comme Les Masques — avec, entre les deux, une vraie différence de style et, pour le second, une impudeur extraordinaire. Je suis incapable de cette impudeur. Et c’est pourquoi cette forme « mixte » me convient. Je ne peux me mettre en scène que de manière oblique, indirecte, dans la coulisse.
R.D. : Mais ta forme est cohérente avec tes projets puisque une philosophie de l’individu s’exprime individuellement.
G.H. : Revenons-en, si vous voulez bien, aux thèses énoncées dans le livre…
R.D. : Disons que l’hypothèse de recherche, tu parles de généalogie, me semble juste : l’intellectuel comme médiation… Mais il me semble que tu confonds l’histoire du faubourg Saint-Honoré avec l’histoire de Paris, une vitrine Hermès des grandes vedettes de l’intelligentsia avec une histoire de la société intellectuelle. Tu mentionnes à un moment donné ce que tu appelles les souffleurs, c’est un joli mot. Mais tu as vraiment fait le livre antithèse du Lindenberg, Les Années souterraines. Lui, il est, si j’ose dire, dans les canalisations. Il retrace admirablement les conjonctions de forces, les osmoses, les métamorphoses. Toi, tu t’en tiens à la galerie des héros de la pensée, dans une vision… on aurait dit bourgeoise il y a trente ans, on dirait individualiste aujourd’hui. Tu sélectionnes ceux qui marquent mais peut-être pas ceux qui décident. Mais voilà, encore une fois, c’est une différence d’optique, n’est-ce pas ? Dans Le Pouvoir intellectuel, j’ai voulu m’attacher à la logique des institutions, de certains types d’intellectuels au cours de l’histoire. Toi, tu fais autre chose. Ce n’est ni moins bien ni mieux, c’est différent. Il y a tout de même deux points avec lesquels je suis violemment en désaccord, c’est d’abord la tentation perpétuelle du procès, à la limite de l’enquête de moralité : un tel s’est-il bien ou mal conduit ? Distribution de notes. Bon. Et deuxièmement, ton habituel discours sur l’idéologie française.
B.-H.L. : Quelle tentation du procès ?
R.D. : Oui, souviens-toi : la période Mounier… et Sartre… Sartre s’est-il bien conduit pendant la guerre ?
B.-H.L. : Ce n’est pas moi qui pose la question. C’est l’air du temps, la rumeur, l’histoire…
G.H. : C’est une réponse indirecte à Jankélévitch.
B.-H.L. : Oui, à Jankélévitch et à d’autres… Il m’a semblé important, dans une histoire des intellectuels, fût-elle subjective, d’ouvrir un dossier que je n’ai pas instruit mais qui me semble essentiel. Pour essayer d’y voir un peu plus clair. Dans le cas Mounier, c’est autre chose. C’est, en effet, une vieille querelle que j’ai exhumée il y a déjà une dizaine d’années avec L’Idéologie française et qui me paraît une bonne querelle parce que le cas d’un Mounier est significatif de l’histoire de France, de ses ambiguïtés, de ses obscurités. En l’occurrence je produis quelques textes maréchalistes datant de 1940 et 1941. Et je montre que la France est ce drôle de pays où l’on pouvait, entre juin 1940 et novembre 1942, ne pas être une canaille, ne pas être raciste ou antisémite, être anti-allemand, aimer son pays, être même prêt, lorsqu’il sera occupé intégralement, à prendre les armes pour le défendre — et où l’on pouvait néanmoins applaudir à la révolution nationale, se mettre au service des ministres de Pétain, faire des exhortations à la jeunesse, etc.
G.H. : Est-ce que, sur ce point, vous êtes en désaccord avec Bernard-Henri Lévy ?
R.D. : C’est un fait : les Français ont pour la plupart été maréchalistes.
B.-H.L. : Alors, où est le problème ?
R.D. : … C’est de faire du thème de la communauté, un thème fasciste. La Commune de Paris, le communisme, les coopératives ouvrières, tous les réseaux de la culture de gauche ont été des communautés. Les opprimés ont besoin de communauté, comme les oppresseurs.
B.-H.L. : Ce ne sont pas les mêmes communautés.
R.D. : L’idée de communauté organique est évidemment une idée tout à fait conservatrice, mais je refuse d’opposer à cette idée-là celle de l’individu libre, sans œillères, atomisé ou atomique. Il n’y a pas d’intellectuel qui puisse dire : « Je pense donc je suis », car on a toujours un « nous » derrière le « je » ; il y a toujours des communautés derrière les grandes figures individuelles d’intelligence, des communautés plus ou moins instituées mais, en tout cas, des corps sociaux qui ont été pour partie les universités, les revues, la communauté médiatique aujourd’hui. Tout combat d’idées est un combat de communautés. Donc la figure de l’individualité intellectuelle me semble être un leurre et un leurre de mauvaise foi. Par ailleurs, dans communauté il y a commun, et j’aime bien l’idée de biens communs, de mise en commun. Bref, je ne crois pas que la grosse idée abstraite de communauté puisse être récusée au nom d’un postulat individualiste. Il y avait dans le projet de Mounier cette idée que la communauté était une alternative à la fois à l’individualisme bourgeois et au collectivisme bureaucratique. Quand je vois aujourd’hui, au Brésil ou au Guatemala, la façon dont la théologie de la libération s’articule précisément sur la constitution de communautés, je reste convaincu que cette idée peut être progressiste. Donc la communauté, ce n’est pas seulement le fantasme du corps, le fantasme organique fascisant, elle peut être aussi quelque chose de prométhéen…
B.-H.L. : Tu joues sur les mots ou, au contraire, tu ne joues pas assez avec les mots ! Je n’ai jamais fait, ni ici ni ailleurs, le procès de la communauté en soi. Tu dis que tu trouves sympathique l’idée de biens communs. Moi, je n’ai rien contre les biens communs. En revanche, l’idée d’une communauté identitaire me répugne : elle me semble de nature à ramener l’individu à une vérité primaire et subhumaine. Qu’il y ait des communautés abstraites, des communautés contractuelles, des communautés spirituelles, voilà qui me paraît non seulement légitime, mais probablement indispensable et émancipateur ; ce que je récuse en revanche et crois être, en effet, l’une des matrices les plus constantes des grandes machines de servitude du XXe siècle, c’est l’idée que les hommes auraient en commun leur pensée, leur être, leur origine, leur matrice. L’idée de la matrice commune : voilà ce qui me paraît extrêmement choquant. Les instants d’émancipation des hommes, les moments où ils se sont vraiment « élevés », ce sont les moments où ils se sont arrachés à ces communautés de fatalité. Les intellectuels français, de fait, ont pensé la communauté de deux manières différentes. Il s’en est trouvé, comme Mounier, pour inviter les hommes à rejoindre ces communautés primaires et substantielles. Mais quand Bataille, Leiris et Caillois parlent de leurs « communautés », quand ils évoquent leurs communautés électives, sociétés secrètes, il y a là un pari sur une mise en commun qui est générateur de liberté et non pas de servitude. C’est peut-être une obsession, mais je crois vraiment que les communautés, soudées par un lien organique, représentent une barbarie latente, des foyers potentiellement fascistes…
R.D. : Oh ! on apprend tout cela sur les bancs d’université : la différence entre communauté organique et société contractuelle. On est tous d’accord sur le caractère atterrant et barbare de l’exaltation des jeunes…
B.-H.L. : Soit. Alors sortons de la distinction universitaire. Est-ce qu’il y a des bonnes communautés ou est-ce qu’il n’y en a que des mauvaises ? Voilà la question. Car ma conviction est qu’en effet les communautés sont inévitables, mais que le problème commence avec le fantasme de la bonne communauté. Un esprit religieux, c’est quelqu’un qui croit qu’il y a une bonne communauté : la sienne ; et, à partir de là, commence la guerre des communautés. Il me semble, moi, que la démocratie commence avec cette idée, difficilement tenable d’ailleurs, que les communautés sont toujours mauvaises, que l’harmonie parfaite des désirs ou des intérêts ne se fait jamais. Chaque fois que des intellectuels se sont laissés aller à croire qu’il pouvait y avoir une bonne communauté, que les individus pouvaient s’harmoniser en communauté, ils n’ont pas été loin de la barbarie. Le fantasme clef de ce qu’on a appelé le totalitarisme et qui n’est peut-être pas si mort qu’on le croit : le fantasme de la bonne communauté. Regarde ce qui se passe, à nouveau, du côté d’un certain islam.
R.D. : La question est, hélas ! plus tragiquement compliquée car, quand on réfléchit au concept républicain de nation — c’est-à-dire la libre adhésion à des lois qu’un ensemble d’individus se donnent librement, qui est la définition jacobine : est français qui veut —, on découvre qu’il n’y a pas de communauté sans une part d’hérédité ou d’héritage, c’est-à-dire d’involontaire. La règle rousseauiste de la volonté omet qu’une nation, c’est d’abord une langue. Or nous n’avons pas inventé ni choisi le français. Il y a des matrices en amont dont on découvre la force lorsqu’on en est extrait, autrement dit, banalité encore, il faut aller en Amérique pour se découvrir français, de même qu’un Japonais se découvre japonais lorsqu’il est aux États-Unis. On découvre alors à quel point une libre individualité a entre chair et cuir, et de façon structurante, une somme d’adhérences qui ne relève pas d’un libre arbitre individuel. Il y a dans la nation cette part romantique qu’on ne peut pas éliminer et à laquelle il ne faut pas céder. Alors tu as raison de lutter contre le romantisme identitaire, mais tu aurais tort d’en nier la réalité : s’en arracher est notre tâche peut-être, mais il faut aussi prendre conscience qu’elle nous marque, que parfois elle nous porte. Voilà pourquoi je ne peux pas faire de la communauté le mauvais objet. Au fond, qu’est-ce qu’un écrivain ? C’est un monsieur qui donne l’impression qu’il respire dans une langue comme s’il l’exhalait de son corps, mais, tout de même, cette langue existait avant lui, donc elle le domine. Je ne peux pas évacuer l’appartenance. Lorsque cette appartenance se pose comme loi. Lorsqu’on l’exalte comme une valeur en soi, c’est le vertige fasciste ou nationaliste. Mais c’est très lourd, une appartenance. Et d’ailleurs qu’est-ce que le monde d’aujourd’hui sinon un monde où l’on découvre que les anciens communistes juifs se découvrent dix fois plus juifs et moins communistes qu’ils ne le pensaient et où les Arabes se découvrent plus musulmans qu’ils ne le pensaient, etc. ? Tu te souviens du Pseudo de Gary-Ajar, la première phrase : « Il n’y a pas de commencement. J’ai été engendré, chacun son tour, et depuis, c’est l’appartenance. »
B.-H.L. : Oui, mais Gary était, en même temps, tellement autre chose ! Tellement bâtard ! Cosmopolite ! Tellement un type de nulle part ! Pour ma modeste part, c’est vrai que je suis juif, français, membre de communautés diverses. Mais je suis toujours surpris de m’apercevoir, lorsque je me regarde avec les yeux de l’intelligence, que j’adhère moins que je ne le croyais moi-même, mes réflexes sont moins « appartenants » que ma définition. Tu demandais tout à l’heure : qu’est-ce qu’un écrivain ? Je dirais qu’un écrivain, c’est quelqu’un qui joue avec cette fatalité de l’appartenance. Il y a, me semble-t-il, deux choses qui empêchent d’écrire : la première, c’est l’appartenance organique, considérer que le lieu d’appartenance est un lieu non pas de départ mais d’enracinement. La seconde chose, c’est la dénégation absolue de l’appartenance, le fantasme d’être né réellement de rien, de nulle part. Curieusement d’ailleurs, en écrivant ce livre, c’est-à-dire en enquêtant sur ma généalogie « spirituelle », j’ai croisé ma généalogie réelle puisque, pour la première fois de ma vie, j’ai vu l’endroit où je suis né. J’étais en Algérie, sur les traces de Camus. Et le hasard du voyage fait que je me retrouve dans le lieu même de ma naissance, que je ne connaissais pas. Cela a provoqué en moi un mélange de trouble, de rage, de volupté qui me semble être à la mesure de cette drôle de partie que nous jouons tous avec cette histoire d’appartenance : se sentir assigné et en même temps se sentir très loin, mesurer qu’on passe probablement sa vie à jouer avec cette histoire d’appartenance. Voilà. C’est ça un écrivain, un homme qui joue l’épreuve de la liberté, qui s’essaie à cette histoire un peu absurde qui est l’aventure de l’appartenance. L’appartenance, il ne faut pas s’y laisser prendre ni, inversement, la dénier névrotiquement. Il y a quelqu’un, d’ailleurs, qui a éprouvé tout ça avant nous et qui l’a magnifiquement exprimé, c’est André Malraux. Il a découvert un jour ce que tu dis être en train de découvrir, et il a passé le restant de ses jours à se débattre avec ça.
R.D. : Je crois que Malraux est passé d’un « pas assez de nation » à un « trop de nation ». Trotskiste puis gaulliste. Comme souvent d’ailleurs chez les exaltés ou chez les enivrés d’épopée révolutionnaire, Trotski n’a jamais envisagé le phénomène national, donc à un moment donné ça se casse la gueule et on passe de l’autre côté du cheval. Précisons que Malraux a parfaitement dominé son nationalisme. Je le tiens à la fois pour un grand penseur et un grand écrivain… Je passe du coq à l’âne : ce que tu dis de Camus et de la petite phrase, n’est-ce pas, ça c’est une chose très bien venue et très angoissante. Voilà, tu as des échappées parfois qui sont vraies. La fatalité de la petite phrase, chacun a prononcé des petites phrases en trop, sur Pivot ou sur sa mère, ou sur n’importe quoi… C’est pathétique aussi de voir que Gary se prenait pour un raté alors que c’était un authentique génie. Je te félicite parce que tu as été voir plein de gens, toi. Moi je n’ai pas vu tous ces écrivains dont tu parles.
B.-H.L. : Tu devais voir trop de gens importants. Des chefs… Des présidents de la République… Ça prend du temps.
R.D. : Je ne sais pas qui t’a donné l’idée d’aller voir Gary, je me reproche de ne pas l’avoir fait. Je l’ai découvert à sa mort, c’est un type immense !
B.-H.L. : Sous-évalué, en tout cas.
R.D. : Le tandem Gary-Malraux a dû faire souffrir Gary toute sa vie.
B.-H.L. : Terrible, oui. Comment être Gary quand il y a Malraux ? Quand on a fait, au fond, une telle erreur de mise sur orbite ?
R.D. : On ne choisit pas son créneau ? Tu parles là comme…
B.-H.L. : … comme Sainte-Beuve sur Baudelaire. Je crois qu’on le choisit un peu… Et surtout, c’est le destin. Voilà, c’est ça…
R.D. : Le destin… Il n’est pas impossible d’ailleurs que l’histoire de la littérature, d’ici cent ans, place Gary avant Malraux.
B.-H.L. : Pourquoi pas ? Ce que je sais, en tout cas, c’est que Gary a vécu cette proximité légendaire comme Mitterrand a dû vivre la proximité avec Mendès France. Comme un cauchemar de chaque instant…
R.D. : Tu as de jolis mots là-dessus. Gary et Malraux qui, par coïncidence, se retrouvent à l’enterrement de De Gaulle. Et Malraux ne cite pas Gary dans son récit…
B.-H.L. : Malraux a décidé une fois pour toutes de ne pas citer Gary.
R.D. : Tu as vraiment une conception désastreusement polémique des rapports entre les intellectuels, comme une sorte de combat de foire, n’est- ce pas ? Est-ce qu’il ne peut pas y avoir des émulations, des interactions intellectuelles ? Toi, tu pèses les prestiges. Tu recenses des guerres… Le mouvement surréaliste a tout de même été une belle mise en commun d’irréductibles…
B.-H.L. : Je ne sais pas. Ce que je reproche au surréalisme, c’est la mise en commun de la pensée. Rêver, écrire et penser ensemble me paraît une des idées les plus désastreuses qu’ont pu avoir ces gens qui, par ailleurs, avaient, lorsqu’ils écrivaient tout seuls, beaucoup de talent. Le surréalisme, contre la littérature. Je ne suis pas loin de penser que les écrivains ont intérêt à se rassembler le moins possible. Regarde le cas, que je cite aussi, du Collège de sociologie. Quand Caillois est malade, Bataille prend ses notes, une quinzaine de lignes gribouillées, et fait, à la place de Caillois, la conférence. Qu’en penses-tu ? Moi, je suis à la fois fasciné par l’étrangeté totale de cette situation et en même temps, c’est vrai, elle me fait un peu horreur : l’idée que quelqu’un pourrait, à partir de quelques grigris de ma main, improviser une conférence qui serait jugée par le cercle et, au-delà du cercle, par l’archive générale de l’époque comme la mienne, est une idée qui me trouble.
R.D. : J’ai l’impression que tu plaques le schéma totalitaire, le schéma politique sur un tout autre plan d’existence. Il y avait chez les surréalistes à la fois l’idée très rimbaldienne du refus de la carrière individuelle, du refus du culte du moi, et l’idée qu’un groupe est capable de transcender les individus. Je n’en fais pas ma religion, mais ça ne me semble pas mériter ces oukases, même si, c’est vrai, Breton était un antipape, donc un pape. Pontifical, mais accoucheur d’hommes.
B.-H.L. : Un écraseur d’hommes aussi. Regarde Crevel. Ou Antonin Artaud.
R.D. : Les anciens surréalistes n’ont pas de ressentiment contre Breton, c’est très troublant. Il y a eu les orages, les passions, les brouilles, mais en fin du compte et en fin de vie, il reste une immense affection pour Breton. Son extraordinaire rectitude morale avait, c’est vrai, un côté un peu terroriste, mais littéraire, verbal. Il a été, je crois, détecteur de mensonge, un homme de liberté, finalement. Séduit par le communisme comme il fallait l’être à l’époque, il l’a très vite rejeté d’instinct, fasciné par Trotski. Mais voilà un homme qui n’a pas compris la nation… Ce qui l’a amené à ne pas commettre le pire, mais à ne pas s’associer au meilleur non plus puisqu’il a été loin de la Résistance. Reste que dans le genre libre penseur, on fait difficilement mieux.
B.-H.L. : C’est vrai qu’il a souvent eu les bons réflexes politiques. La première adhésion au P.C., le recul, le trotskisme, le départ en 40, la villa Air-Bel, tout ça n’est pas si mal. Mais il est étrange que, à New York, en 40, il soit speaker à la radio américaine. Lui dont la raison d’être était d’écrire, il n’écrit pas un texte, il dit tous les jours à la même heure les textes de Lazareff.
R.D. : Non, c’est accessoire, c’est pour lui un simple gagne-pain.
B.-H.L. : D’accord. Mais Vichy, la collaboration, l’Allemagne, ce n’était pas accessoire. Or il a été paralysé, tétanisé pendant ces quatre ans. Alors au mieux c’est une étrangeté et au pire, et telle est ma conviction, c’est l’aveu d’une hétérogénéité entre sa pensée et la position que d’instinct il savait devoir prendre. Je ne crois pas qu’on puisse dire de Breton qu’il a été un homme libre, qu’il a résisté à la dictature. Quand il faisait fonctionner sa petite communauté comme nous savons qu’elle fonctionnait, c’est-à-dire de façon terroriste, quand il était capable de publier des « index », oui de vrais « index » recensant les livres qu’il était interdit de lire, c’était une terreur bénigne évidemment, mais les intellectuels, en règle générale, n’exercent de terreur que bénigne. Autre chose. On fait souvent crédit à Breton d’avoir été un des introducteurs en France du freudisme, de la psychanalyse. C’est une légende. Breton était jungien, pas freudien. Il n’a jamais rien compris à Freud. Il était de ceux qui croyaient que l’inconscient est collectif et que les hommes sont plantés dans une sorte de terreau, de rêve et de fantasme communs, une « mer intérieure », ce qui ne me semble pas de nature à programmer une pensée libre. Donc jungien, terroriste…
R.D. : Il faut le fusiller ? Tu lui donnes trente ans ?
B.-H.L. : Je le juge sévèrement. Et c’est vrai que je préfère Artaud ou, dans un autre genre, Leiris.
R.D. : Le tribunal du peuple aura du pain sur la planche.
G.H. : A propos de tribunal du peuple précisément, il y a, dans le livre de Bernard-Henri Lévy, la dénonciation de la fascination des intellectuels pour les idéologies dures du siècle, ce qu’il appelle la barbarie…
R.D. : Mais on est toujours le barbare de quelqu’un ! Généralement de l’autre barbare ! La guerre de 14-18, c’est ce qui a fait à la fois le surréalisme, le communisme, le fascisme, ça a fait tous les ismes ; la guerre de 14-18, ça a donné aux gens la certitude que le monde mercantile ou capitaliste dans lequel ils vivaient était porteur de mort. L’autogénocide de l’Europe a servi de tremplin à tous les délires. Chez les surréalistes, c’est évident. Nous en connaîtrons d’autres, des délires, au moins équivalents.
G.H. : Ça a l’air d’être une constante, cette séduction, cette fascination de nos clercs pour les révolutions, rouges ou brunes, du siècle…
R.D. : Le XXe siècle a connu des guerres démesurées par rapport à celles du XIXe siècle, des guerres totales impliquant militaires et civils, destruction de villes, bombes atomiques : Hiroshima, 80 000 morts ; Nagasaki, 50 000 — en quelques secondes. Ce sont des choses qui choquent. On va peut-être en revoir de semblables d’ici peu. Évidemment, nous, dans cette période de paix que Bernard a connue, on accuse les aînés de délirer, en proie à des fantasmagories, délires, épouvantes. Mais c’était la réalité des choses, et des gens, et des pays, et des sols. L’expérience de mort est incompréhensible pour nous qui avions zéro an quand tout ça se passait. N’engageons pas la métaphysique là-dessus : l’histoire réelle suffit.
B.-H.L. : C’est un des thèmes, non pas du livre, mais du film : on ne dit pas suffisamment quel énorme traumatisme fut la guerre de 14. Avec cette question, notamment, qu’on trouve dans tous les « romans de guerre » de l’époque et qui porte en elle une partie de la tentation fasciste, une question qui s’est posée à la France pendant des années, jusqu’en 1920 : comment les poilus ont-ils tenu ? Certains y ont répondu en évoquant la force du sol, de l’instinct, du sang, de la race, etc. Ce qui permet de penser que le fascisme n’est pas tombé du ciel, il est venu de la boue de Verdun. Et ce qui permet de penser qu’il ne faut peut-être pas en finir trop vite avec la métaphysique.
G.H. : Avez-vous déjà essayé de dégager les points de convergence et de divergence qui existent entre vous ?
R.D. : Vaste sujet !
B.-H.L. : C’est drôle. Lorsque nous nous parlons, c’est l’évidence qu’il y a un dissentiment majeur. Or, bizarrement, depuis quelques années qu’il nous arrive de nous croiser, j’ai beaucoup de difficultés à identifier ce désaccord. C’est peut-être, d’ailleurs, un trait de l’époque, ou un trait du débat intellectuel… : des dissentiments abyssaux et étrangement difficiles à cerner.
G.H. : Est-ce que la question irakienne est une divergence majeure entre vous ?
R.D. : D’abord, le fait est que nous n’avons pas la même définition de l’intellectuel. Je dirais que, pour moi, l’intelligence, c’est un travail, pour Bernard, c’est un spectacle. Je ne dis pas ça au sens simplement polémique du mot. Spectacle veut dire mise en scène de sentiments, volonté d’émouvoir, exercice d’une influence, maximisation des effets. A mes yeux, l’intellectuel est un monsieur qui s’enfonce dans les choses pour produire des vérités, je ne dis pas « la » vérité : la question de la science, la question de la connaissance est pour moi une question obsédante. Il me semble que pour Bernard, l’exercice intellectuel est un exercice de sujet à sujet ; moi, ça passe par l’objet, c’est-à-dire par l’isolement d’un champ empirique pour savoir, ensuite, comment ça marche. Lui, il a un sujet de préoccupation, et il veut agir sur ses contemporains pour les amener à penser différemment ce sujet. Il va du sujet au sujet vers l’objet et moi je vais du sujet à l’objet pour retourner au sujet ; c’est pourquoi j’écris des livres d’histoire, de théorie ou de philosophie. Pour découvrir des rapports constants entre les faits. Mais il m’arrive aussi d’être littéraire. Sur l’Irak, par exemple, puisque vous en parlez, moi je prétends faire sujet-sujet en passant par l’enquête des faits. Je me pose des questions empiriques, historiques : qu’est-ce que c’est que l’Irak ? d’où viennent ces gens ? etc. Je crois avoir plus le sens de la complexité et peut-être moins le sens de l’efficacité. Je dirais, à la limite, que nous n’avons pas la même perception de ce qu’est un intellectuel. Ceux dont il parle sont des gens notoires ou des notables. Ce ne sont pas ce qu’on appelle des ouvriers du concept, ce sont des figures de la vie parisienne… Pour moi, l’intellectuel c’est un enseignant et pour lui c’est un écrivain.
B.-H.L. : Pour moi, un intellectuel c’est un écrivain qui de temps en temps, provisoirement, devient un enseignant. Je ne crois pas qu’on soit intellectuel à temps complet. Et c’est pourquoi je n’aime pas ton idée d’ouvrier du concept. Je ne crois pas qu’être un intellectuel soit un « état », un « métier ». On est écrivain, artiste, etc. ; et, de temps en temps, de loin en loin, on interrompt le face-à-face avec son travail et on devient un intellectuel. Quant à ces histoires de « spectacle », es-tu certain d’être complètement hors du coup ?
G.H. : Vous avez parlé de quelqu’un qui semble vous réunir, Malraux, mais il y a également un long portrait d’Althusser dans le livre.
R.D. : Il faut dire de ce livre qu’il se lit de façon très agréable, parce que c’est aussi une enquête. On a toujours plaisir à écouter parler des gens, à découvrir des personnalités, il y a un côté tout à fait passionnant. Ça rebondit. Avec des textes subjectifs, des interludes qui sont comme des échappées, tout à fait savoureuses ou réfléchissantes. Une belle promenade dans le siècle. Althusser, c’est compliqué. J’ai toujours un peu refoulé la question Althusser vis-à-vis duquel, d’abord, je ne me suis pas bien conduit puisque le refoulement m’a justement conduit à ne plus aller le voir. C’est parce que je ne l’avais plus vu depuis à peu près six ou sept ans que je ne me suis pas manifesté au moment de sa mort.
B.-H.L. : Moi, c’est l’inverse. Ou plutôt c’est parce que je ne l’ai, comme toi, plus revu que j’ai écrit ce chapitre et terminé le livre sur lui.
G.H. : Est-ce ce que les intellectuels passent encore auprès de la jeunesse ? Est-ce qu’ils passent à travers les médias et leur effet réducteur ? Est-ce que la fonction des intellectuels n ‘est pas modifiée ?
R.D. : Bernard est une des figures classiques de l’intellectuel. Il aime la posture prophétique… Même pour annoncer une platitude, genre « l’intellectuel doit assumer ses contradictions ».
B.-H.L. : Oui, mais toi tu l’as dit au bout de deux cents pages (je pense toujours à tes Masques), moi il m’en a fallu trois… Plus sérieusement, si vraiment j’ai la posture prophétique, c’est un très mauvais point parce que je crois vraiment que ça, c’est mort. Il n’y a plus de « demande » pour l’intellectuel purement prophétique. Alors disons que j’essaie de croiser peut-être des restes ou des nostalgies de cette posture avec le souci de la complexité d’une part, et puis la littérature de l’autre. La position prophétique pure — si elle ne fait pas droit à l’exigence de complexité, à l’exigence de refroidissement des passions communautaires et collectives — fera rire dans une génération. Sauf, autre condition, à faire de la littérature. Bref, l’intellectuel au sens Sartre devant Billancourt, Zola écrivant La Vérité en marche, les discours de tribune de congrès de Malraux prenant la pente de plus grande simplicité, c’est un truc qui devient impossible. Comment la résumer, cette posture ? C’est celui qui pense qu’il y a un sens de l’histoire. Et ça, je crois que c’est fini ; c’est fini ou ridicule. Le dernier était Sartre, il y a eu une petite tentative de résurrection avec Foucault au moment de l’Iran.
G.H. : Est-ce que la question irakienne va provoquer des fractures historiques dans l’histoire des intellectuels ? Des fractures telles qu’on en connaît et qu’on les lit dans Les Aventures de la liberté ? Quelles seraient les lignes de fracture ?
R.D. : Pour moi, la question de la guerre en Irak est purement conjoncturelle. J’en parle donc comme d’une question stratégique, et m’y oppose comme stratégiquement contre-productive. Mais je n’en fais pas une question métaphysique. Elle me semble exclusivement relever du politique, c’est-à-dire de l’appréciation qu’on peut porter sur ce qu’est la politique étrangère de la France. Je n’en fais pas une question de principe. Il est vrai que l’Irak est un formidable révélateur et accélérateur sur le plan politique ; un révélateur des vraies conceptions de tout un chacun en matière de politique étrangère. Comme toutes les guerres, elle nous sert de papier de tournesol.
B.-H.L. : Je ne crois pas que ce soit du tout une affaire conjoncturelle. Il y a des vrais affrontements de vision du monde derrière tout ça. Et donc, à terme, des ruptures.
R.D. : Tu insultes mes amis, comme Gilles Perrault…
B.-H.L. : Je crois en effet que ce type d’intellectuels manquent à leur éthique la plus élémentaire. Leçon de l’histoire : le pacifisme pur (l’idée que la paix en soi est une valeur sainte) est une idée aussi conne et, à terme, aussi criminelle que le bellicisme pur (l’idée que c’est la guerre qui est, en soi, une valeur sainte). Voilà un terrain où il faudrait des positions nuancées, complexes…
G.H. : On aurait donc fait Munich sans le savoir…
R.D. : Vous parlez du phénomène Munich, s’agit-il de septembre 1938 ou bien de Munich « avec un grand M », tel qu’on l’emploie maintenant ?
G.H. : Munich, la photographie de l’époque.
R.D. : Plus personne ne se brouille à cause de Munich…
B.-H.L. : On se brouille deux ans après, avec effet de rétroaction, mais c’est vrai qu’on ne se brouille pas sur Munich. Drieu La Rochelle écrit Le Chef en rentrant d’Allemagne, et il ne se brouille ni avec Malraux ni avec Nizan… Autrement dit, que nous ne nous soyons pas brouillés aujourd’hui ne prouve rien quant à l’éventuel pouvoir de fracture de la guerre du Golfe. J’ai l’intime conviction, contrairement à toi, que cet événement « aléatoire » nous a fait entrer dans une zone de très haute tension politique. Qui dit politique, dit idéologie, philosophie, métaphysique. Nos positions sur cette guerre révèlent des choses sur chacun de nous. Je suis sûr que cette affaire va révéler en toi, par exemple, peut-être sous d’autres formes, des passions politiques que les gens qui t’observent croyaient mortes, sur l’Europe, l’anti-occidentalisme, l’anti-américanisme. Il y a un an, quand je t’ai filmé, tu avais certaines positions. Je ne suis pas sûr que cela sera encore vrai dans six mois ou dans un an. Un événement majeur de forte tension idéologique a un pouvoir de réactivation ou d’activation des équivoques, des faux accords avec soi-même et avec les autres.
R.D. : Il est vrai que cela révèle des postures philosophiques, politiques si tu veux, mais je dirais que ça ne dépasse pas le plan de la philosophie politique. Ça ne met pas en jeu les valeurs morales. Je ne peux pas disqualifier moralement François Mitterrand parce qu’il est pour cette guerre. De même il serait un peu fou de vouloir disqualifier moralement Cheysson ou Chevènement…
B.-H.L. : La guerre révèle des choses… On ne sait pas encore bien lesquelles. Je crois qu’en tout cas ça sera un opérateur de clivages et donc de regroupements. Comme d’habitude, ça se jouera dans notre dos.
R.D. : Ce qui me déprime le plus dans cette guerre, c’est la crise de l’universel. Je suis contre parce que la République est le régime qui nous divise le moins et cette guerre est celle qui nous divise le plus. En cela elle est antirépublicaine. D’ailleurs, la preuve, c’est qu’on la fait avec une armée de professionnels, et non avec l’armée de la République qui est celle des appelés. Et ça, c’est très grave. C’est le retour du communautarisme en France. Et ça arrive toutes les fois que la guerre n’est pas celle de la défense ou de la Nation.
B.-H.L. : Tu regrettes quoi ? Qu’on fasse la guerre ou qu’on la fasse avec des professionnels ? Si on ne peut pas la faire avec des appelés, c’est parce que la guerre est devenue à la limite de l’impensable dans les sociétés occidentales modernes. Ce n’est pas la preuve qu’elle n’est pas juste ou pas justifiée. Quant à l’idée d’une guerre qui serait celle de la Nation, c’est à mon tour de t’inviter à la prudence. Qui dit nation en armes dit guerre chaude, passionnée, délirante. Tout le contraire de ce que nous devons souhaiter. Guerre pour guerre, je ne déteste pas l’idée d’une guerre de professionnels. Une guerre froide est toujours préférable à une guerre de militants. Quelle monstruosité, la guerre de 14 avec la fleur au fusil, l’idéologie incorporée, et… Quitte à te choquer, je préfère les professionnels du Koweït aux appelés de Valmy.
R.D. : Tu viens de prononcer la petite phrase à la Camus. Attention… Alors si tu assumes ça, ça va loin. Il va falloir que vous choisissiez, chers amis, entre la mère et la justice…
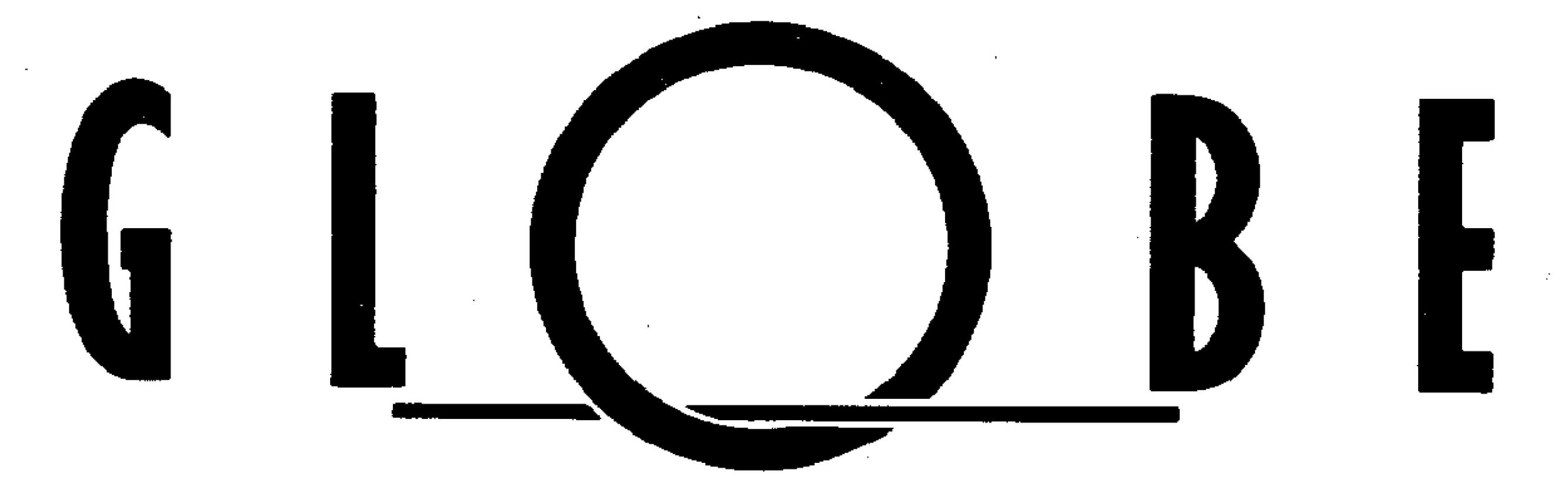
Réseaux sociaux officiels