Au fond, il y a deux écoles.
Celle de L’Origine du monde (Courbet) et celle du Bain turc (Ingres et, ici, Raysse).
D’où vient que la seconde œuvre – l’œuvre proprement dite, celle d’Ingres, « homme audacieux par excellence » (Baudelaire) non moins que cette œuvre-ci, revisitée par Martial Raysse (peintre de sang froid, de couleurs froides, donc baudelairien par éminence) – m’a toujours semblé plus émouvante, plus érotique, que la première ?
L’une en dit trop et, ce faisant, expose le corps désiré, le sature de visibilité et transforme la chair en objet (exactement l’inverse de ce dont Eros se nourrit) ; l’autre en dit peu, très peu et ne révèle, en réalité, comme dans la vie, que ce qui va exciter, aiguiser, intriguer le désir (or l’intrigue c’est le désir ; c’est même, comme l’étymologie l’atteste, sa trame et son récit secret).
L’une montre tout, réellement tout, jusqu’à cette part génitale de la chair redevenue corps qui, pour bouleversante qu’elle soit, n’a, comme on sait depuis Bataille, jamais suffi au trouble d’un amoureux des femmes ; l’autre ne montre qu’à demi, de dos, de biais, bras pudiques ou repliés, sexe deviné, croupes callipyges rendues à leur mystère, silhouettes de près et de loin, et les gestes eux- mêmes qui restent à l’état d’esquisse, de promesse, de caresse – qui dit mieux ?
Alors, bien sûr, il y a les couleurs. Et ces couleurs sont si vives, si criardes, elles annoncent à ce point la couleur, qu’on est tenté de se demander : est-ce que ça ne fiche pas tout par terre ? est-ce que cette surexposition, ce goût assumé du mauvais goût et de l’artifice, cette mise en scène fluo, néo, néon, n’est pas comme un acide qui va dissoudre le désir ?
Eh bien non, justement.
Car l’ennemi du désir ce n’est pas la scène, c’est l’obscène.
Ce n’est pas l’artifice, c’est la nature – vous savez bien : cette nature qui ne ment pas puisqu’à la violence du surgissement d’autrui, elle substitue l’évidente et, à la fin, lassante persévérance de l’être dans son état.
L’ennemi d’Eros, c’est bien, je le répète, la transformation de la chair en corps et du corps en objet.
Mon ennemi c’est la vérité en peinture, l’objectalité d’une âme réduite à ses organes, leur mécanique solide, leur verdict.
Là, pas de risque.
Jamais, dans la vraie vie, nul n’a vu épaules, nuques, seins, ainsi acidulés.
Jamais, dans aucun jeu amoureux, nulle n’a offert son ventre, ou ses cuisses, sur cet air de bazar.
Et c’est pourquoi ces femmes sont des femmes de chair – des femmes que je peux regarder, caresser du regard, sans me lasser et sans que, sous ce regard, elles prennent la triste vérité de l’objet.
Il y a de l’obscur dans les couleurs synthétiques de Raysse.
Comme Manet qui, selon Pissarro, faisait de la couleur avec du noir, lui fait de l’ombre avec du flashy.
La vérité c’est qu’il ne déshabille qu’à demi ses baigneuses : il les rhabille, un peu, de couleur – et c’est en quoi il eût mérité, comme son maître, d’être sacré par le poète « peintre des voluptés profondes ».
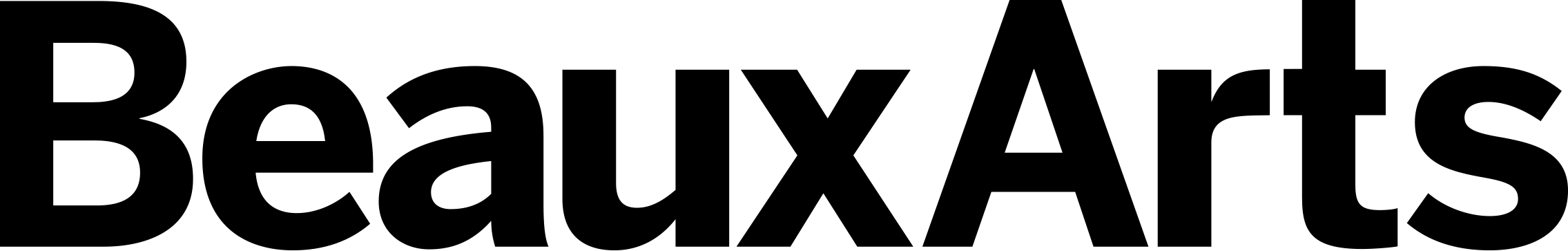
Réseaux sociaux officiels