LOUIS PAUWELS : J’ai lu et entendu dire que votre livre est celui d’un sectaire, c’est un reproche qu’on pourrait (à la rigueur) faire à votre série télévisuelle sur le même thème. Il me semble qu’on ne peut le soutenir honnêtement à propos de votre ouvrage. Dans cette histoire des intellectuels engagés, au cours de ce siècle tragique, ceux qui s’engagèrent à gauche jusqu’au mensonge et à la forfaiture n’ont pas votre mansuétude.
Quant à ceux qui s’engagèrent à droite jusqu’au fascisme, ils n’ont certes pas votre sympathie, mais vous vous interrogez sur eux comme un romancier. Je dis : romancier. Cela signifie : un écrivain qui a conscience de la complexité des êtres et des circonstances. Les idées sont aussi des personnages de roman. Les Aventures de la liberté, c’est le roman des idées et des hommes qui les ont incarnées. Et, à vous lire, je vous vois évoluer. Vous vous éloignez de votre figure de normalien-inquisiteur-de-gauche. Vous vous rapprochez de l’artiste, du romancier dont Tolstoï disait qu’il lui faut « l’objectivité du génie ».
Mais enfin, ce livre est tout de même une histoire des idées, écrite par quelqu’un pour qui les idées priment. Je viens de citer Tolstoï. Au temps où il écrivait Guerre et Paix, il n’aimait pas les historiens des idées. Il disait : « ces gens-là vont jusqu’à croire que les écrivains et les dames sont les forces qui conduisent les événements. » Je me demande si vous n’accordez pas une place exagérée aux intellectuels dans l’Histoire. Le siècle s’achève. Croyez- vous que vos héros, les intellectuels, ont joué un rôle aussi grand que celui que vous leur attribuez ?
BERNARD-HENRI LÉVY : Je vous signale d’abord que je ne suis pas loin, sur les « dames », d’avoir l’opinion de Tolstoï. Il y a en effet dans le livre tout un chapitre dont, curieusement, personne n’a encore parlé et qui traite justement du rôle, en littérature, des femmes qui n’écrivent pas. Les femmes surréalistes par exemple. Colette Peignot, qui passe de Souvarine à Bataille. Zelda, bien sûr. Colette Jeramec, qui est la première femme de Drieu et devient celle, ensuite, du surréaliste Tuai.
Bref, toute une foule de personnages dont on a, selon moi, sous-estimé le rôle et dont le point commun est d’avoir préféré devenir des « mythes » que des « auteurs ». Pour le reste, très bien. Car c’est vraiment cela que j’ai essayé de faire : une histoire des idées qui ressemble à un roman ; et un roman qui, comme tous les romans, évite le piège du dogmatisme. Comment ont-ils pu voir du sectarisme là où je me suis efforcé, au contraire, de laisser parler mes personnages ?
L.P. : Je ne sais plus qui a dit que « la critique est faite par des gens qui ne lisent pas pour des gens qui s’en foutent ». Et peut-être a-t-on fait plus de cas de votre personnage que de votre œuvre.
B.-H.L. : C’est classique. Et vous en savez d’ailleurs quelque chose. C’est ce que j’appelle, dans le livre, le « syndrome Romain Gary ». C’est-à-dire ces gens dont l’image, le rôle, les prises de position, etc., finissent par étouffer les livres. Pour Gary, c’était terrible. Lui-même le vivait comme une tragédie. Bon. Nous n’en sommes heureusement pas là. Mais enfin, c’est vrai que je suis, pour ma part, un peu navré de me voir à nouveau enfermé dans ce rôle de l’éternel sectaire, venant fustiger les erreurs de ses pairs. Pourquoi ces erreurs ? Ce que je démontre, c’est qu’elles ont constamment été le reflet de leur temps. Ce qui signifie, soit dit en passant, que cette histoire des intellectuels est aussi, à mes yeux, une histoire du XXe siècle. Folie du siècle. Convulsions du siècle. Égarements du siècle. Les intellectuels…
L.P. : Ils ont plus reflété leur époque qu’ils ne l’ont faite. C’est une particularité française que d’accorder un intérêt excessif aux engagements politiques des intellectuels. Cela encourage l’immodestie de ceux-ci. Ils se veulent un nouveau clergé. Ils s’arrogent le rôle de grands prêtres, d’intermédiaires prestigieux entre le peuple et le sacré. Quel sacré ? L’Histoire, et son prétendu sens. Ils s’attribuent arbitrairement cette prêtrise douteuse. Et, après avoir lu votre livre, on s’aperçoit que tout cela se solde par des égarements et des complicités politiques sinistres.
B.-H.L. : Je crois qu’il faut distinguer et que nous vivons, en réalité, sur deux définitions de ce « sacré » et sur deux conceptions, donc, de l’« intellectuel ». D’un côté le Juste, le Vrai, le Bien, bref le culte des valeurs et de leur universalité. C’est, en gros, le schéma de l’affaire Dreyfus. L’intellectuel étant celui qui, à tort ou à raison, dans un geste d’une audace inouïe, se proclame l’intercesseur entre ces valeurs et la Cité. Et son adversaire étant celui qui, sous une forme ou sous une autre, à la manière de Maurras comme à celle de Marx ou bientôt de Sartre, plaide pour la relativité des valeurs, leur caractère circonstanciel ou « situationnel », etc. Et puis, de l’autre côté, vous avez la sacralisation de l’Histoire ou, plus exactement, de son supposé « sujet ». L’intellectuel devenant, dans ce cas, le porte-parole de ce sujet, le confident de cette histoire. C’est là que le modèle se dévoie. C’est à cet instant que l’intellectuel risque de devenir criminel.
L.P. : Le terme Intellectuel, au sens où nous l’employons dans ce siècle, est issu de l’affaire Dreyfus. Au moment de cette affaire, l’intellectuel est un artiste (je pense à Zola, par exemple) qui émerge de son œuvre pour défendre un innocent. Pour cet intellectuel-là, l’innocence doit être défendue contre les pouvoirs. Mais ensuite, que sont les intellectuels dits engagés ? Non plus des gens qui défendent l’innocence, mais qui refusent de reconnaître ou qui justifient les crimes des États qui incarnent à leurs yeux l’idéal politique (U.R.S.S. ou Allemagne nazie).
B.-H.L. : C’est vrai. Encore que Benda, je vous le rappelle, ne craignait pas de dire que la bataille dreyfusarde aurait été encore plus belle si Dreyfus avait été coupable.
L.P. : En voilà, un paradoxe !
B.-H.L. : C’est une boutade, oui. Mais elle est plus sérieuse qu’il n’y paraît. Car la question, c’est : l’intellectuel dreyfusard défendait-il un innocent, ou des valeurs ? Le condamné de l’île du Diable ou la sainteté d’une justice immolée sur l’autel de la raison d’État ? Vous savez combien ces messieurs ont été déçus quand ils ont vu débarquer, en chair et en os, leur martyr…
L.P. : Écoutez : pour moi, les dreyfusards défendaient la vérité ! Comme Voltaire dans l’affaire Calas ! L’innocence et la vérité ! Ensuite, c’est autre chose. Les intellectuels se font aveugles aux crimes politiques. Drieu visite Dachau avant guerre, et trouve ça épatant. Romain Rolland, en 1920, visite les goulags de Lénine (Lénine, inventeur des goulags et des exécutions de masse, avant Staline). Et il se tait. Vous faites défiler dans votre livre des hommes qui, comme Drieu ou Brasillach à droite, comme Romain Rolland ou Aragon à gauche, vont être les témoins approbateurs du totalitarisme. Aragon chante la G.P.U.
B.-H.L. : Il dit en effet : « Il nous faut une G.P.U. » Et quant à Drieu, il est quand même le seul intellectuel doriotiste qui, à la fin des années 30, se proclame expressément « fasciste ». Bon. Le vrai problème à partir de là, c’est de savoir comment et pourquoi de tels égarements ont été possibles. C’est ça qui m’intéresse cette fois-ci. C’est ça que j’ai essayé de comprendre. Et c’est pour ça que je dis que j’ai tenté d’entrer dans la tête d’Aragon, Drieu, etc. Mon hypothèse, en gros, c’est que toute cette affaire est de part en part religieuse et que tous nos intellectuels ont réellement le sentiment de participer à la naissance d’une nouvelle religion. Une religion profane, d’accord. Une religion païenne. Mais une religion tout de même. Avec tout un côté transes, effusion lyrique, enthousiasme, prières en tout genre qui est le trait le plus frappant quand on écoute Romain Rolland à son retour de Moscou, ou Brasillach à Nuremberg. Tout notre petit monde célèbre ce nouveau Dieu qu’est l’homme nouveau « prolétaryen »…
L.P. : Et dans l’émerveillement, taisons-nous sur les enchaînés et les fusillés.
B.-H.L. : C’est ça. Mais avec, je vous le répète, ce fond sonore qu’est, à droite autant qu’à gauche, le désir de révolution. Quand Brasillach va à Nuremberg, il a le sentiment, lui aussi, d’assister à la naissance d’un homme nouveau et de voir l’histoire se briser. Et quand Drieu, au début de l’occupation, va voir Otto Abetz, ambassadeur du Reich à Paris, n’oubliez pas qu’il lui dit : « L’armée nazie est une armée révolutionnaire ! C’est une armée de libération ! » Ça paraît fou. Incroyable. Mais c’est comme ça. Et c’est bien la preuve que toutes ces histoires de révolution, d’homme nouveau, de recommencement, etc., ont été la vraie matrice des égarements du XXe siècle. On commence enfin à en sortir. Et, dans votre famille politique comme dans la mienne, c’est quand même la meilleure nouvelle de cette fin du XXe siècle.
L.P. : En dépit de votre souci d’objectivité, vous écrivez que, cependant, vous vous sentez plus proche des intellectuels staliniens, parce que, malgré votre réprobation, vous sentez entre eux et vous une proximité de langue. De langue ? Qu’est-ce que cela signifie ?
B.-H.L. : J’essaie simplement d’être honnête. Je me suis rendu compte, en effet, au cours de ces années de travail sur les textes ou les archives filmées, que j’étais enclin non pas à plus d’indulgence mais à une plus grande faculté de compréhension lorsqu’il s’agissait d’un intellectuel stalinien que d’un intellectuel fasciste.
Les égarements d’un Aragon, par exemple, ne sont pas, en soi, moins « coupables » que ceux d’un Drieu La Rochelle. Et quant à Georges Bataille, sa proximité à la séduction fasciste n’est pas moins troublante que l’ultra-pétainisme de Mounier en 1940. Mais, que voulez-vous ? Il reste malgré tout cela, que je me sens plus proche d’Aragon ou de Bataille. Alors pourquoi ?
Eh bien, justement, c’est tout le sujet de mon livre : traquer ces affinités inarticulées qui font d’un écrivain celui qu’il est. En l’occurrence, et pour être très concret : je sais que, ayant trente ans en 1940, je n’aurais jamais, comme Mounier, adressé aux autorités de Vichy un programme clefs en main de régénération de la jeunesse française ; mais je ne sais pas si, quelques années plus tôt, je ne me serais pas laissé aller, comme Malraux, à faire silence sur la répression des anarchistes à Barcelone.
C’est vraiment une affaire de famille. Il y a, vous le savez bien, et dans toutes les familles, des modèles de conduite. Eh bien, mettons qu’il y a aussi des modèles à.’ inconduite. Le modèle d’inconduite, pour la famille d’en face, c’est Drieu ou Chardonne. Pour la mienne, c’est donc Malraux ou Aragon. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas, si je veux être honnête, dire les choses autrement. Et vous, d’ailleurs, qu’en pensez-vous ? Vous sentez-vous plus proche des uns que des autres ? Avez-vous le sentiment que vous auriez pu partager les égarements de Drieu — ou ceux de Romain Rolland ?
L.P. : Non. Également éloigné. Le messianisme politique, j’en ai horreur. A l’époque du grand débat fascisme-communisme, mon rêve, c’était d’aller en Inde dans un ashram. Après-guerre, sous la domination intellectuelle des communistes et crypto, j’ai souffert et fui intérieurement… Et justement, il y a une catégorie d’intellectuels que vous oubliez dans votre livre : ceux qui cherchaient leur salut ailleurs que dans l’Histoire. Je pense aux disciples de René Guénon, à ceux de Gurdjieff, à Daumal, à Michaux : les aventuriers de l’espace du dedans. Ceux qui refusaient tout engagement dans l’Histoire. Il me semble que vous les avez ignorés ou négligés, comme si, pour vous, l’intellectuel était nécessairement (et essentiellement) engagé dans les questions du temps. Ceux-là aussi, mais d’une autre façon, ont contribué aux aventures de la liberté.
B.-H.L. : René Guénon a-t-il bien été un intellectuel non engagé ? Je n’en suis pas certain. Vous dites vous-même, dans le film, combien la pensée de Guénon a été essentielle dans le modelage de la sensibilité de l’époque. Vous parlez d’une pensée qui a mené certains jusqu’aux « formes les plus dures du fascisme. »…
L.P. : Cependant, ce n’est pas imputable à l’œuvre de Guénon, qui est au-delà de l’histoire. Mais je crains que nous ne parlions de gens aujourd’hui inconnus du public…
B.-H.L. : C’est comme Jean Bernier. Qui connaît aujourd’hui Jean Bernier ? C’est pourtant l’homme qui faisait le lien entre les surréalistes et les communistes, et qui invente la figure du poète révolutionnaire…
L.P. : J’aurais, par nature, penché vers les surréalistes, mais à distance de leur côté poète-révolutionnaire, et de leur dévotion idiote pour Trotski.
B.-H.L. : Lorsque j’étais jeune…
L.P. : Il y a moins longtemps que moi.
B.-H.L. : …J’étais, comme toute ma génération, fasciné par l’aventure surréaliste. Maintenant, je suis beaucoup plus sévère.
L.P. : Moi aussi.
B.-H.L. : Je trouve même étrange, soit dit en passant, d’avoir pu rester aveugle aussi longtemps. Il y a le talent de Breton, certes. Le génie d’Aragon. Mais il y avait aussi, dans ce surréalisme, un ton terroriste et policier qui était insupportable. Je raconte dans le livre les détails de cette terreur que faisait régner Breton.
L.P. : Toujours l’immodestie des intellectuels qui se veulent grands prêtres, et aussi grands inquisiteurs.
B.-H.L. : Grands inquisiteurs, surtout. Saviez-vous que Breton publiait un « index » des livres interdits ? Tout ce qu’on peut dire, c’est que ces folies sont la contrepartie d’un engagement qui…
L.P. : D’autres se sont engagés dans les débats du siècle, mais sans fanatisme, avec mesure et finesse, sans se faire piéger par le révolutionnarisme, comme Aron ou Mauriac.
B.-H.L. : Ce n’est pas la même chose. Autant la figure de Mauriac me passionne, autant Aron me paraît moins intéressant.
L.P. : Peut-être, mais on ne peut accuser Aron d’engagements criminels. Et, à mes yeux, mieux valent la lucidité, la mesure de Raymond Aron que les égarements de Sartre.
B.-H.L. : La grande différence entre Mauriac (et, d’ailleurs, Sartre) et Aron, c’est que les premiers ont une œuvre — alors que l’autre n’en a pas. Il y a des livres d’Aron, bien sûr. Des tas de livres. Mais ce sont des livres de circonstance. Et qui ne composent pas, à proprement parler, une œuvre. Ce qui est fascinant, de surcroît, dans le cas de Mauriac, c’est l’incroyable liberté d’esprit qui lui fait contredire en permanence son milieu et ses idées d’origine. L’Espagne, d’abord. Puis l’Algérie et le Maroc. Un intellectuel est réellement grand lorsqu’il se met à penser contre sa tribu, voire contre lui-même…
L.P. : Combien de fois, avant de passer du Figaro à L’Express de Servan Schreiber, a-t-il dû se dire : « Je ne suis pas d’accord avec les gens qui m’approuvent. » Une conscience libre ne peut être contenue dans la classe ou dans sa communauté d’origine. Une conscience vraiment libre n’a pas de clientèle ; ou du moins, pas de clientèle fixe. C’est au nombre des déceptions, des surprises, des provocations au sein des gens qui le suivent, qu’on pourrait mesurer l’honneur d’un intellectuel… Mais passons à autre chose… Votre sympathie pour la gauche vous entraîne à justifier les maoïstes de 68. Parce qu’ils étaient antistaliniens, vous dites qu’ils ont préparé le retour à cette idée généralement partagée aujourd’hui que la démocratie est, après tout, le « moins pire » des régimes. Cette justification me semble tirée par les cheveux.
B.-H.L. : Et pourtant…
L.P. : Quand on achève la lecture de votre livre, on conclut à la faillite des intellectuels, ou plutôt de leur prétention à changer la vie. Aujourd’hui, nous assistons au déclin de leur crédit. Nous avons moins d’importance. Les grands débats sont éteints. Les grandes espérances aussi. A cela s’ajoute l’effet de l’invasion des médias où les intellectuels sont remplacés par les saltimbanques.
B.-H.L. : Je suis moins pessimiste que vous. Que l’intellectuel prophétique soit mort, ou en train de mourir, c’est probable. Et je ne pleurerai pas plus que vous Sartre sur son tonneau. En revanche, il y a un autre modèle qui apparaît, un autre rôle qui nous incombe — et que les saltimbanques, comme vous dites, ne joueront pas. Quel rôle ? Eh bien, tout simplement, la pensée. Ou la réflexion. Ou le sens de la complexité. Voilà, oui : le goût de la complexité, des nuances, du débat nuancé et complexe. C’est à peu près, du reste, ce qu’ont fait les intellectuels pendant la récente crise du Golfe. Ils ont tenté de réfléchir. Ils se sont partagés, querellés. En dehors des clans, des alliances, des familles instituées.
L.P. : C’est vrai. Ainsi, je me suis trouvé d’accord avec Max Gallo ou Régis Debray.
B.-H.L. : Et en désaccord avec moi — qui me trouvais proche, à l’inverse, de Luc Ferry ou d’Alain Minc. Dans tous les cas, nous avons fait notre métier de clerc. Au lieu de répéter des slogans, ou d’ânonner des idées simples, nous avons tenté d’introduire un peu de complexité dans la langue de bois des politiques. Ce fut, depuis bien longtemps, le premier vrai débat d’intellectuels.
L.P. : Essayons de tirer la leçon de votre « roman ». Les intellectuels de ce siècle, avec leurs engagements souvent aveugles, leurs égarements parfois criminels, ont fait faillite. Ils ont, en eux-mêmes, soumis intelligence et fanatisme politique. Le messianisme politique, le sens de l’Histoire considéré comme sacré, leur ont, en quelque sorte, brûlé la cervelle. Et si nous essayions de redevenir tout simplement des artistes qui, à l’occasion, se prononcent sur les affaires du monde, avec une entière liberté d’esprit et l’intérêt que porte l’intelligence à la complexité des choses et des êtres ?
B.-H.L. : C’est très précisément ce que je dis. Ou mieux : c’est très exactement ainsi que se définit, dès l’origine, un intellectuel. Il n’était pas question, en ces temps anciens de l’affaire Dreyfus, d’être un intellectuel à temps plein. On était d’abord écrivain. D’abord artiste. On était d’abord Zola, Pissarro ou Monet. Et puis voilà que la circonstance faisait que, pour un instant, on suspendait son travail créateur pour intervenir dans l’actualité.
C’est ça un intellectuel. C’est ce sens du suspens. C’est ce goût de l’interruption. Retrouver ce sens et ce goût, voilà ce que nous pouvons nous souhaiter de mieux.
L.P. : Et cependant, nous avons la nostalgie des grands débats. En voyez-vous un apparaître en cette fin de siècle ?
B.-H.L. : Nous appartenons tous deux à des générations qui ont été dominées par la question du totalitarisme ou, pour être plus précis, par celle du communisme. Étions-nous pour ou contre le communisme ? Le jugions-nous, ou non, comme l’horizon incontournable de notre temps ? Nous subjuguait-il ? Nous répugnait-il ? C’était, j’y insiste, le cœur de tous nos débats intellectuels. Or voici que tout cela vole en éclats. Et voici que s’achève une histoire qui est, soit dit en passant, l’histoire même que racontent mes Aventures. Nous entrons alors dans une autre histoire. Et, donc, dans un autre débat. Lequel ? Pour aller très vite, je dirai : le débat qui opposera l’universalisme démocratique aux diverses figures du populisme. Hier : la démocratie contre le totalitarisme. Demain : la démocratie contre le populisme.
L.P. : J’emploierai d’autres termes. Entre les cosmopolites et les amoureux des racines… Je penche vers l’enraciné.
B.-H.L. : Je penche vers le cosmopolite.
L.P. : Je crois les deux conceptions conciliables.
B.-H.L. : Le problème est de savoir ce qu’on privilégie. Je suis d’accord, moi, par exemple, avec tous les enracinements que l’on voudra. Mais à condition qu’ils constituent, non des points d’ancrage, mais des points de départ et des prétextes à traversée. Si, en revanche, la racine devait primer, si la tribu devait l’emporter, si nous devions être réduits à notre appartenance originelle et matricielle, alors je pense que la servitude ne serait pas très loin. Prenons un cas concret à propos duquel nous nous sommes, d’ailleurs, déjà opposés : celui de Soljénitsyne. Je suis de ceux qui pensent qu’en donnant, dans son dernier livre, la primauté à la lutte contre l’Occident et contre sa « sous-culture », il s’égare. Alors que vous pensez, vous, qu’il revient à une vérité plus profonde.
L.P. : Voilà le prochain débat amorcé…


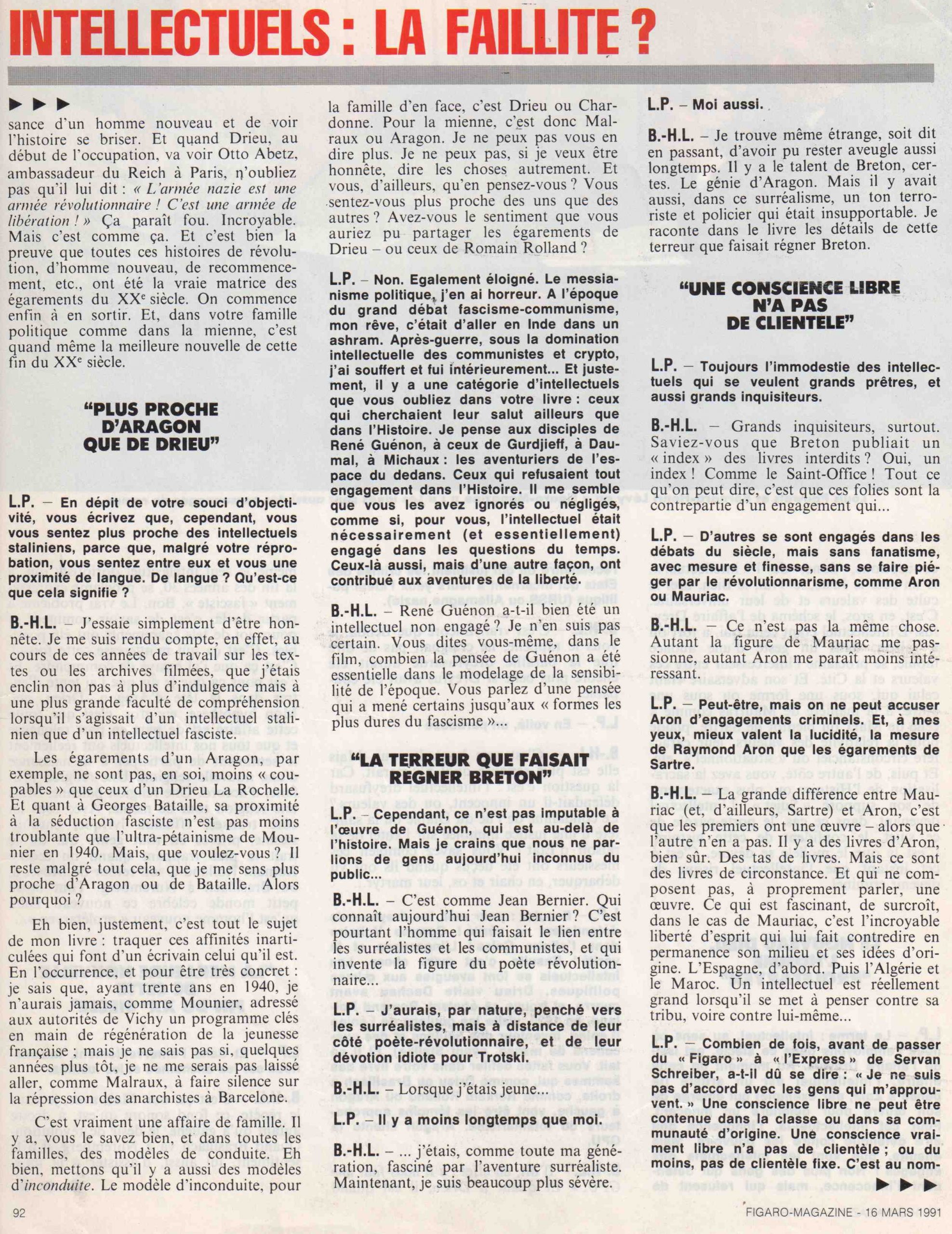


Réseaux sociaux officiels