Voilà au moins un premier roman qui ne risque pas de passer inaperçu. Sans crainte de se tromper, on peut être sûr qu’il sera le « must » de la rentrée. Son auteur, en effet, n’est autre que Bernard-Henri Lévy, une star de la République des Lettres qui s’est fait non seulement un nom, mais des initiales puisque les branchés du Twickenham, le bar de la rue des Saints-Pères, l’appellent BHL.
Chef de file des Nouveaux philosophes qu’il a lancés avec un sens aigu de la promotion, cet agrégé de philosophie, avec son visage romantique, fait plus songer à Samy Frey qu’à Socrate. C’est dire que sa séduction n’est pas qu’intellectuelle. On l’a vu d’ailleurs sur le petit écran dans l’adaptation du roman d’Aragon Aurélien. Jean-Luc Godard aurait voulu le faire tourner dans Je vous salue Marie. BHL a hésité et préféré écrire ce Diable en tête, son premier roman.
Je ne sais ce que le cinéma a perdu à ce choix. Après avoir lu Le Diable en tête, je suis sûr, en revanche, que la rentrée littéraire aurait perdu sans doute le plus excitant de ses romans.
Auteur de plusieurs essais, contestables, bien sûr, et contestés – La Barbarie à visage humain, Le Testament de Dieu, L’Idéologie française, tous des best-sellers, directeur de collection chez Grasset, sa réussite, le pouvoir intellectuel qu’elle lui a donné, lui ont attiré autant d’admirateurs que de détracteurs. C’est dire à quel point ce premier roman est attendu.
Un roman fort ambitieux. BHL, à l’évidence, ne prétend à rien de moins qu’à faire à travers le portrait de Benjamin, son ténébreux héros, celui de toute une génération perdue, passée de la révolte à la révolution et, après 68, du gauchisme au terrorisme, comme la génération précédente était passée de la Résistance à la Révolution. Et en même temps que le portrait de Benjamin, l’histoire du demi-siècle, de 1940 à nos jours avec ses modes intellectuelles, ses idéologies totalitaires, ses illusions et ses faillites.
Une ambition que BHL était d’autant plus apte à satisfaire qu’il a parcouru un bout de chemin au côté de Benjamin et de ses pareils. Plus lucide qu’eux, il a vu plus vite les abîmes où ils allaient tomber. À moins qu’il n’ait découvert plus tôt qu’il était par nature mieux fait pour les deux de la rampe que pour l’ombre des coulisses, pour le pouvoir que pour la marginalité…
Tout le livre, dans une composition d’une diabolique habileté pour tenir en haleine la curiosité de son lecteur est, de rebondissement en rebondissement, une approche à chaque page complétée, nuancée, corrigée de son ténébreux héros « un de ces êtres noirs marqués et comme élus à rebours que l’on dirait placé au point de rencontre des forces les plus troubles de leur époque ». Et l’histoire mouvementée de ses avatars. Un portrait qui, de découverte en découverte, se précise peu à peu à travers le temps, grâce aux documents et autres témoignages que le narrateur enquêteur a rassemblés jusqu’à sa rencontre en 1984 avec un Benjamin, repenti et quadragénaire qui a trouvé son chemin de Damas à… Jérusalem. À travers le journal de Mathilde, sa mère, pour ce qui est de l’enfance et de la prime adolescence de Benjamin. Par les lettres de Marie Rosenfeld, une jeune juive de Guebwiller, férue de belles lettres, montée à Paris faire ses études à la Sorbonne dans les années 60, et devenue la maîtresse du fascinant Benjamin, adresse à sa sœur jumelle Constance, restée au pays. Grâce ensuite au témoignage d’Alain Paradis, un ancien résistant devenu avocat de gauche plus ou moins lié aux services spéciaux qui semble avoir été l’âme damnée de Benjamin. Puis à travers l’interrogatoire de « l’Oncle Jean », comme Benjamin appelle son beau-père, qui, après avoir été avant-guerre le meilleur ami de son père, a épousé Mathilde. Et finalement, grâce à la confession de Benjamin lui-même qui s’apprête à tirer la conclusion de tant d’échecs, de tant de gâchis.
Au départ pourtant, Benjamin avait tout pour lui : la beauté, l’intelligence, la fortune. Toutes les séductions. Le ver dans ce beau fruit et qui va le pourrir, c’est la découverte qu’il fait dans son adolescence que le père disparu dont on ne parlait jamais dans l’hôtel particulier familial de l’avenue Ingres, loin d’être le brillant résistant que se plaisait à imaginer son fils, avait été en fait un ignoble collabo, dénonciateur d’une famille juive et fusillé à la Libération. Puis le soupçon, confirmé bien plus tard par Alain Paradis qui faisait partie de la Commission des grâces à la Libération, qu’Oncle Jean, honorable représentant du peuple de gauche a peut-être poussé à la roue de l’Histoire et à l’exécution de son père : il savait que pour épouser la très catholique Mathilde, il fallait qu’Édouard disparaisse. La découverte des horreurs discrètes – et j’en passe – de la bourgeoisie dont il est un rejeton si privilégié va faire de lui un rebelle face à son beau-père qu’il hait d’instinct et que, beaucoup plus tard, il tentera d’assassiner sans en avoir le courage. En attendant, ce n’est qu’un voyou doré sur le chemin de la petite, puis la grande délinquance. Jusqu’à ce que la rencontre, pendant la guerre d’Algérie, d’une jeune pasionaria du FLN, Malika, donne un contenu politique à sa révolte.
Dès lors, Benjamin va faire le parcours du militant suivi par tant de petits-fils de Marx et de Freud, d’Althusser (dont BHL fait un portrait aussi drôle que féroce) et de Lacan : le marxisme-léninisme, la gauche prolétarienne, Mai 68 et son échec, l’affaire Overney et la paranoïa qui s’en suit, une sorte de crise de mystique prolétarienne qui le pousse à s’engager comme ouvrier dans une usine pour se mettre à l’écoute, à l’école de prolétariat. L’échec aggravé cette fois du désespoir le jour où Benjamin se fait passer à tabac par « les fascistes de la CGT » sous les yeux des ouvrier indifférents et après être passé par Damas, Bagdad, La Havane, Berlin, le passage du terrorisme verbal au terrorisme tout court à l’italienne, dont le prétexte désormais est de moins en moins l’idéologie et de plus en plus la haine, qui fait de ce fils de famille un fugitif traqué par toutes les polices.
Je n’ai pu m’empêcher, en suivant Benjamin à l’usine, de penser à ce rejeton d’une illustre famille aristocratique française qui s’engagea comme docker à Saint-Nazaire après 68. Benjamin à Jérusalem me rappelait ce fils de ce criminel nazi, Veit Harlan, metteur en scène du trop fameux Juif Süss, s’installant après-guerre dans un kibboutz. Des souvenirs que j’évoque pour dire à quel point Benjamin, plus qu’un simple personnage romanesque, est bien un héros de notre temps, le produit pourri des lendemains qui déchantent, des guerres de décolonisation, des révolutions avortées d’une bourgeoisie toujours prête à se refaire une vertu en fusillant des boucs émissaires bien choisis comme Édouard, d’une rhétorique totalitaire, qui se prend à ses propres jeux de mots. D’une enfance traumatisée surtout : « l’enfance, secret des chefs mais aussi des loups et des enragés », dit BHL. Secret de Benjamin qui est tout cela à la fois.
Il n’y a pas que le demi-siècle, son bruit et ses fureurs, ses idéologies mortelles, ses gourous et ses girouettes qui se prennent pour des phares (comme Jean-Edern Hallier qui n’a pas besoin d’être nomme pour être reconnu au détour d’une page) dans le suspense psycho-politico-policier de BHL.
Pourvu de toutes les grâces, Benjamin, bien sûr, est un homme couvert de femmes. Dès l’adolescence, quand il séduit par goût et par provocation les riches épouses d’âge mûr des amis de son beau-père jusqu’aux viragos pas toujours ragoûtantes qui l’accompagnent dans ses missions terroristes.
Il y a Marie Rosenfeld surtout qui témoigne tant d’amour à Benjamin, son « demi-dieu », à la fois « Nizan à Aden, Malraux en Asie, Byron à Missolonghi », et qu’il trompera de toutes les manières, qui s’en apercevra, s’efforcera à plusieurs reprises de rompre le charme jusqu’à retourner à Guebwiller, s’y marier, y faire des enfants, mais qui laissera tout tomber dès qu’il apparaîtra, après des mois de disparition, pour le suivre dans ses dangereuses entreprises et finalement y perdre la vie. Un amour dont Benjamin, un de ces hommes qui n’aurait jamais aimé s’il n’avait entendu parler de l’amour, ne percevra, bien sûr, l’ampleur que trop tard.
À certains moments, on est plus près de Marivaux ou de Choderlos de Laclos que de Sartre. Quand Marie, par exemple, pour se venger des infidélités de Benjamin dont elle est loin de deviner l’ampleur, décide naïvement pour le mettre « mal à l’aise », de le tromper à son tour en se faisant passer tantôt pour elle-même, tantôt pour sa sœur jumelle Constance. Telle est prise qui croyait prendre. À ce petit jeu subtil et éprouvant, elle découvrira simplement que cette fois Benjamin la trompe avec elle-même, si ce n’est avec sa sœur ! Au moins y découvrira-t-elle le plaisir de certaines caresses, fort explicitement décrites, qu’elle ose quand elle se fait passer pour Constance, alors qu’elle n’aurait jamais osé les imaginer et encore moins les pratiquer sous sa propre identité…
Car rien ne manque à ce Diable en tête, pas même un érotisme assez salé. Ce diable de BHL décidément a parfaitement composé son cocktail. Il pousse le goût de la difficulté jusqu’à se mettre dans la peau de Mathilde pour écrire les sensations les plus physiques qu’éprouve une femme enceinte ou les vertiges sexuels que fait naître un désir frustré. Avec la coquetterie de celui qui est aimé des dieux, il exhibe à plaisir un talent tous azimuts.
Tant de travail, qu’on imagine sous tant d’apparente facilité, confond ! Pour un coup d’essai, ce premier est décidément un coup de maître.
Mais l’important n’est pas là. C’est que Le Diable en tête pourrait bien être à notre temps, celui du terrorisme, ce que L’Enfance d’un chef de Jean-Paul Sartre a été celui du fascisme.
Il pourrait bien être aussi le Goncourt 1984…
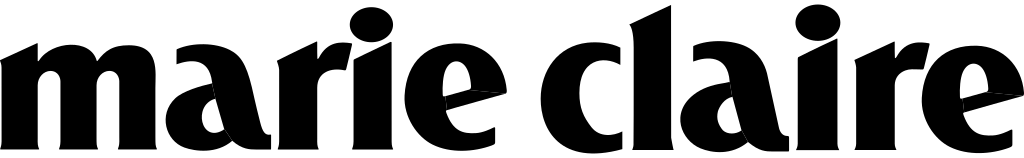
Réseaux sociaux officiels