Rien ne m’a plus impressionné, pendant ce voyage, que l’état de quasi-coma où j’ai trouvé la gauche américaine.
Oh ! je sais bien que le mot n’a pas le même sens ici qu’en France.
Et combien de fois ne m’a-t-on pas dit qu’il n’y a jamais eu, aux États-Unis, de vraie « gauche » au sens de l’Europe.
Mais enfin vous pouvez, amis progressistes, appeler les choses du nom que vous voudrez.
Le fait est que vous avez une droite.
Le fait est que cette droite a accompli, avec les néoconservateurs, une mutation idéologique à la fois considérable et passionnante.
Et le fait est que rien de comparable ne se dessine de l’autre côté – une sorte de désert au contraire, un silence assourdissant, un vide idéologique sidéral qui, pour un lecteur de Whitman et de Thoreau, est tout à fait énigmatique.
Ces « jeunes » démocrates de 60 ans qui en sont restés aux vieilles recettes de l’ère Kennedy…
Ces néopuritains de MoveOn.org que j’ai entendus, à Berkeley, renvoyer dos à dos les péchés d’un président libertin et le néomaccarthysme de ses adversaires…
Ces stratèges antirépublicains m’avouant n’avoir jamais mis les pieds dans une de ces megachurches néo-évangéliques où sont les vrais laboratoires de l’ennemi et me regardant avec des yeux ronds quand je leur dis y avoir, moi, passé du temps…
L’ex-candidat Kerry, croisé à Washington, quelques semaines après sa défaite, hagard, fantomatique, et me confiant dans un souffle : « si vous entendez parler de cinquante mille voix dans l’Ohio, faites-moi signe… »
Ces partisans du sénateur Hillary Clinton qui, lorsque je les interroge sur la façon dont ils comptent regagner la bataille des idées, me répondent qu’ils doivent gagner d’abord la bataille de l’argent et qui, lorsque je leur demande à quoi bon cet argent, pour quel projet, me répondent comme les robots d’un fund-raising devenu fou : « pour lever plus d’argent encore… »
Et puis, surtout, surtout, du côté des forces vives de la gauche, chez les écrivains, les artistes, les leaders d’opinion, les intellectuels, une atonie, parfois une timidité ou une gêne, face à tant et tant de questions brûlantes qui, non moins que la guerre en Irak, non moins que la dénonciation populiste des aventures internationales de Bush, non moins que cette dénonciation dévote de l’« Empire » qui est tout ce qui reste quand on n’a plus rien à dire, devraient les tenir mobilisés.
Pour un observateur extérieur il est étrange, par exemple, que nombre de progressistes aient dû, de leur propre aveu, attendre l’ouragan Katrina pour s’indigner, et parfois s’aviser, de la terrible pauvreté qui gangrène les villes américaines.
Pour un intellectuel européen habitué aux grandes querelles d’idées, il est incompréhensible que davantage de voix ne se soient pas levées, depuis longtemps déjà, pour dénoncer, au nom des Lumières, l’escroquerie des antidarwiniens partisans du « dessein intelligent ».
Et la peine de mort ? D’où vient qu’il n’y ait pas, en marge des partis et en marge, notamment, d’un Parti démocrate dont tout le monde sait qu’il ne bougera jamais, sur la question, sans une forte pression de la base, un vrai mouvement d’opinion appelant à l’abolition de cette barbarie civilisée qu’est la peine de mort ?
Et Guantanamo ? Et Abou Ghraïb ? Et les prisons spéciales d’Europe centrale, ces zones de non-droit, indignes d’une démocratie ? Je sais, naturellement, que la presse les a dénoncées. Je sais que vous avez des journalistes qui ont fait, en quelques jours, le travail que notre presse, à nous, Français, n’a pas encore fini de faire quarante ans après la guerre d’Algérie. Mais depuis quand la presse exonère-t-elle les citoyens de leurs devoirs ? Pourquoi, depuis Susan Sontag, n’entend-on pas davantage les clercs sur le sujet ? Et que penser de ces consciences qui, après le 11 Septembre, dans Dissent Magazine et ailleurs, se lancèrent dans un débat oiseux sur les circonstances – sic – dans lesquelles le recours à la torture serait soudain justifié ?
Et je ne parle pas de Bush lui-même. Je n’évoque que pour mémoire le mensonge de Bush sur les armes de destruction massive irakiennes. Je sais, bien sûr, que vous le dénoncez. Mais mollement. Mécaniquement. J’allais presque dire rituellement. Les États-Unis ont « empêché » Nixon parce qu’il avait espionné ses adversaires et menti. Ils ont failli « empêcher » Clinton pour un mensonge véniel sur une conduite « inappropriée ». D’où vient que nul ne fasse le parallèle avec un mensonge dont le moins que l’on puisse dire est que les conséquences ne furent pas vénielles ? D’où vient qu’il ne se soit trouvé aucun « intellectuel public » pour, dans cette démocratie assoupie que devient trop souvent la démocratie américaine, lancer, au moins lancer, l’idée d’un « empêchement » de George Bush pour mensonge ?
D’aucuns répondront que l’« intellectuel public » est une spécialité européenne et qu’on ne peut reprocher aux Américains leur infidélité à une tradition qui n’est pas la leur : que font-ils, ceux-là, du Mailer des années 60 ? du Miller des Sorcières de Salem ? que font-ils de cet âge d’or de la conscience civique où de grands écrivains disaient le juste, le bon, le vrai ?
D’autres objecteront que la mobilisation massive, bruyante, de la société civile n’est pas une habitude américaine : inexact encore ! absolument inexact ! et il suffit, pour s’en convaincre, de se rappeler les années 60 encore, et le mouvement pour les droits civiques, puis pour les droits des minorités en général, qui furent l’honneur du pays et ne provinrent pas, que l’on sache, des grands partis de gouvernement.
D’autres encore ironiseront sur la maladie de la pétition qui est une spécialité française et dont il n’est pas mauvais que le pragmatisme américain conjure les égarements : l’objection est déjà plus sérieuse ; et je sais la part de frivolité qu’il peut y avoir, en effet, dans la manie de l’engagement permanent, tous azimuts ; mais n’êtes-vous pas affectés, amis Américains, du mal rigoureusement inverse ? l’éthique de responsabilité n’a-t-elle pas remporté une victoire de trop, chez vous, sur l’éthique de conviction ? et comment ne pas rêver de pétitions qui, ce matin par exemple, à l’heure où j’écris ces lignes, feraient connaître notre commune nausée face au spectacle de ce vieillard diabétique, aveugle, quasi sourd, et poussé dans son fauteuil d’infirme jusqu’à la salle d’exécution de la prison de San Quentin en Californie ?
Je peux me tromper, naturellement.
Et je ne m’avance, sur ce point, qu’avec la plus extrême prudence.
Mais une grande partie du pays, il me semble, attend cela.
Partout, dans l’Amérique profonde, l’on rencontre des hommes et des femmes qui espèrent de grandes voix capables de se faire l’écho, grandement, de leurs impatiences.
Si j’étais vous, j’y serais attentif.
Si j’étais un écrivain américain, je crois que j’essaierais de penser ensemble, dans le même souffle et la même exigence, les leçons du siècle totalitaire et celles de la démocratie façon Tocqueville.
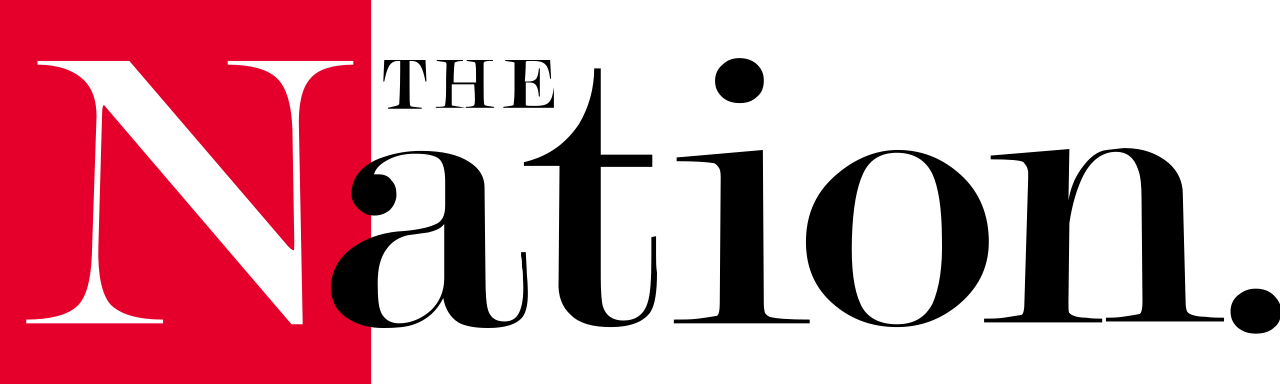
Réseaux sociaux officiels