C’est Frederic Tuten qui a commencé l’échange. Avec une lettre « mélancolique » sur l’état de la démocratie américaine.
Lettre 1
Je ne crois pas, cher Frederic Tuten, que cette ligne de vie, cette persistance de l’autre Amérique, cette lumière que je n’ai cessé, toute ma vie, d’invoquer car, de fait, je la sentais, j’en sentais la présence diffuse et confuse, je ne crois pas, non, qu’elle soit comparable à cette lumière des étoiles mortes qui continue de nous atteindre lors même que l’étoile elle-même a, depuis longtemps, fini de briller.
Je crois vraiment que la démocratie américaine est vivante. Je suis d’accord pour dire qu’elle est en crise. Je suis d’accord pour dire qu’elle est menée par de mauvais bergers. Je crois aussi que, comme l’avait très bien dit Tocqueville, la marge est étroite entre la démocratie et la tyrannie et qu’elle est peut-être, là, tandis que nous parlons, avec la torture, Guantanamo, l’état des prisons et du système pénitentiaire, les révélations récentes sur l’espionnage des citoyens par l’administration, je crois qu’elle est en train de devenir, oui, plus étroite et plus fragile encore. Mais je sens cette démocratie vivante, néanmoins. Vibrante. Je la sens qui continue d’inspirer, sinon vos institutions, du moins votre société civile et ce fameux tissu d’« associations » dont Tocqueville, encore, soulignait qu’il était, par rapport à l’Europe, une de ses grandes originalités – je vous accorde que le système est parfois défaillant mais je veux que vous m’accordiez (car c’est, vraiment, l’un des acquis les moins douteux de mon voyage, de mon enquête), que les ressorts sont sains.
Il faudrait, en vérité, des exemples.
Il faudrait, non pas cette invocation générale, cette déclaration de principe, mais des cas concrets, précis.
Ces femmes de Los Angeles qui créent un groupe de lobbying afin d’empêcher l’implantation d’un nouveau Wal-Mart dans leur quartier et qui, contre toute attente, et aux dernières nouvelles, y sont parvenues. L’horrible Wal-Mart, hein ? Le monstre écraseur de salaires et créateur de désert commercial ? L’incarnation de ce mauvais marché, de ce capitalisme sans vertu, de cette « obésité socio-politique » où je vois, moi aussi, l’une des menaces qui pèsent sur la démocratie américaine et l’une des sources, en tout cas, de son hubris grandissante et absurde ? Eh bien il n’a pas le dernier mot. Il n’est pas si irrésistible que cela. Voilà un groupe de simples gens, voilà trois femmes de rien du tout, qui se souviennent du « small is beautiful » qui faisait slogan dans les années 60 – et le small a raison du Mall. Voilà une association post-tocquevillienne de femmes en colère et elles font reculer le monstre – elles montrent que c’est le peuple qui, lorsqu’il s’associe et qu’il le veut, continue d’avoir le dernier mot.
Cette histoire de home schooling à laquelle, vous vous en souvenez peut-être, je consacre un chapitre au moment de mon passage par le Texas. C’est impensable en France, cette affaire de home schooling. On a, chez nous, un système éducatif à peine mieux portant que celui de l’Amérique mais voilà, on croise les bras, on reste passifs, on se dit « bon, il n’y a rien à faire qu’à attendre que ça se passe, que ça achève de se décomposer ou qu’un Etat mieux inspiré fasse une intervention miraculeuse ». Et, de toute façon, l’idée même de reprendre ses enfants et de les éduquer chez soi, l’idée même de les sortir du mainstream et de les sauver du désastre, est interdite par la loi. Ici, aux Etats- Unis, c’est permis. Ici, aux États-Unis, vous avez ce recours du home schooling qui change quand même les choses. Ici, aux États-Unis, vous avez cette possible prise en main, par les citoyens eux-mêmes, du destin de leurs enfants et donc du leur. Bref, ici, aux États-Unis, vous avez cette espèce de sursaut, de résistance toujours possible à la bêtise programmée : « le système veut mourir ; eh bien qu’il meure, s’il le veut ; mais ce sera sans nous et, surtout, sans nos enfants ; notre tâche première est de sauver les enfants. » J’ai mis un peu de temps, moi-même, à comprendre ce phénomène. J’ai même commencé, avec mes restes de tempérament jacobin, par me demander si cette façon de faire sans l’Etat, cette façon de se sauver tout seul en désertant le champ du combat collectif, n’était pas un tantinet réactionnaire. Aujourd’hui, et avec le recul, je crois qu’on a là un vrai exemple, au contraire, de vitalité démocratique. Je pense que ces gens qui sont des gens de droite et de gauche, des tempéraments religieux mais aussi des athées, des gens de toutes sortes en un mot, des gens dont la seule vraie ligne est de ne pas se résigner à la fatalité programmée de l’abrutissement, je pense que ces gens sont le signe que le ressort n’est pas cassé.
Ou bien encore Katrina. C’est la toute fin du livre et c’est un des chapitres auxquels, je vous l’ai dit l’autre jour, lors de notre première rencontre, j’attache le plus d’importance. Il y a la mauvaise leçon de Katrina, sans doute. Il y a cette révélation, avec Katrina, de ce véritable continent qu’est la pauvreté américaine et du fait que l’Etat, qu’il soit local ou fédéral, s’en fiche éperdument et manque à ses devoirs. Il y a cette idée d’un anti-11 Septembre qui, contrairement à l’autre, a choisi ses morts, a fait ses listes et a frappé, en priorité, les pauvres et les Noirs. Mais attention ! Il y a aussi l’autre leçon. Il y a l’extraordinaire spectacle des Etats voisins ou, plutôt, de la population des Etats voisins réagissant à cette carence des institutions en prenant en main l’organisation concrète des secours aux réfugiés fuyant New Orleans. Il y a cette leçon, que la première ne doit pas faire oublier, de l’incroyable sursaut citoyen dont cette catastrophe a été, également, l’occasion. Le Texas n’est pas un Etat particulièrement démocrate n’est-ce pas ? Et, encore moins, progressiste ? Eh bien la leçon heureuse de Katrina, la bonne surprise, ce sont ces habitants du Texas ouvrant les portes de leurs hôpitaux, de leurs écoles, de leurs maisons, ouvrant les bras, ouvrant leur cœur, ouvrant leur portefeuille, pour aider, sans considération politique aucune, sans acception des différences politiques, sociales, religieuses ni, naturellement ethniques, les pauvres gens en quête d’un abri et d’un réconfort. Eh bien ça, vous direz ce que vous voudrez, cher Frederic. C’est quelque chose d’inouï. C’est un élan de solidarité dont je ne connais pas tellement d’autre exemple. C’est une réaction populaire dont je ne suis pas sûr, vraiment, qu’on l’aurait eue, en France, si un ouragan avait frappé Toulouse et que les victimes avaient tenté de trouver refuge à Lille ou à Roubaix – et je ne parle même pas de ce qui se serait passé pour une catastrophe frappant, par exemple, l’Allemagne et pour des victimes tentant de trouver refuge en France. Et c’est, pour moi, un autre signe incontestable de vitalité démocratique.
Je pourrais vous citer maints exemples de ce type.
Il y en a, dans le livre, des foules et j’en ai, depuis, encore relevé des tas. Alors, il faut rester prudent, bien entendu.
Et il n’est pas question de tomber dans je ne sais quelle opposition populiste d’une Amérique « réelle » demeurée saine et vertueuse face à une Amérique « officielle » qui, gauche et droite confondues, tournerait le dos à ses valeurs : on connaît ça, en France ; on connaît la ritournelle du « pays réel » opposé au « pays légal » ; et je ne vais certainement pas vous faire le coup…
Mais enfin, reconnaître que l’Amérique des pères pèlerins et des pères fondateurs, reconnaître que la grande Amérique du Credo puis de Thoreau et Emerson, reconnaître que l’Amérique analysée et célébrée par Tocqueville lui-même avec sa glorification des fameuses « associations », reconnaître que tout cela n’est pas fini, que c’est encore vivant, que c’est la vraie ressource de votre système et la chance de votre futur, quel mal y a-t-il à cela ? Et est-ce pécher par optimisme que d’en relever, partout, les traits ?
C’est vrai, je garde espoir.
C’est vrai, le rêve américain me semble – vu d’en bas – encore de nature à orienter votre avenir et le nôtre.
Lettre 2
Vous avez en partie raison, mon cher Frédéric.
Et sans doute y a-t-il une part de mythe, ou de songe, dans la façon dont je vois, moi aussi, l’Amérique réelle d’aujourd’hui : pêle-mêle Kennedy ; Ellis Island ; le rêve de Martin Luther King ; la lutte pour les droits civiques dont je vais, en Alabama, pieusement recueillir les moindres témoignages et vestiges ; Daniel Pearl et Norman Mailer, mêlés ; les Juifs de Brooklyn vus comme des personnages de Bashevis Singer ; Roosevelt, ce héros ; Clinton, ce grand président ; ce fameux optimisme américain qui n’est peut-être, au fond, qu’un cliché de plus et dans le panneau duquel je tombe ; New Orleans ; oui, mon chant d’amour à New Orleans dont vous aurez beau jeu de m’objecter, et dont je m’objecte d’ailleurs à moi-même, que la preuve est faite, depuis Katrina, que l’Amérique profonde s’en fichait, la détestait, l’avait depuis longtemps maudite et la tenait pour ce en quoi elle s’est finalement transformée, à savoir une Ninive inondée ; la Beat generation prenant la relève de l’esprit pionnier ; etc… etc…
Mais je ne suis pas complètement d’accord, néanmoins.
Je ne suis pas d’accord, non, avec ce que vous supposez du rapport de ma génération – celle, en gros, des baby-boomers nés après la Seconde Guerre mondiale – avec la réalité de votre pays.
Et je voudrais vous faire, à ce propos, deux observations d’ordre – comment dire ? – biographico-politiques.
Première observation. La guerre justement. Le souvenir de cette Seconde Guerre mondiale et du nazisme. L’idée, comme vous dites, des Américains libérateurs de l’Europe. Bien sûr que ce fut l’affaire, d’abord, de la génération d’avant. Mais comment nier que ce fut aussi la nôtre ? Comment prétendre que nous ayons pu, nous, Français nés au lendemain de Vichy et, plus encore, Français et Juifs nés après la Shoah et donc, d’une certaine façon, miraculés d’un désastre qui avait prétendu ni plus ni moins que nous interdire de naître, comment prétendre que nous ayons pu échapper à cette grande ombre bénéfique que fut l’image de l’armée américaine détruisant, ou contribuant à détruire, la machine à tuer hitlérienne ? Mon père était un Français libre de la première heure. Il fut engagé volontaire, à 18 ans, dans les rangs de la République espagnole puis, tout de suite après, engagé volontaire contre l’Allemagne, puis, après la défaite, combattant dans les Forces françaises libres – Armée d’Afrique, Monte Cassino, libération de Paris etc. Eh bien cette idée de l’Amérique, cet attachement à l’Amérique libératrice et antifasciste, cette idée que, même avant la guerre, dès les terribles années 30, elle avait été le refuge de tant d’antifascistes de son espèce, et de Juifs fuyant la catastrophe annoncée, et d’écrivains, et d’artistes, voilà l’une des premières choses qu’il m’ait, dans mon souvenir, enseignées. J’ai grandi dans cette idée. J’ai grandi dans cette légende. J’ai été élevé dans une famille où ce thème de l’Amérique libératrice était un quasi-objet de culte. Sans même parler de ma mère, ma charmante mère, qui, jusqu’à la fin de sa vie, la toute fin, partait, chaque été, avec une amie, je pense pour les mêmes raisons, passer quelques semaines de vacances en Amérique, comme ça, juste des vacances, pour mieux découvrir ce pays qu’elle adorait et auquel elle avait le sentiment de tout devoir : là où d’autres partaient prendre le soleil aux Bahamas, ou dans des îles lointaines et tropicales, ou sur la Côte d’Azur, ou n’importe où ailleurs, elle allait, elle, chaque année, découvrir une ville nouvelle, un Etat nouveau de cette Amérique qui la fascinait et dont elle m’a transmis le merveilleux virus. Vous me demandez ce qui m’a conduit à accepter la proposition de The Atlantic et de Murphy, son directeur ? Eh bien peut-être cela aussi. Peut-être la présence muette de cette mère par ailleurs admirable. Peut-être un hommage discret (mais qui, à partir de cet instant où je vous l’écris, le sera soudain un peu moins !) à une mère aimée et folle d’Amérique qui a fait ce voyage avant moi, qui l’a en quelque sorte « repéré » pour moi et dont je n’ai fait que suivre, autant que celles de Tocqueville, les traces. Bref, cela pour vous dire qu’il ne faut pas trop simplifier ces affaires de génération et que la transmission, en l’espèce, l’a emporté sur la rupture. N’oubliez d’ailleurs pas non plus comment, jusque chez les plus gauchistes d’entre nous, chez les plus enragés, les plus radicaux et, notamment, chez les maoïstes, le schème de l’opposition fascisme versus antifascisme continua, jusqu’en Mai 68, de structurer notre vision du monde et des luttes que nous y menions. N’oubliez pas combien nous avons été nombreux à halluciner, parfois jusqu’au délire, que nous étions les nouveaux partisans d’une nouvelle guerre antifasciste qui était l’accomplissement de celle menée par nos aînés. Cette vision des choses, que nous le voulions ou non, ne pouvait pas ne pas impliquer, fût-ce à titre de souvenir, de nostalgie ou, comme vous dites, de rêve, une vision enchantée de l’Amérique. Elle ne pouvait pas faire de nous ce que sont hélas devenus, bien souvent, les héritiers modernes de ce gauchisme – à savoir des anti-américains enragés.
L’Amérique, me répondrez-vous, était l’ennemie de cette nouvelle guerre de partisans ? L’armée américaine de l’époque, celle de la guerre du Vietnam et de ses crimes, celle que l’on voyait, dans Le fond de l’air est rouge de Chris Marker, napalmiser les populations civiles du Nord-Vietnam reprenait, dans notre bestiaire idéologique, très exactement le rôle des armées qu’elle avait jadis défaites ? Justement non. Ou, plutôt, oui et non. Et je crois vraiment que nous avions – c’est, cher Frédéric, ma seconde observation – des garde-fous anti-anti-américains dont sont précisément dépourvus nos héritiers de l’extrême gauche d’aujourd’hui. Je prends mon cas personnel. Je ne sais pas si ce que je vais vous dire s’appliquerait à tous les jeunes hommes et femmes de ce temps-là. Mais, pour nombre d’entre nous et, en tout cas, pour moi ce fut une certitude inentamable et très précoce. L’antiaméricanisme était politiquement à gauche, d’accord. Il se disait dans la langue politique du bel et bon anti-impérialisme, o.k. Mais pour qui avait, non seulement de l’oreille, mais de la mémoire, pour qui avait une idée un peu précise de l’histoire idéologique de son pays, pour qui avait notamment grandi dans la tradition familiale dont je viens de vous parler, il avait des sources culturelles, des dynasties idéologiques et philosophiques, qui n’avaient rien, mais alors vraiment rien à voir avec la gauche. Il venait de l’autre bord, nous le savions. Il sentait non seulement la droite mais l’extrême droite française des années 50, 30, et même avant, c’était évident. Il puait ce que nous haïssions le plus au monde et qui s’appelait le pétainisme – ce mixte de racisme, antisémitisme, nationalisme crispé, chauvinisme, haine de la démocratie et du cosmopolitisme, peur phobique de ce « contrat social » rousseauiste, de cette idée d’une communauté fondée sur un pur « acte de volonté », un « credo », dont les pétainistes ont toujours obscurément deviné que l’Amérique, réelle ou rêvée peu importe, était la première incarnation en ce monde. J’ai écrit cela, il y a vingt-cinq ans. J’ai démontré, en 1981, dans un livre qui s’appelait L’Idéologie française et dont les toutes dernières pages traitaient de cette affaire d’anti- américanisme et de sa généalogie, que cette passion française n’avait migré que tardivement dans le discours de la gauche et que son lieu de naissance réel, son site d’origine véritable, le point de sa première incandescence, étaient à chercher plutôt du côté de Drieu La Rochelle, Brasillach, les maurrassiens, déjà Barrès, notre longue et fétide tradition d’anglophobie nationale – encore une fois, le pire. Je crois que cela, qui allait devenir un livre, je l’ai toujours confusément senti. Je pense que cette certitude, dont j’allais faire une thèse, a été, d’emblée, absolument d’emblée, une intuition, un réflexe. Je n’ai jamais été vraiment antiaméricain. De même que je n’ai jamais été vraiment antisioniste. Parce que j’appartiens à une génération qui a senti, très tôt, que cette affaire d’antiaméricanisme a toujours eu, en Europe, partie liée avec le fascisme.
Alors cela ne m’empêche pas, naturellement, de voir ou, au moins, d’essayer de voir cette Amérique d’aujourd’hui comme elle est. Cela ne m’empêche pas de dire à mes amis américains tout ce qui, dans leur Amérique, j’allais dire dans notre Amérique d’aujourd’hui, est indigne de cette idée que je ne me lasse pas et ne me lasserai sans doute jamais d’opposer à cette idée adverse qui est celle des antiaméricains. Je leur parle de leurs prisons, atroces. Je leur parle de leurs Malls, absurdes et mortifères. De leurs Gun Fairs, douteuses. De leur police si brutale quand il s’agit de se rendre maîtres d’une émeute urbaine. Je leur parle de la peine de mort, inacceptable quand on est une grande démocratie. Je leur parle de Guantanamo où j’ai eu la chance de pouvoir travailler plusieurs jours et dont je suis sorti convaincu que ce n’était certes pas le Goulag mais que c’était néanmoins une honte. Je leur parle, vous avez raison, de ce débat immonde sur les conditions dans lesquelles – sic – l’usage de la torture peut éventuellement se justifier. Je leur parle du massacre des Indiens et du fait qu’il restera une plaie béante au flanc de la nation tant qu’un vrai lieu de deuil et de mémoire, une sorte de Yad Vashem de la souffrance des premiers habitants du pays, ne lui aura pas été consacré. Je leur parle même de Rushmore, le mont Rushmore, ce monument tellement emblématique de la démocratie américaine et dont je démontre : 1. qu’on le dirait fiché, posé exprès, en une sorte de provocation colossale, sur un lieu qui était, pour les communautés indiennes, l’un des plus vénérables, des plus sacrés, du pays ; 2. que son architecte, son sculpteur, l’auteur de ces icônes qui, dans le monde entier, signifient cette démocratie US est un ancien militant du Ku Klux Klan qui n’a jamais renié les idées de sa jeunesse ; 3. qu’il s’appelle « Rushmore » à cause d’un avocat du même nom, un sale avocat, un voleur, employé par les grands chercheurs d’or et chargé par eux de trouver les bons moyens juridiques d’exproprier au moindre coût les propriétaires terriens indiens. Mais bon. Le petit détail qui change tout et dont je vous sais gré de l’avoir vu c’est que tout cela, tous ces chapitres sombres, ce procès que je devais à la probité d’instruire et qui occupe, à la fin, une bonne partie du livre, il procède de ce sentiment fondamental, fondateur du livre lui-même, qui est l’amour de l’Amérique et du peuple américain. Vous vous rappelez l’apostrophe de Gershom Scholem à Hannah Arendt après son livre sur la passivité des communautés juives d’Europe face à la déportation ? Vous pouviez dire ce que vous vouliez de votre peuple, lui reproche-t-il en substance. L’accabler plus encore que vous ne l’avez fait. Le sentiment qui vous a fait défaut et dont le défaut suffit, hélas, à entacher et peut-être ruiner votre entreprise c’est ce vieux sentiment que la tradition appelle l’» amour du peuple juif »… Mutatis mutandis, je crois qu’on ne peut critiquer l’Amérique que lorsqu’on est animé d’un amour sincère de son peuple et de son Idée. Et c’est de cet amour que j’espère n’avoir pas manqué.
Lettre 3
Cher, cher Frederic. C’est mon tour, en vous lisant, d’avoir envie de me précipiter à la fenêtre. Pas pour chanter l’hymne américain. Mais pour respirer un bon coup après le tableau d’apocalypse que vous faites de votre propre pays. Car je suis d’accord, bien sûr, avec ce que vous dites des libertés que prend ce pouvoir avec les libertés. Je pense, moi aussi, qu’il faut prendre très au sérieux, et le Patriot Act, et le wire tapping, et la surveillance systématique de la Toile par le FBI, et le reste. Mais enfin… Sans me faire l’avocat du diable – d’autant que ce diable-là, franchement, celui que j’appelle « le petit homme » et dont je décris la triste « revanche » à Detroit et ailleurs, je n’ai vraiment, mais alors vraiment, pas envie de prendre sa défense ! – sans me faire l’avocat du diable, donc, me permettrez-vous quand même d’observer que le Patriot Act est, jusqu’à plus ample informé, quelque chose de provisoire ? Qu’il a soulevé, dans tout le pays, un tollé spectaculaire ? Que l’Administration a rencontré les résistances les plus vives au moment de le proroger et de faire voter son « Patriot Act II » ? Dois-je vous rappeler qu’il s’est trouvé des Républicains, oui, des Républicains, pour, au Sénat, au nom de la tradition libertarienne qui est la leur et qui, malgré toutes les dérives, reste vivante, s’opposer à l’éternisation d’un dispositif dont ils savent qu’il ne pourrait, à terme, qu’aller contre le sacro-saint Bill of Rights ? Dois-je vous rappeler que la presse, c’est-à-dire à la fois les grands journaux et les networks télévisuels en principe soumis aux grands lobbies de la Foi, de l’Argent et de l’Autorité, a réagi avec une célérité sidérante aux révélations par Seymour Hersh, il y a deux ans, des sévices commis sur les Irakiens d’Abou Ghraïb ? Et l’affaire des prisons spéciales ? Et la question de Guantanamo ? Et ce vrai débat public qui, quoique nous en disions, traverse le pays à propos de ces zones de non-droit, voire de pur illégalisme, qu’autorise la « guerre contre la Terreur » ? Tout cela, franchement, n’est pas le signe d’une tyrannie en train de s’installer. Nous savons, nous, en France, ce que peut être la tentation tyrannique. Nous avons connu, pendant la guerre d’Algérie et après, la tentation de l’étouffement, et des libertés, et de la vérité, et de la presse. Et, de ce point de vue, croyez-moi : un pays qui, pour ne prendre, encore une fois, que le cas d’Abou Ghraïb et de la bonne épidémie de vérité qui s’est emparée, alors, de l’ensemble des médias, Fox News compris, un pays qui, donc, a su faire en quarante-huit heures le chemin que nous avons mis, nous, quarante-huit ans à ne toujours pas faire à propos des actes barbares commis par l’armée française avant le retour au pouvoir du général de Gaulle, ce pays-là est peut-être en crise, malade, saisi de vertige, etc., mais ce n’est pas un pays « fasciste », et ce n’est pas une « tyrannie »…
J’ai une hypothèse, vous le savez, dans le livre. Je suis à Austin, capitale du Texas, le jour de la seconde victoire de Bush. J’interviens dans une classe où le professeur Paul Burka donne un cours sur Tocqueville. Je m’aperçois, de fil en aiguille, qu’une large majorité des étudiants en face de moi auraient, s’ils avaient été en âge de voter, voté contre le président réélu et sont, sur des questions comme l’avortement, les mariages gays, le créationnisme, la peine de mort, sur des positions contraires aux siennes et où nous pourrions, vous comme moi, très bien nous reconnaître. Et je formule donc, à ce moment-là, l’hypothèse selon laquelle la fameuse vague rouge qui vient de s’abattre sur le pays, la déferlante des valeurs morales qui ont donné le sentiment d’embraser les âmes dans les derniers jours de la campagne, cette montée, partout décrite comme irrésistible, des grands thèmes conservateurs, cette frénésie, cette fièvre bizarre et, parfois, bizarrement désespérée à prôner le retour à un ordre ancien et fondamental que la modernité aurait battu en brèche et condamné, que tout cela pourrait peut-être se lire complètement à l’envers : sinon comme une illusion d’optique, du moins comme le baroud d’honneur d’une vieille, très vieille, droite qui sait que le monde a changé ; que le bon temps ne reviendra plus ; que les libertés fondamentales conquises dans les Sixties ne seront plus jamais remises en question par les forces vives du pays ; que la jeunesse n’y est pas prête ; qu’elle a basculé du bon côté de la grande révolution culturelle américaine ; et qu’il est temps, pour les autres forces, les forces contre-révolutionnaires, de tirer leurs dernières cartouches…
C’est mon impression, ce jour-là, à Austin. Mais c’est, plus encore, le sentiment qui s’impose à moi, quelques jours plus tard, lorsque je traverse ces vrais Etats du Sud que sont le Tennessee, l’Arkansas et surtout l’Alabama. Le Sud, ça ? La vieille culture sudiste, cette partie de chasse à la caille dont les rituels sont toujours là, mais vides, privés de sens ? Atlanta, cette ville noire et, en même temps, prospère où l’on ne trouve plus trace de Rhett Butler ou de Scarlett O’Hara ? Et le racisme ? Où est-il passé, ce franc racisme anti-Noirs dont je pensais, en bon Français drogué au préjugé, qu’il était partie prenante de la mentalité profonde du Sud profond et dont je découvre qu’il est, comme ailleurs, comme dans le reste du pays, devenu, sinon minoritaire, du moins indicible, inexprimable et – thanks to Morris Dees, le chasseur de fascistes de Montgomery ! thanks to Jim Carrier, l’historiographe des grandes luttes antiracistes d’il y a trente ans ! – littéralement censuré par une révolution qui, une fois n’est pas coutume, a réussi ? C’est cela. Quelque chose s’est passé, là, qui n’est pas près de passer. Quelque chose s’est produit qui ne va pas s’effacer ni revenir en arrière. Et la vague conservatrice actuelle ne doit pas faire oublier l’autre vague, de bien plus longue durée, qui a commencé, dans les années 60, avec Rosa Parks, Martin Luther King, etc., et qui a durablement métamorphosé le visage et le paysage culturel du pays…
Alors maintenant, bien sûr, il y a l’autre question qui est celle de l’atonie de l’opinion d’aujourd’hui et celle, en particulier, d’une gauche intellectuelle et politique dont je conviens bien volontiers qu’elle n’est pas à la hauteur de ses glorieux aînés. Là, oui, vous avez raison. Et c’est vrai qu’il y a quelque chose de troublant, pour un intellectuel français, dans ce spectacle d’un camp « progressiste » si timoré face aux grandes et brûlantes questions qui devraient le requérir. Je vous passe les moments les plus pathétiques de ma plongée dans les grands fonds de la supposée nouvelle gauche américaine. Je vous passe mes rencontres avec ces rescapés de l’ère Clinton plus puritains que les plus puritains ou avec ces hillaryens qui, à la question de savoir comment ils comptaient gagner la bataille des idées, ne savaient que me répondre en invoquant la nécessité de gagner d’abord la bataille de l’argent. Quid, en revanche, du débat sur la torture ? Quid du créationnisme et de la bataille qu’il faudrait mener, au nom de l’héritage des Lumières, contre les escrocs qui se réclament de la tolérance, donc aussi, d’une certaine façon, des Lumières, pour imposer l’enseignement de cette « deuxième » théorie qu’est la théorie du dessein intelligent ? Quid du Welfare State ? De la croissance, partout, des zones de pauvreté ? Quid de ce pur scandale qu’est la présence de la peine de mort en clé de voûte du système pénal américain ? Et comment se peut-il qu’il ne se trouve pas plus de voix, de grandes voix, pour s’élever contre cette barbarie civilisée indigne d’une grande démocratie ? La réponse la plus communément admise est que l’opinion publique serait contre. D’abord ce n’est pas une raison – d’abord, oui, il fut un temps où l’intelligentsia américaine (car il y a eu une intelligentsia américaine ! il y a eu, comme en France, des grands intellectuels prophétiques plaidant pour le Juste, le Vrai, le Bien !) savait prendre des positions impopulaires, voire à contre-courant. Et puis, ensuite, ce n’est pas si sûr – je prends l’exemple de la peine de mort et je ne suis pas si sûr, non, que l’Amérique profonde soit si définitivement braquée qu’on nous le dit contre l’idée même de revenir sur cette affaire de peine de mort (ayant parlé du sujet des dizaines et des dizaines de fois avec mes interlocuteurs croisés au gré du voyage, ayant parlé avec des conservateurs conscients du nombre d’erreurs judiciaires reconnues par la Justice, ayant discuté avec des chrétiens à qui j’objectais qu’il me semblait difficile, pour un chrétien, de consentir à ce que la vie d’autrui puisse être à la merci de quiconque excepté de Dieu, j’ai plutôt le sentiment que l’Amérique est, peu ou prou, dans la situation où nous étions, en France, il y a très exactement vingt-cinq ans, au moment où un candidat, puis un président de la République, courageux, décida de tenter le coup de l’abolition et y parvint…). Non. L’opinion a trop bon dos. Et c’est chez les politiques, chez ces soi-disant opposants terrorisés à l’idée de tenter le moindre écart ou d’élever la voix, c’est dans ces think tanks prétendument pourvoyeurs d’idées mais dont je crois, moi, qu’ils ne connaissent pas vraiment leur pays, c’est dans la sphère des idées, autrement dit chez les intellectuels, qu’il y a, très clairement, un problème et que le problème doit être, non seulement posé, mais résolu. Appelons ça, pour aller vite, une trahison des clercs. Mettons, qu’il y ait là une nouvelle trahison des clercs, mais aux couleurs de l’Amérique. Nous connaissons le phénomène, nous, les Français. Nous sommes même un peu experts. Et donc prêts, s’il le faut, à vous faire partager notre expertise. Mais là, amis, c’est votre tour. Et c’est, pour l’essentiel, à vous de jouer.
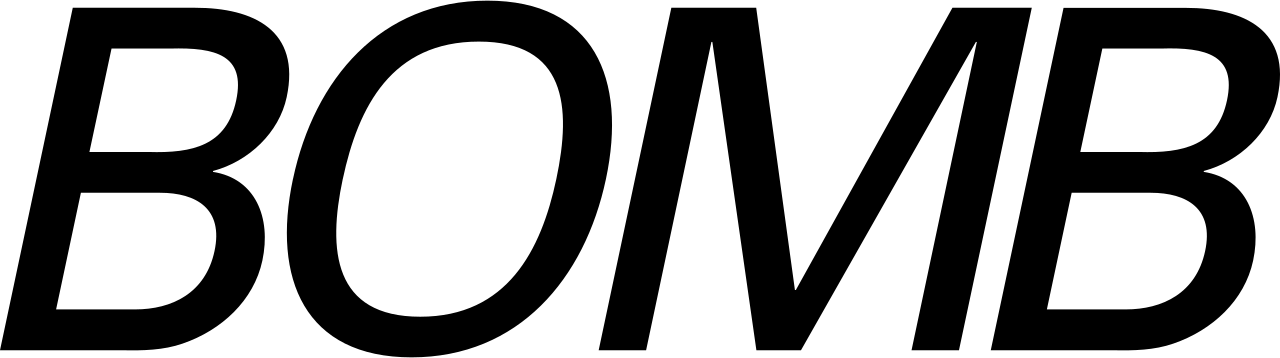
Réseaux sociaux officiels