Peut-on encore se livrer à une provocation, au sens le plus littéraire du terme, lorsque l’on occupe le devant de la scène depuis vingt-cinq an. A-t-on le droit d’exister, de réagir difficilement à l’échec, au « bide-bang » lorsque l’on est Bernard-Henri Lévy. Provocation, donc ! BHL peut-il commencer ce livre, qu’il nomme Comédie, par le mot « libre », avec un point d’interrogation, et puis… « affranchi de leur regard » ! Ce même regard qu’il a tant capté, tant sollicité. On ne s’attendait pas à trouver, non plus, dès les premières lignes de Comédie, un mot du journal de Jules Renard. Étrange changement de registre, chez un auteur qui nous faisait plutôt croiser les ombres de Malraux et de Sartre que celles des iconoclastes rieurs. Mais c’est précisément ce qu’on lui reprochera, là-bas, ici, dans ce périmètre dont il est la première figure, cette fameuse rive gauche qui aime tant classer, situer, qu’elle accepte difficilement cette obstination d’arriver toujours par un chemin inattendu. On le croyait philosophe, promoteur d’une nouvelle façon de penser, retournant hâtivement tous les concepts du marxisme, après avoir été l’élève attentif du plus intransigeant des lecteurs du Capital, Louis Althusser. On attendait donc qu’il revienne à la philosophie, à ses chères études d’autrefois ! En fait de philosophie, on trouvera dans Comédie de terribles portraits des maitres et, en quelques lignes, le souvenir de la folie d’Althusser. C’est que, dans les années de mise à mort des dogmes, la plus forte charge de dynamite placée sous l’édifice marxiste n’était pas un ouvrage philosophique mais un roman de Soljenitsyne. BHL ne pouvait l’ignorer et ne tarda pas à passer du côté du roman. Passage à peu près accepté. Ne venait-il pas de la Rue d’Ulm, de cette école qui avait produit Sartre et Nizan, tour à tour philosophes et romanciers ? Ce n’était encore rien. Il lui fallait le théâtre : les critiques dramatiques, qui d’ordinaire se plaignent du peu d’intérêt des écrivains pour la scène, firent quelques moues en voyant arriver l’intrus ! Et il y avait, toujours, l’ombre de Malraux qu’il cherchait à Sarajevo, quitte à se brouiller quelque peu avec un ami d’autrefois devenu président de la République. Mais cela ne suffisait toujours pas et BHL a voulu mettre en scène, être cinéaste, jouer avec un monstre sacré de sa jeunesse, Alain Delon, accompagné d’un rêve, Lauren Bacall, et bien sûr, dirait-il, de cette expression qui, chez lui, devient presque un tic, bien sûr, sa propre femme, Arielle Dombasle.
Cette fois, Paris n’a pas pardonné. Des rires, des sarcasmes, des invectives, il y en avait toujours eu. Mais les louanges sincères ou obligées l’emportaient toujours. Les plateaux de télévision et les couvertures des magazines faisaient le reste et le public suivait. Inacceptable succès ! Et puis… le bide.
Ce retournement d’un monde qui n’a guère changé depuis Balzac, depuis les Illusions perdues, ce monde où l’on vous adule avant de vous piétiner, où la mode passe avant la critique. La mode qui, dans les moments de succès, ne sait déjà pas distinguer l’essentiel, la mode qui adorait La Barbarie à visage humain, parce qu’il fallait bien qu’alors un jeune homme piétine les anciennes utopies, et qui, déjà, se défiait de L’Idéologie française parce qu’il est malséant que le premier de la classe se mette à fouiller dans les placards secrets de nos maîtres. La mode qui se retourne enfle le bruit des rires et des sifflets, les invente au besoin, et désormais fera passer pour un attardé – quand ce n’est un obligé – tout individu osant, d’une manière ou d’une autre, prendre la défense de ce phénomène que, brusquement, l’on trouve trop présent. Le choc lui-même fera sourire. De quoi se plaint-il ? Après tant de succès !
De fait, il ne se plaint pas, Bernard-Henri Lévy. Il s’en va, en un lieu qui tient plus de la villégiature que de l’exil. A Tanger. Pour écrire. Sa manière d’évoquer l’Afrique du Nord, la misère auprès des villas luxueuses, la compassion d’une Anglaise pour un chat, prépare le lecteur à rencontrer , un peu plus loin l’étonnement d’un enfant de Neuilly devant la pauvreté de sa maison natale, en Algérie. Voici le livre, justement : une réponse à ceux qui imaginaient que, de la khâgne de Louis-le-Grand au succès parisien, chaque mot, chaque geste visait à changer de monde. Lévy se retrouve Lévy, de l’autre côté de la Méditerranée, en un lieu où la mer ne compte pas. Et ce n’est même pas un Lévy juif qui parle, un Lévy qui pourrait s’affubler d’on ne sait quelle lignée de docteurs de la foi ! Non ! C’est un Maghrébin. Il envie les jeux des petits Arabes de Tanger, il ne se prend pas pour Bowles, en dépit des références. Par ce livre très écrit, sophistiqué parfois, BHL se jette en pâture, et montre ce qu’il s’efforce de dissimuler depuis tant d’années. C’est-à-dire un côté ingénu sous le Parisien le plus célèbre, une fragilité inquiète sous l’orateur péremptoire.
On dira, évidemment, qu’il trouve encore le moyen, le culot de parler de lui, de son moi, de chercher à distinguer Lévy de Bernard et plus encore de ce Bernard-Henri, fabriqué autrefois, parce qu’il fréquentait la seule kiné de Paris abonnée à l’hebdomadaire du PSU où un homonyme, un Bernard Lévy, signait, comme lui, un reportage sur le Mexique. Modifier son nom pour paraître et faire paraître. D’autres l’on fait, et sans remonter à Henri Beyle, ou même, comédie pour comédie, à Jean-Baptiste Poquelin, les vrais états civils sont rares en librairie. Tout le monde ne peut pas s’appeler Joyau comme Sollers. Bernard-Henri Lévy s’est fait un nom, comme l’on dit, et c’est peu dire. Un masque, des masques pour deux comédies contradictoires, celle d’écrire, celle de se montrer. Il est irritant à souhait, le dialogue de BHL avec Lévy. On veut donc parler du narcissisme de BHL, comme s’il ne s’agissait pas de la chose la mieux partagée du monde, de l’illusion commune, selon Freud. Mais voici que le narcissisme de l’auteur est traité comme un jeu, comme la fable qui porte sa comédie. Et BHL d’appeler à la rescousse le plus voyant des écrivains d’hier, le plus provoquant et le plus ouvertement mondain, Romain Gary, dont le dernier jeu fut, précisément, celui de deux pseudonymes, de ce second Goncourt décroché par le mystérieux Émile Ajar faussement démasqué par un prête-nom, Paul Paulowitch ! Incorrigible BHL, victime de ses miroirs, revenant à la charge en écrivant encore avec le je, le moi ? Mieux vaut éviter le piège qu’il nous tend ! Car, cette fois, la mise en scène de l’auteur est un leurre. Une porte de sortie offerte à qui voudrait éviter le livre. Ce n’est pas le portrait du joueur qui importe, Lévy – BHL sait bien que Sollers n’est pas loin. Il donne les pistes, au passage, pour mieux les brouiller. Le véritable enjeu est ailleurs, au sortir d’une trajectoire singulière, qui aurait pu s’identifier plus aisément à d’autres s’il n’y avait eu, au milieu du vacarme de mai 1968, une femme qu’il fallait mener d’urgence à l’hôpital Cochin et s’il n’y avait eu aussi un dopage miraculeux, toléré en cette course qui ignore les contrôles. La drogue des réussites artificielles, concoctée par un pharmacien complaisant… Bête à concours dopée, débutant pressé, BHL ne cache rien. Il n’évoque pas un pétard circulant innocemment en quelque soirée d’époque, mais bien une drogue, un mélange d’officine, un carburant pour atteindre, à toute vitesse, les sommets.
La tentation lui vient de jeter la dépouille, le nom de ce personnage fabriqué, de ce produit d’école et de pharmacie, d’en inventer un autre, un Ajar, de devenir, sous un masque, un auteur inconnu. D’autres ont bien signé de vibrantes critiques pour saluer quelque jeune auteur paru dans la Série Noire alors qu’il s’agissait d’eux-mêmes. D’autres qui, peut-être, rougissent leurs boulets au feu. Mais, quoi qu’il advienne, quoi que l’on fasse, l’enjeu n’est autre que la manière de cacher l’acte d’écrire. La solitude, tout simplement. Vieille histoire que BHL n’évoque pas, qu’il dissimule parce que c’est là son véritable sujet. Il envisage un instant la situation des écrivains silencieux, vrais et faux ermites, celle des handicapés du micro, des bègues de la NRF. Mais il passe. On ne le croirait pas s’il jurait qu’il rêve d’être méconnu.
Le succès venu si tôt, les années qui défilent, la gloire, le monde et la lumière aveuglante des projecteurs… Mais le succès n’a strictement rien à voir avec la littérature. Les prix, les lauriers et les ventes n’apprennent pas à écrire. Cette drogue consommée à haute dose laisse le même homme devant ses feuilles de papier, avouant qu’il court après sa jeunesse, « sa banale peur de vieillir » quand, déjà, des amis et des maîtres ont disparu en route. Défilent des visages. Suicidés célèbres, comme Guy Debord. Et puis, furtivement, une silhouette, celle d’un jeune philosophe, David Kaisergrüber, dont nous n’aurions jamais imaginé, il y a trente ans, qu’il disparaitrait en ne laissant point d’œuvre. Comédie est aussi, surtout, un travail de deuil. Celui d’une trajectoire. Bernard-Henri Levy enterre une époque, celle dont il fut le premier bénéficiaire, celle du règne des médias en littérature. Et il y a cet autre deuil enfoui, omniprésent quand un étrange « vieux maitre » ne cesse de croiser son chemin. On pense à quelques pages surprenantes d’Edgar Morin lorsque, âgé de 63ans, il s’avouait totalement désarçonné par la mort de son père. Cette façon d’être nu, non plus col ouvert ou torse nu sur une photo de magazine, mais dépouillé des mille protections du succès et, au sens le plus cru du terme, orphelin du seul regard qui protège vraiment, celui du père.
Bernard-Henri Lévy aura écrit quelques livres d’époque. Avec Comédie il signe le livre d’un âge. Il ne le classe pas. Ce n’est pas Comédie « roman » ou « essai », ou même « journal ». Cela n’a plus d’importance : l’auteur est parti ailleurs, lui qui s’est tant classé, hissé aux premières places, comme s’il n’avait jamais cessé de préparer le concours de l’École normale supérieure. Il se situe, cette fois, totalement hors-jeu, ou plutôt dans un nouveau jeu ou chaque livre est écrit comme si ce devait être le dernier.
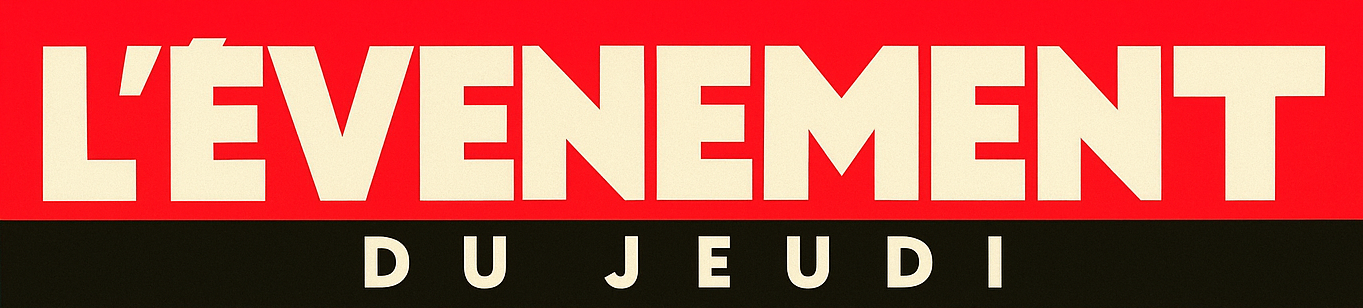
Réseaux sociaux officiels