Je sais si peu de choses de Sakineh.
Je sais qu’elle est née à Oskou, une bourgade de la province de Tabriz, nord-ouest de l’Iran, où les femmes portent le hijab, dans une famille pauvre et pieuse.
Je sais qu’elle a été institutrice à l’école maternelle de la ville qui est une toute petite école où les élèves ont de deux à sept ans et où l’institutrice fait tout : garde d’enfants, cantinière, nourrice pour les plus petits et, pour les grands, rudiments de lecture, de calcul, de dessin, de religion.
Ce métier d’institutrice ne va pas avec l’image d’illettrée qu’on lui a faite et que tout le monde – moi compris – a reprise ?
C’est vrai.
Mais, d’abord, on mélange deux choses. Sakineh est azérie. Iranienne mais azérie, née dans cet Azerbaïdjan iranien où l’attachement à la culture locale est fort et où l’on ne parle guère le persan. Illettrée, donc, en persan (ce qui explique qu’elle n’ait pas compris, lorsque le juge le lui a fait signer, au tribunal de Tabriz, en 2008, son jugement de lapidation). Mais certainement pas en azéri (ce qui colle avec cette photo d’elle que je n’avais encore jamais vue mais que des amis iraniens m’ont fait passer et où on la reconnaît, au milieu de sa classe, entourée de ses petites élèves qui semblent l’adorer et qui tiennent à bout de bras ce qui doit être, j’imagine, leur plus beau dessin de l’année : elle est légèrement en retrait, drapée de la tête aux pieds dans un hijab intégral noir – juste le visage qui apparaît et d’où émane une belle et subtile gravité).
Et puis, ensuite, cette histoire de verdict de lapidation qu’elle signe sans le comprendre est, on le sait aussi, plus compliquée. Quand la sentence est tombée, quand le représentant des cinq mollahs qui l’ont, à trois contre deux, mais en conscience, jugée coupable d’adultère, a rugi le mot fatal de lapidation, ce n’est même pas en persan qu’il l’a fait mais en arabe. Oui, Rajm… Le mot arabe, Rajm, pour dire la monstruosité de cette mise à mort qui consiste à vous caillasser le visage pour le réduire, lentement, en prenant bien son temps, en une bouillie sanglante… En sorte que Sakineh avait cette autre raison, qui n’a rien à voir avec un supposé illettrisme, de signer sans comprendre et de remonter, toute gaie, persuadée qu’elle était acquittée, dans le fourgon pour la prison.
Elle n’a rien compris, donc, au tribunal.
Elle a, tout le chemin du retour, chantonné entre ses deux gardes car elle croyait que les juges, eux, avaient compris qu’elle était une femme ordinaire, sans histoire, accusée à tort d’adultère – et qu’ils allaient, sans délai, la libérer.
Et ce n’est qu’une fois rentrée à la prison, dans la cellule numéro quatre, la cellule des condamnées à mort, que, dans des circonstances qu’a rapportées l’une de ses codétenues, la seule détenue politique de la cellule, Shahnaz Ghomani, elle a réalisé ce qui l’attendait vraiment : non pas juste la mort, mais la pire des morts ; non pas une pendaison comme les quelque trente autres femmes entassées, comme elle, parfois avec leurs enfants, dans cette cour des miracles qu’étaient les quarante mètres carrés de la cellule, mais la mort par bombardement de cailloux qui est la mort des femmes adultères.
Car cette scène, aussi, est établie.
Sakineh est de retour, donc, dans la cellule des condamnées qui jouxte, pour que les bourreaux gagnent du temps, la chaufferie où se font, le mercredi, les exécutions par pendaison.
Aucune de ses codétenues n’ose dissiper le malentendu, la tirer de son rêve éveillé et lui dire qu’elle sera, elle, enterrée vivante, le corps enveloppé dans un linceul et juste le visage qui dépassera pour que la horde des mâles puisse bien la cribler de cailloux.
Et il faut que ce soit une geôlière, sadique et triomphante, qui, à l’heure de la distribution de soupe, qui est le seul repas de la journée, vienne lui annoncer la vérité.
Sakineh n’a pas le temps de réaliser. Elle n’a pas le loisir, même là, de se figurer son visage pilonné jusqu’à ce qu’explosent les chairs, que les yeux jaillissent hors des orbites, que la cervelle soit bien pulvérisée. Car elle s’évanouit aussitôt. Et il faut que ses camarades la portent sur l’un des quatre lits que se réservent, en principe, les anciennes.
Je sais que Sakineh a une mère qui, jusque-là, pendant les longues années de procédure et avant qu’elle ne soit isolée de ses compagnes d’infortune et mise au secret, venait la voir toutes les deux ou trois semaines et lui apportait des nouvelles de sa classe.
Je sais qu’elle a un fils, Sajjad, la prunelle de ses yeux, son bonheur, qui a pris le relais en organisant, de l’extérieur, sa défense – et ce jusqu’à ce qu’une escouade de miliciens déboule, un jour, le mois dernier, dans le cabinet d’Houtan Kian, son avocat, où deux journalistes allemands étaient venus l’interviewer et, en un geste d’une férocité inouïe, l’embarque à son tour, avec les journalistes et l’avocat, pour le mener dans un lieu à ce jour inconnu.
Je sais qu’elle a une fille, Saeideh : mais d’elle, à part son long visage un peu triste, près de sa mère, collée à elle, sur la photo de classe, je ne sais rien (sinon qu’elle a maintenant dix-sept ans ; que c’est Sajjad qui subvenait à ses besoins ; et qu’elle est, depuis l’arrestation de son frère, seule au monde, sans moyens).
Je sais que c’est une bonne mère, fière de ses deux enfants et de l’éducation qu’elle leur a donnée – ah ! sa joie le jour où, au parloir de la prison, Sajjad est venu lui dire que la compagnie d’autobus de Tabriz avait retenu sa candidature et qu’il allait devenir poinçonneur.
Je sais que c’est une mère aimante, soucieuse, comme toutes les mères, d’épargner le pire à ses enfants – et que lorsque, voici quatre ans, on la traîna jusqu’à la chaufferie pour, au nom de la charia, lui administrer sa première séance (il y en aura une autre, l’été dernier) de quatre-vingt-dix-neuf coups de fouet, elle souffrit moins du fouet lui-même, de la morsure du câble de fer dans ses chairs en lambeaux, des douleurs qui lui montaient du bas du dos jusqu’à la tête et la faisaient vomir (ce qui n’avait pour effet que de redoubler la rage, et la violence, de sa tortionnaire), je sais qu’elle a presque moins souffert des coups qui, d’ailleurs, à la fin, ne la faisaient plus vomir, ne faisaient même plus tellement mal tant son corps était pétrifié et comme privé de conscience, que du fait que le supplice avait lieu, comme c’est la règle, sous les yeux de son fils alors âgé de seize ans (ne dit-on pas des enfants, qui assistent toujours aux flagellations, qu’ils en sont si traumatisés qu’ils jouent ensuite, pendant des années, au fouetteur et au fouetté ?).
Je sais qu’aujourd’hui, à bout de résistance et de volonté, bourrée des neuroleptiques que Sajjad, avant son arrestation, parvenait encore à lui faire passer, désespérée et presque résignée, même si cette perspective l’emplit d’effroi et lui arrache parfois, me dit-on, de grosses larmes qu’elle sèche, à la manière des enfants, en se frottant les yeux avec les poings, à sa lapidation annoncée, elle n’a plus qu’une requête à adresser à ses bourreaux et, si les bourreaux ne l’entendent pas, à Dieu : qu’on la lapide si l’on y tient ; qu’on choisisse, puisque c’est la loi, la grosseur des pierres de manière à ce qu’elle se sente bien souffrir et mourir ; mais que – de grâce ! – l’on épargne à Sajjad et Saeideh, sa cadette, ce nouveau spectacle d’humiliation et d’horreur.
Car Sakineh est pieuse.
On m’a raconté sa confusion et sa honte, le jour où la geôlière sadique lui a parlé et qu’elle s’est évanouie, quand elle s’est aperçue, au réveil, qu’elle avait, en tombant, laissé glisser son tchador.
Elle est enjouée, et superstitieuse.
Craignant la mort, mais craignant Dieu.
Elle est sidérée par l’insondable injustice dont elle est la victime mais – tous les témoignages concordent – pas vraiment révoltée car remettant son destin entre les mains du Tout-Puissant.
Je sais aussi – je le vois sur l’autre photo, la plus connue, celle où elle a son visage de madone encadré par les deux pans noirs du tchador, et bien dégagé – qu’elle est belle, très belle, quoique dénuée, il me semble, de coquetterie.
Car la question, bien sûr, est celle de ce fameux adultère qu’elle est censée avoir commis et qui est le vrai crime pour lequel on veut la lapider.
Il y a l’autre accusation, bien sûr.
Il y a l’affaire du meurtre de son mari, l’employé de banque Ebrahim Ghaderzadeh, mort en 2005, et que la police locale a tenté de lui mettre sur le dos en racontant qu’elle lui aurait injecté un anesthésiant avant que le cousin d’Ebrahim, Issa Taheri, ne le traîne à la salle de bains pour, avec un ami, l’électrocuter : mais d’abord, en droit iranien, le meurtre est puni du fouet, pas de la lapidation ; et surtout, de cette deuxième accusation, la justice elle-même l’a lavée en 2006 – on a les aveux de Taheri ; il a reconnu la pleine responsabilité de son crime ; et il est, par parenthèse, en liberté.
Mais, alors, l’adultère ?
Est-il impensable, après tout, que Sakineh ait trouvé du charme, soit au cousin, soit – car l’acte d’accusation est si flou, et semble avoir été si méthodiquement trafiqué, que l’on finit par s’y perdre… – aux frères Ali et Nasser Nojoumi qui semblent n’avoir, eux, rien à voir avec le meurtre ?
Et pourquoi, dès lors que s’étaient détériorées ses relations avec son mari (car cela aussi, on le sait – à travers les témoignages, à la fois, de Shahnaz Ghomani à qui elle s’est confiée et de la présidente du Comité international contre la lapidation, Mina Ahadi), dès lors qu’il l’avait contrainte, par exemple, à quitter ce poste d’institutrice auquel elle tenait tant (et qui semble avoir été, à ses yeux, l’humble garant de sa toute petite part de liberté), n’en aurait-elle pas nourri une sorte de ressentiment et n’aurait-elle pas eu la tentation, comme tant d’autres femmes dans une situation semblable, de laisser son cœur aller vers un autre ?
Là, de nouveau, je sais peu de chose.
Je sais juste que je dois faire très attention à ce que je vais écrire : car si l’adultère, pour un Européen, peut être un autre nom de l’amour et qu’il est donc un droit pour les femmes réduites au rang d’esclaves ou de martyres, je sais que c’est, en Iran, le pire des crimes – je sais, comme Sakineh l’a elle-même dit dans l’une des rares interviews qu’elle a pu donner avant de dis- paraître dans le cachot d’où elle n’est plus reparue, qu’à deux reprises, le visage flouté, la voix pâteuse, pour de pénibles séances d’« aveux » télévisés visiblement extorqués sous la torture, je sais donc que l’adultère, en République islamique, est pire que le meurtre et qu’une femme adultère c’est, en Iran, « la fin du monde ».
Alors ?
Alors j’ai posé la question à Houtan Kian, son avocat, quelques semaines avant son arrestation, le 10 octobre, en même temps que Sajjad : l’idée même d’un adultère dans une petite ville comme Oskou où tout le monde épie tout le monde est, pour lui, difficilement concevable.
J’ai interrogé Mohammad Mostafaei, son avocat précédent, qui a dû, lui, fuir l’Iran, abandonner son cabinet et passer la frontière irano-turque clandestinement, à cheval puis à pied : oui, m’a-t-il laissé entendre le soir de son arrivée à Oslo, cela n’allait plus très bien dans le couple ; il semble que Sakineh, poussée à bout, ait même pensé à divorcer ; mais la loi iranienne n’autorisant le divorce aux femmes que dans des cas très spéciaux, si le mari est fou, ou drogué, ou ne peut plus subvenir aux besoins du ménage, elle n’y est pas arrivée et en a probablement nourri une amertume redoublée ; mais il ne voit pas, non, franchement, il ne voit pas, lui non plus, sa cliente manifester cette amertume autrement que par d’innocentes promenades dans Oskou, peut-être des échanges de regards surpris par un corbeau local, avec l’un des frères Nojoumi, ou les deux, ou Taheri.
Je me suis même risqué, non sans gêne et scrupule, à mots couverts mais il m’a parfaitement compris, à interroger Sajjad, le fils, qui aimait d’un amour sans mélange son père assassiné et, peut-être, bafoué ; je l’ai fait sur la ligne de portable à carte, en principe anonyme, d’où nous pouvions lui parler, avec Armin Arefi, Maria de França et tous ses amis de La Règle du jeu, à peu près librement ; et là non plus, je n’ai rien senti – ni le parfum, caractéristique, du drame tu et du secret de famille enfoui ; ni, comme souvent dans ces cas-là, l’obscure solidarité du mâle avec le mâle humilié ; ni même, pour tout dire, le spectre de la mère volage à qui l’on finirait par pardonner à cause de l’indéfendable disproportion entre le crime et son châtiment.
Mon sentiment, en un mot, c’est que Sakineh est peut-être tombée amoureuse mais qu’elle n’est pas passée à l’acte.
J’ai la conviction qu’elle est victime de cette injustice absolue qu’est toujours la condamnation d’un humain quand on s’en prend, non à ce qu’il a fait (une infidélité supposée), mais à ce qu’il est (une femme dans un pays où les femmes sont moins bien traitées que les animaux).
Et je crois qu’il faut défendre cette femme à la fois pour elle-même (parce qu’elle est, de quelque manière qu’on tourne le problème, éminemment innocente) et pour ce que, désormais, sans l’avoir voulu, elle représente (le symbole de toutes ces autres femmes, ces ombres, ces fantômes, qui se tiennent derrière elle et n’ont, comme elle, d’autre droit qu’aller les yeux baissés, encagées, étouffant dans leur prison de tissu, muettes, et, au moindre faux pas, martyrisées).
C’est toujours une drôle d’histoire quand le destin s’empare ainsi d’un être qui, pour paraphraser un grand philosophe, défenseur des droits de l’homme et de la femme, est fait de tous les êtres et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui.
C’est toujours très étrange de voir une vie minuscule, pas plus coupable que beaucoup d’autres, pas beaucoup moins innocente, empoignée par le sort, et comme élue à rebours.
C’est ce qui se passe avec Sakineh.
C’est ce qui est arrivée à cette femme simple, probablement incapable, elle-même, de déchiffrer les signes qui émanent d’elle non plus, d’ailleurs, que ceux qui lui sont adressés par cette Histoire capricieuse dont elle est devenue, bien malgré elle, une héroïne.
D’où vient que je me batte pour cette femme comme si elle était mon amie ?
D’où vient que l’opinion mondiale se soit emparée de son visage pour en faire cette icône planétaire ?
Et pourquoi nos responsables politiques, Nicolas Sarkozy en tête, en ont-ils fait cet exemple ? le président français ne m’a-t-il pas dit, lors de notre dernière conversation, la semaine dernière, au téléphone, alors que le nom de Sakineh venait d’apparaître sur une liste laissant entendre qu’elle serait exécutée le 4 novembre à l’aube (et permettant au journal local, qui boucle la veille au soir, de bien donner, dans son édition du matin, la bonne information, avec la bonne orthographe et tout le bon détail des circonstances) qu’elle était devenue un test sur lequel il ne lâcherait plus ?
C’est la question que se posent les autorités iraniennes.
C’est l’énigme qui les met en rage, provoque leurs diatribes insensées contre ces « insolents » qui transforment un « crime de droit commun » en une affaire de « droits de l’homme ».
Elles ne comprennent apparemment pas – à moins qu’elles ne le comprennent, au contraire, que trop bien – que si l’affaire Sakineh est un test, pour elles, de notre détermination à leur résister (si nous tenons sur Sakineh, nous tiendrons peut-être sur le reste), elle est un test, pour nous, de leur capacité à entendre et reculer (si elles cèdent sur le cas de cette innocente, c’est qu’elles sont accessibles à la voix de la raison et que, donc, le dialogue est possible).
En tout cas, c’est ainsi.
Mahmoud Ahmadinejad n’y peut rien.
Sakineh, non plus, n’y peut rien – avalée, tel un Jonas moderne, par le gouffre de la nuit iranienne. C’est un autre mystère d’iniquité.
Et il en ira ainsi jusqu’à ce qu’elle soit libérée.
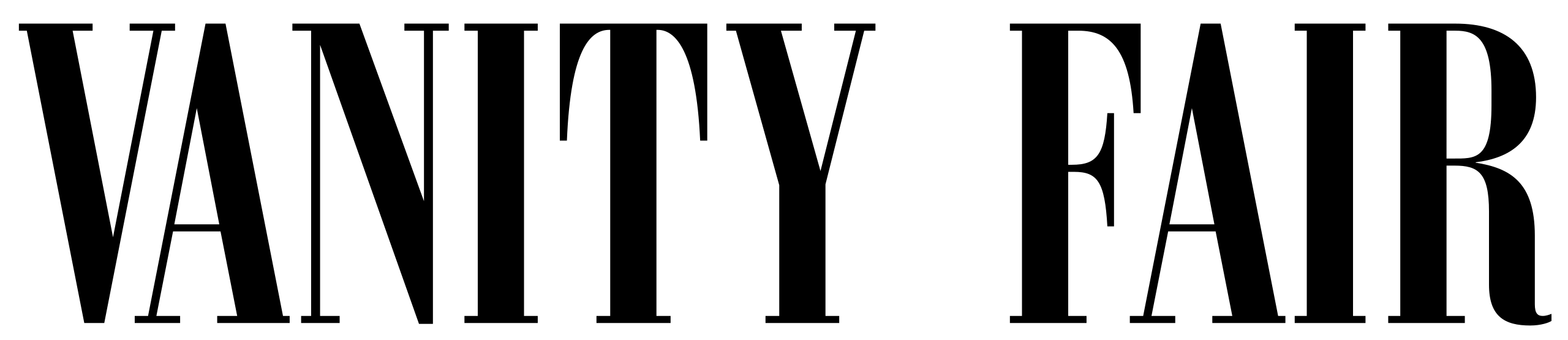
Réseaux sociaux officiels