La critique littéraire, fort louangeuse à son endroit, semble pourtant avoir été bien paresseuse alors qu’elle rendait compte du dernier ouvrage de Bernard-Henri Lévy, ce deuxième roman intitulé Les Derniers Jours de Charles Baudelaire. Bien sûr, on a salué l’écrivain et sa maturité ; l’entreprise d’autant plus réussie que très ambitieuse ; la modernité de la démarche ainsi que la construction polyphonique. Sans oublier la vraisemblance de l’improbable portrait, authentifié par le plus éminent des baudelairiens, M. Pichois.
Mais, en s’attardant trop complaisamment sur les clés de l’œuvre, sur sa trouble identité, en recherchant BHL tantôt derrière Baudelaire, tantôt derrière le narrateur, on a l’impression d’assister à de brillantes conversations de salon. L’essentiel n’est que rarement évoqué. L’essentiel, en l’occurrence, n’est-ce pas l’extrême insolence de ce roman qui ose renouer avec une tradition littéraire antiromantique perdue et sa radicale rupture avec une écriture air du temps où le laisser-aller égotiste tient lieu de chic en littérature. En clair, BHL, en s’insurgeant contre ce chic illusoire, a bravé les conformismes littéraires courants les plus insupportables :
- Refus du naturalisme et de ses dérivés : véracité, expérience vécue, identification partielle ou totale ;
- Refus de l’air du temps, d’une littérature datée, débraillée, et même rock – Philippe Djian n’est-il pas le représentant moderne du naturalisme précité ?
- Refus de la vitesse, de la littérature typiquement champagne, de toutes ses élégances négligées prétendument héritées de Paul Morand ;
- Refus de l’implication, refus surtout de la confusion primaire entre l’homme et l’œuvre. BHL ne cite-t-il pas en effet souvent cette phrase de Joyce : « Les livres doivent être plus intelligents que leurs auteurs ? »
Ce livre est ainsi, donc, le fervent plaidoyer pour une littérature « objective », distanciée, enfin distanciée. Et puis il faut dire un mot de cette déroutante conjonction Baudelaire-BHL. À première vue, rien de commun entre l’adorateur du Mal et le philosophe écrivain, si soucieux de pourfendre le Mal, justement. Rien qui ne soit pensable ou possible apparemment entre le maudit, toujours aussi maudit, et le wonder-boy des lettres qui a choisi pourtant de passer quatre ans sur cette obscure agonie et d’en dire les terribles et contraires mystères.
Le paradoxe, si pertinent soit-il, ne résiste pas à l’analyse. Et si, enfin libéré de toutes les scories du temps, on se rendait compte que Baudelaire était le vrai grand moraliste du XIXe ? Et si BHL s’était enfin trouvé un maître à penser, plus parfait et plus durable en tout cas que les Foucault et autres Althusser ? Pardonnez l’emprunt, mais cette citation de Blanchot à propos d’Hermann Broch (Le Livre à venir, Gallimard) concerne aussi bien l’écrivain que son modèle : « Il fut un romancier d’une part, un poète d’autre part, et, à d’autres instants, un écrivain de pensée. Il fut cela tout à la fois et souvent dans le même livre. Il a donc subi, comme bien d’autres écrivains de notre temps, cette pression impétueuse de la littérature qui ne souffre plus la distinction des genres et veut briser les limites. »
Plus haut, je parlais de l’insolence. La plus grande insolence de ce livre n’est-elle pas d’avoir refusé le chantage qui neutralisait la création littéraire depuis 1952 ? Je veux dire cette désespérante alternative qu’on nous offrait entre une littérature « engagée », généreuse mais trop souvent médiocre, et cette autre, hussarde, droitière, traditionnelle, trop. Le roman de BHL vient nous soulager de trop longues cures de champagne mais aussi d’eau bénite. Quarante ans, ça suffit !
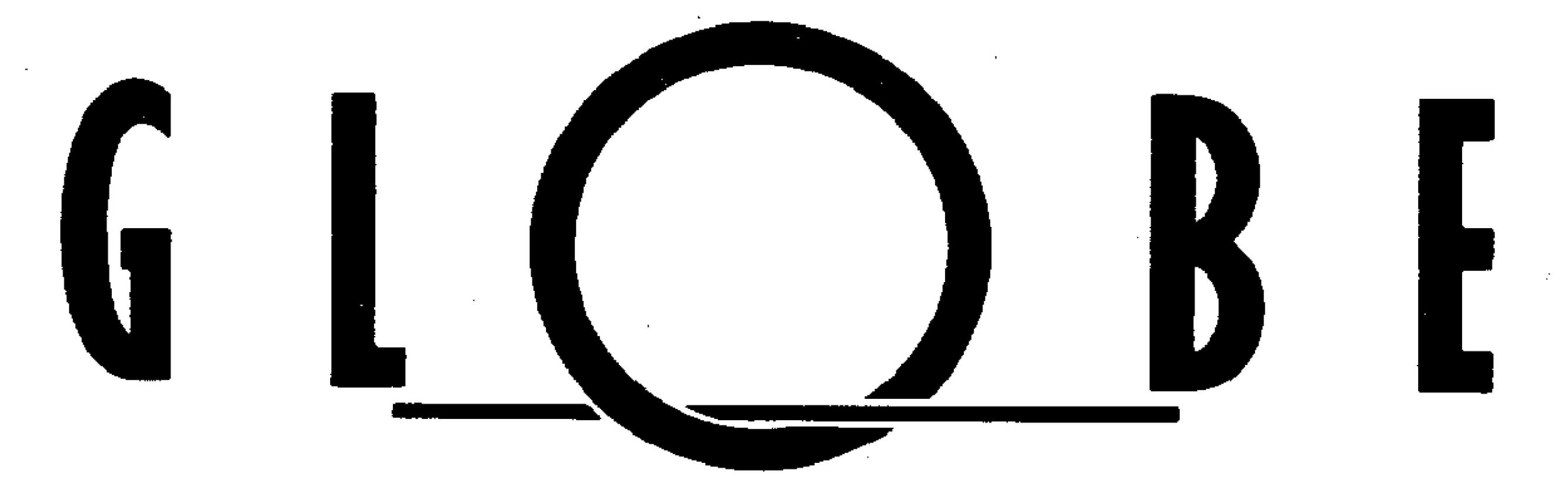
Réseaux sociaux officiels