La fiction n’est pas la copie du monde, mais son double.
Le monde n’est pas le double de la fiction, mais son effet.
Le réel ? L’irréel ? Apparemment le contraire. En réalité la même chose. Presque la même chose. Juste un fil ténu, de plus en plus insaisissable, qui les distingue et les sépare.
Vezzoli ne « critique » pas la modernité, le cirque médiatique, le parti pris des choses, le règne du rien, il les expose.
Vezzoli ne « parodie » pas la télé-réalité, la démocratie devenue folle, la culture de la célébrité, il en montre les ressorts, les exhibe.
Vezzoli ne dénonce rien ; ne se plaint de rien ; ne récrimine en rien ; parfaitement éloigné de lui est le ressentiment bienpensant du « Grand Réformateur » social qui en appelle à un « autre monde » venant en lieu et place de celui-ci où règneraient, hélas, l’illusion, le leurre, l’absence du sens et de la présence ; je ne suis même pas certain qu’il soit si inspiré qu’il lui arrive de le prétendre par le vertueux entretien de Pasolini, publié au début des années 70, dans lequel l’auteur de Salo tonnait que les interviews télévisées, par exemple, sont « la forme d’humiliation la plus basse » pour un humain ; Vezzoli ne tonne pas ; Vezzoli ne proteste pas ; Vezzoli n’est pas vertueux ; Vezzoli n’accuse rien ni personne – il déconstruit.
Connaît-il Derrida ? A-t-il réfléchi, de L’Origine de la Géométrie aux textes suivant le 11 Septembre, aux théories dites « déconstructionnistes » ? Je n’ai jamais parlé de cela avec lui. Mais je n’imagine pas qu’il en soit autrement. Je n’imagine pas qu’il soit complètement étranger aux thèses de celui des philosophes modernes qui a le plus clairement établi qu’il n’y a, à jamais, qu’un seul monde : cœur et marges confondus, centre et périphérie définitivement cohérents, pas d’extériorité, pas d’altérité radicale, une sorte de dedans fatal qui aurait définitivement intégré son dehors – ensemble, le réel et la fiction, le monde et ses possibles, la voix et son écho, l’écho interminable et que ne soutient plus même la voix.
Connaît-il Baudrillard ? Est-il, d’une manière ou d’une autre, passé par le théoricien de l’hyperréalité, le dénonciateur de la bêtise réaliste, le commentateur implacable mais lucide du règne sans fin du simulacre ? Jamais parlé non plus de cela avec lui. Jamais parlé de grand-chose, d’ailleurs, même quand nous préparions Democrazy, cette fable politique, présentée à la dernière Biennale de Venise et qui se proposait d’explorer rien moins que l’envers de l’histoire politique américaine contemporaine, l’autre côté de son miroir, les coulisses d’une campagne présidentielle jouée par Sharon Stone et moi – mais attention ! un envers qui était une doublure ! un autre côté qui n’était pas une altérité ! un verso si l’on veut, ou un recto peu importe, mais la même surface en tout cas ; la première, juste retournée ; jamais la face cachée ; jamais l’ordre secret ; en aucun cas l’une de ces « profondeurs » qui n’en finissent pas de relancer l’interminable spéculation, toujours conspirationniste, sur la trame invisible régissant l’ordre visible. Nous n’avons jamais discuté de cela, non, tandis qu’il m’observait débattant pied à pied, mot à mot, avec l’équipe de « stratégistes » venus exprès de Washington pour me briefer et faire de moi un candidat crédible, donc impossible, à la reconquête, par les Démocrates, de la Maison-Blanche. Mais, qu’il le sache ou non, je sens bien, moi, la marque de cette grande pensée de l’annihilation du réel et de la réalité du néant – je sens bien, je vois bien, qu’il est le contemporain de Jean Baudrillard, ce théoricien contestable, mais fort, de l’extase du réel et du système des objets.
Il a lu Pirandello, en revanche. Lui, il l’a évidemment lu puisque sa dernière œuvre, installée au Guggenheim de New York, est une mise en espace, me dit- on, de l’une des premières pièces du futur auteur des Six Personnages en quête d’auteur. Et, de Pirandello, de ce premier Pirandello menaçant si sa pièce ne marchait pas de renoncer définitivement au théâtre, il a retenu la thèse de la vérité indistincte, remise en perspective, indéfiniment approximative et incertaine, fragile et discutable – toujours le même fil insaisissable, la même très mince frontière entre l’erreur et la vérité, la même indistinction de structure entre mensonge et réalité. Qui dit vrai, de Monsieur Ponza, de sa femme, de sa belle- mère ? Qui est l’être de raison ayant revêtu le masque de la folie ? Qui, le fou déguisé en être de raison ? Bruit et fureur… Théâtre de l’ambiguïté… Spectacle à tous les étages… All the world is a stage… Pas d’autre monde que cette scène… La pièce de Pirandello s’appelle Cosi è (se vi pare)… En français, A chacun sa vérité… En anglais, quelque chose du genre : « Comme il vous plaira… » Autrement dit, et sous l’apparente dérision du déconstructeur sauvage, une tonalité shakespearienne qui est une autre dimension du vezzolisme.
Car il y a du désespoir chez Vezzoli.
Il y a du pessimisme ontologique chez Vezzoli.
La caverne sans les Idées.
Les ombres sans la Lumière.
Last exit avant la presque inévitable hypothèse du ciel.
L’un des rares artistes d’aujourd’hui à être sorti, vraiment sorti, du platonisme.
Rien, nulle part, sous quelque forme que ce soit, qui nous suggère : « telles sont les figures visibles de ce monde – derrière elles, une figure invisible. »
Pas de centre. Pas de bord. Des surfaces.
Pas d’épaisseur. Pas de volume. Des lignes, des mouvements, des sons.
Les clichés… Le jeu avec les clichés… L’invasion de l’espace, de la tête, de ma tête, de la sienne, par un cliché devenu roi, donc obscène et occupant, qu’on le veuille ou non, le devant de la scène… A l’origine est le cliché… Au commencement était, non le verbe, mais son ironie, sa dérision, son cliché… Si cette idée paraît, de prime abord, légère, amusante, gaie, elle est, en réalité, la plus lourde à supporter, presque tragique.
Presque ? Oui, naturellement. Car c’est le mot fameux de Marx sur Napoléon III et ces séquences temporelles qui se répètent toujours deux fois : tragédie d’abord, puis comédie, voire farce, avatar grotesque d’un précédent légendaire sur lequel il spécule.
Tristesse de Vezzoli.
Mélancolie de celui qui a compris que le monde est un tombeau et que l’artiste est son gardien.
Tristesse est-il le mot ? Et mélancolie ?
Peut-être pas, finalement.
Car trop de sentiment dans la mélancolie et la tristesse. Trop de romantisme et de roman. Et nul n’est moins romantique que l’homme qui a mêlé, dans son sac à malices parodique, le plus grand écrivain américain vivant, les stars amphétaminées de la mauvaise télé-réalité, Hollywood, l’Italie préfasciste et berlusconienne, les empires américain et romain, j’en passe.
J’ai travaillé, donc, avec Vezzoli. Nous avons fait ensemble, avec Sharon Stone depuis Los Angeles, ce fameux Democrazy. Et ce qui m’a frappé, pendant ces semaines, c’est l’absence d’affect, justement, dans son œuvre. L’évacuation de l’émoi, du trouble, de l’émotion. Le rouge n’était pas chaud. Le bleu n’était pas froid. Sharon Stone n’était plus la Stone de chair. BHL n’était plus ni la marionnette ni la mise en abyme de Bernard-Henri Lévy. Une œuvre qui n’avait plus rien à nous dire, non, de la vérité de ses visages ou du mensonge de leurs copies. Degré zéro du sens. Minimum de conscience et d’éloquence. Ni ressentiment ni célébration. Ni expression ni impression. Des clichés.
Catherine Deneuve, Marianne Faithfull, Jeanne Moreau, Gore Vidal, Caligula et, maintenant, Patricia et Patrick Hill, ces bienheureux de l’église vezzolienne : s’agit-il de recomposer les idoles ? de les décomposer ? dans quel ordre ?
Non plus, comme dans la grande tradition biblique : « tu ne feras pas d’images peintes. » Mais : « tu ne feras plus que cela ; de chaque idole tu feras une icône – et vice versa. » Sauf que… Cet ecclésiaste-là n’encense pas ses icônes. Il les banalise. Il les prend au piège de leur platitude. Ce sont les premières figures de l’art sacré à n’être pas glorifiées, mais ironisées, moquées.
Ce « nabab de la passivité », disait Stephen Koch de Warhol : il aurait pu le dire de Vezzoli.
L’« inébranlable résolution de ne pas être ému », disait déjà Baudelaire, cet autre frère en esprit – Dandy Warhol… Brummell ou Des Esseintes… ces grands frères de Vezzoli…
L’avidité maussade de l’ex-collectionneur dont les premières œuvres, il y a quinze ou vingt ans, consistaient en broderies magnifiques, monotones, obsessionnelles, un peu folles…
Ou le mot de Martial Raysse, sur Andy Warhol encore, à l’époque de son Hygiène de la vision sur l’extraordinaire « sang-froid » émanant de ses séries sérigraphiées : « des œuvres qui portent en elles la sereine évidence d’un réfrigérateur de série : neuves, aseptisées, inaltérables » – ne s’applique-t-il pas, ce mot, de nouveau, à Vezzoli ?
Il n’y aura que les philistins pour faire de ce flou fluo le symbole de la décadence et du kitsch.
Il n’y a que les crétins pour, face à cette ascèse moderne, dire : ère du vide, du nihilisme satirique, du frivole.
Contemporain, Vezzoli ? Oui, sans doute. Encore que… Relisez les textes d’un autre philosophe, Michel Foucault, sur la peinture « photogénique ». Relisez ce qu’il disait, Foucault, de la façon de travailler de Lake, Cameron, Rejlander, Emerson, Heinrich Kühn. On dirait déjà Vezzoli. On croirait un ancien usage des clichés qui, un siècle plus tard, resurgirait avec Vezzoli.
La photo, dit-on, a avalé la figuration ? Elle aurait libéré l’art de sa tentation figurative ? Et, après elle, après la photo et mieux encore que la photo, ce serait le vrai rôle de l’image en mouvement – cinéma, vidéo, images numériques et de synthèse ? C’est l’art qui, ici, avale le numérique et la synthèse. Il absorbe ce qui l’a absorbé. Non que Vezzoli « réhabilite » la vidéo ou, une fois de plus, le cliché. Non qu’il les « élève », comme on dit, au rang d’un art majeur. Il les intègre. Les engloutit. Il fait de l’imagerie moderne une province de son empire, de son art.
Une sorte de Marcel Duchamp de la première moitié du XXIe siècle.
Non pas le ready made ni, encore moins, la junk culture – mais la vérité de l’art défaite par l’art de la vérité.
Non pas l’urinoir fameux où viendraient encore pisser les éternels célibataires d’une non moins éternelle Rose Sélavy – mais les catacombes, les greniers, les poubelles magnifiques et glorieuses de la modernité.
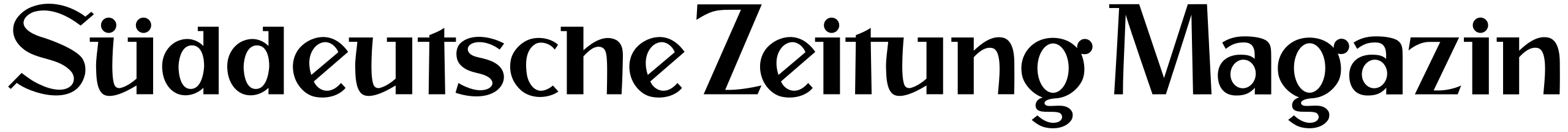
Réseaux sociaux officiels